Ecris en 1949 et complété en 1981
Terminé le 23 septembre 1981 à Bad Salzufle
Transcris par Andreas Kern
Version française réalisé par Simon R
Andreas Kern : A propos de ce texte
Les souvenirs de la guerre sont les premiers qu'Alexander Kern a écrits : en 1949, il a profité de vacances sur l'île de Sylt pour coucher ses expériences sur le papier - sans doute aussi tant que les souvenirs étaient encore frais. Car s'il avait régulièrement tenu un journal pendant ces six ans et demi, il déposait ces minces carnets, une fois remplis, chez sa femme Maria, dans leur appartement de Lauenburg. L'appartement a été perdu avec tous ses biens à la fin de la guerre. Le dernier journal utilisé a été enterré par Kern sur ordre avant sa capture en mars 1945.
Il a donc dû se fier principalement à sa mémoire pour noter ses expériences en 1949. Très tôt après la guerre, il a toutefois pris contact avec son chef de section et ami, le Dr Gustav Bügge, qui avait sauvé ses propres journaux et les a mis à la disposition de Kern, ainsi que de nombreuses photos de ses propres années de guerre. Une copie des notes du journal du Dr Bügge, réalisée par Kern en 1951/52, a été conservée.
Au cours des décennies suivantes, Alexander Kern a écrit à plusieurs reprises des expériences de guerre sous forme d'histoires sur des événements ou des personnalités. En 1981, lors d'une nouvelle transcription du manuscrit (à la main), il a ajouté les chapitres ultérieurs, a également établi une chronique de sa compagnie sanitaire et a dessiné plusieurs cartes pour illustrer les mouvements des troupes.
En 1986, lorsque son fils Christoph a voulu en savoir plus sur sa captivité en 1945/46, Alexander Kern a considérablement développé les deux chapitres initialement consacrés à ce sujet dans ce manuscrit (partie 4) et a consacré à l'année passée dans le camp la partie 5, qui se rattache chronologiquement à la présente partie 4. Les deux chapitres mentionnés ne figurent donc pas dans ma version de la partie 4. A la place, j'ajoute un chapitre relatant un événement survenu sur le front en Russie - il ne figure que dans la version de travail du manuscrit de 1986.
Comme d'habitude, j'ai repris le contenu et le style du texte de l'original. Grâce à ma transcription, il a toutefois été possible de classer les textes, écrits sur une période de près de 40 ans, chapitre par chapitre dans un ordre chronologique.
Noël 2016 - Andreas Kern
Les étapes de ma vie de soldat
1939 Appartement à Lauenburg/Poméranie
6 décembre 1939 Incorporé à Stettin-Wendorf (caserne d'artillerie) dans le service de remplacement sanitaire. Formation des recrues
1940
7 janvier 1940 Stettin-Podejuch, mise en place de la compagnie sanitaire
16 janvier 1940 Terrain d'entraînement militaire du Gross-Born (appareil)
28 janvier 1940 Quartier d'hiver à Gut Ankerholz près de Schivelbein/Poméranie -
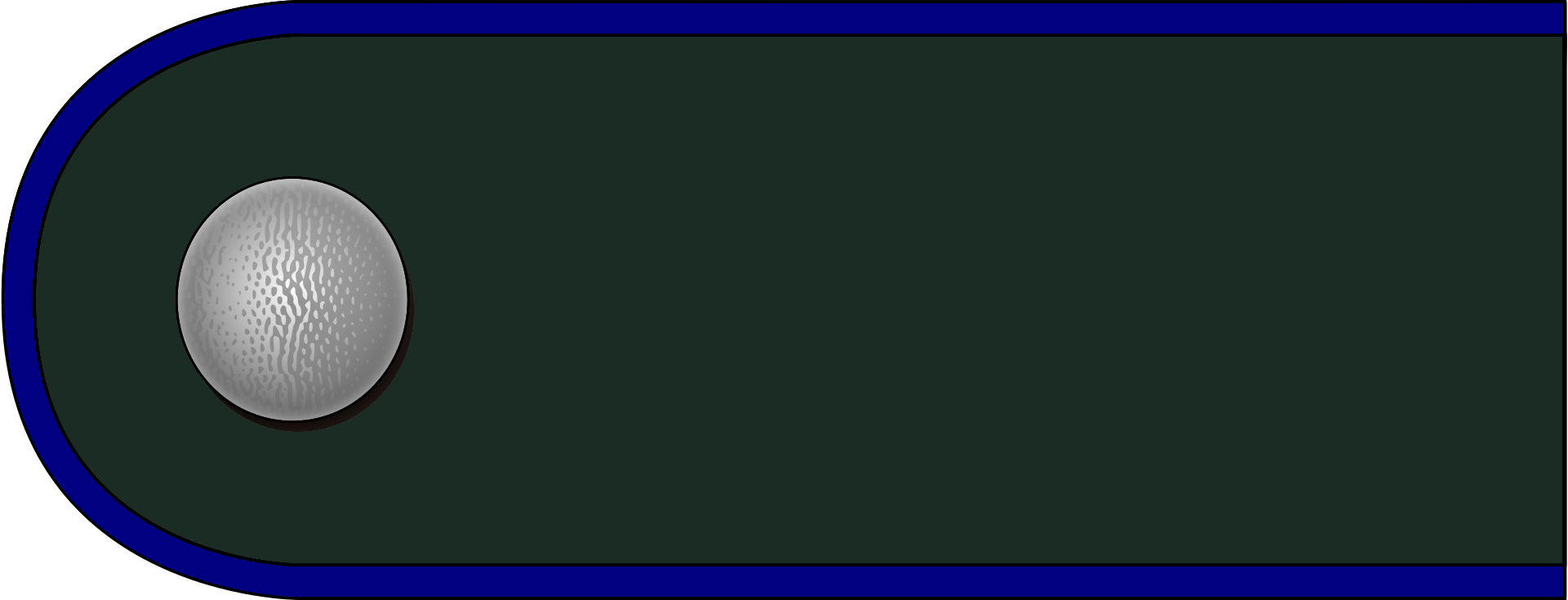 - Campagne de France
- Campagne de France10 mai 1940 Chargement de la compagnie sanitaire à Schivelbein
Voyage en train jusqu'à Darmstadt, Seeheim Bergstraße. Visite de la ville de Heidelberg
12 mai 1940 Départ : Moselle - Zell - Alf - Bitburg - Wittlich. Frontière luxembourgeoise près de Hosingen
Juin 1940 Vianden - Luxembourg - Differdange (HVP) Frontière française : Longwy - Montmédy
Juillet 1940 Ligne Maginot - Spincourt - Etain - Chambley près de Gravelotte - Lérouville près de Commercy -
 -
Retour par : Pont-à-Mousson - St.Avold - Völklingen
-
Retour par : Pont-à-Mousson - St.Avold - VölklingenAoût 1940 Chargement - voyage en train vers la Pologne Varsovie-Wawer - monastère de Woczwawek École (hôpital local)
1941 Campagne de Russie
Avril 1941 Marche vers Mlawa (hôpital local) via la forteresse de Modlin
Juin 1941 Marches de nuit en Prusse orientale, Johannisburg - Lyck - Račky
22 juin 1941 HVP Biely Dom - Janowka Début de la guerre
Juillet 1941 Augustowo - Grodno - Volkowysk (HVP), Croix de guerre de IIe classe
Août 1941 Slonim (HVP) - Swislacs (HVP) - Smolensk
Septembre 1941 Jarzewo - Lopatkina (HVP) - Viazma Octobre 1941 Sytchevka - Ssintsovo/Kalinin/Volga (HVP)
Novembre 41 Gudowa (HVP) - Beresnjaki (HVP)
6 décembre 41 Retraite de Berezniaki à l'hôpital de campagne de Pouchkino
31 décembre 41 Mitina près de Stariza
1942
janvier 42 Karamsino près de Subzow (hôpital local) -
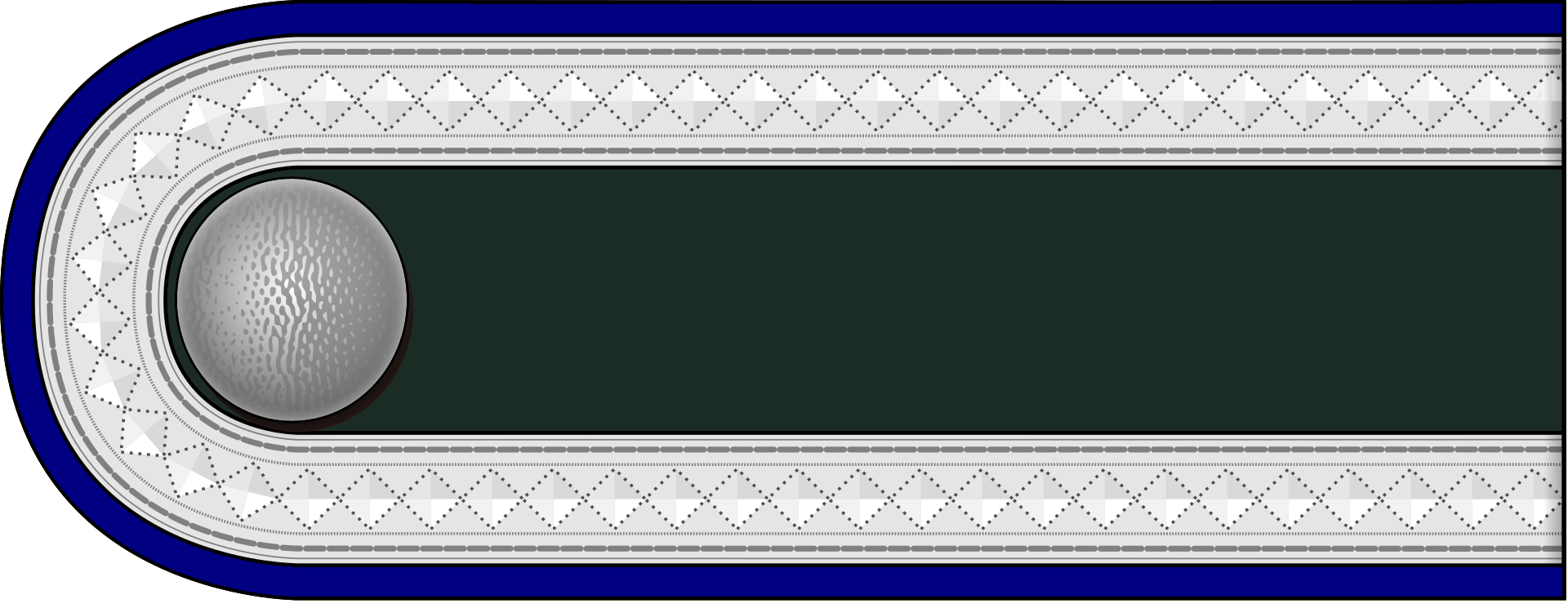
Mai 42 Chaljutina près d'Olenin (HVP)
Juin 1942 Commissaireovo (HVP) - Chkali (HVP)
Juillet 42 Dunajewo (HVP) - Papino (HVP) Infirmerie des blessés (premier congé au pays après Lauenburg/Poméranie)
6 septembre 42 Départ de Papino - Bortschewka - Malzewo
3 octobre 42 Borovaïa - Chvalévo
15 octobre 42 Schwalewo - épouillage - chargement de la compagnie Voyage à Smolensk - Minsk - Barono witschi - Brest-Litowsk - Kielce - Katowice - Opole - Wroclaw - Magdebourg - Hagen/Westphalie - Aix- la-Chapelle - frontière belge - Namur - Laon - Reims
23 octobre 42 Mailly-le-Camp près de Châlons-sur- Marne Camp de troupes françaises (hôpital local)
En France
23 décembre 42 Voyage dans le sud de la France = Provence (réapprovisionnement de la division) Marseille-Allauch (Quartier)
25 décembre 42 Marche vers Aix-en-Provence (hôpital local, Ortslazarett)
Unité pour grands blessés (70 lits) à l'"Hôtel de Dieu"
Missions : Avignon - Lyon - Dijon - Troyes - Paris
1943
1er avril 43 -
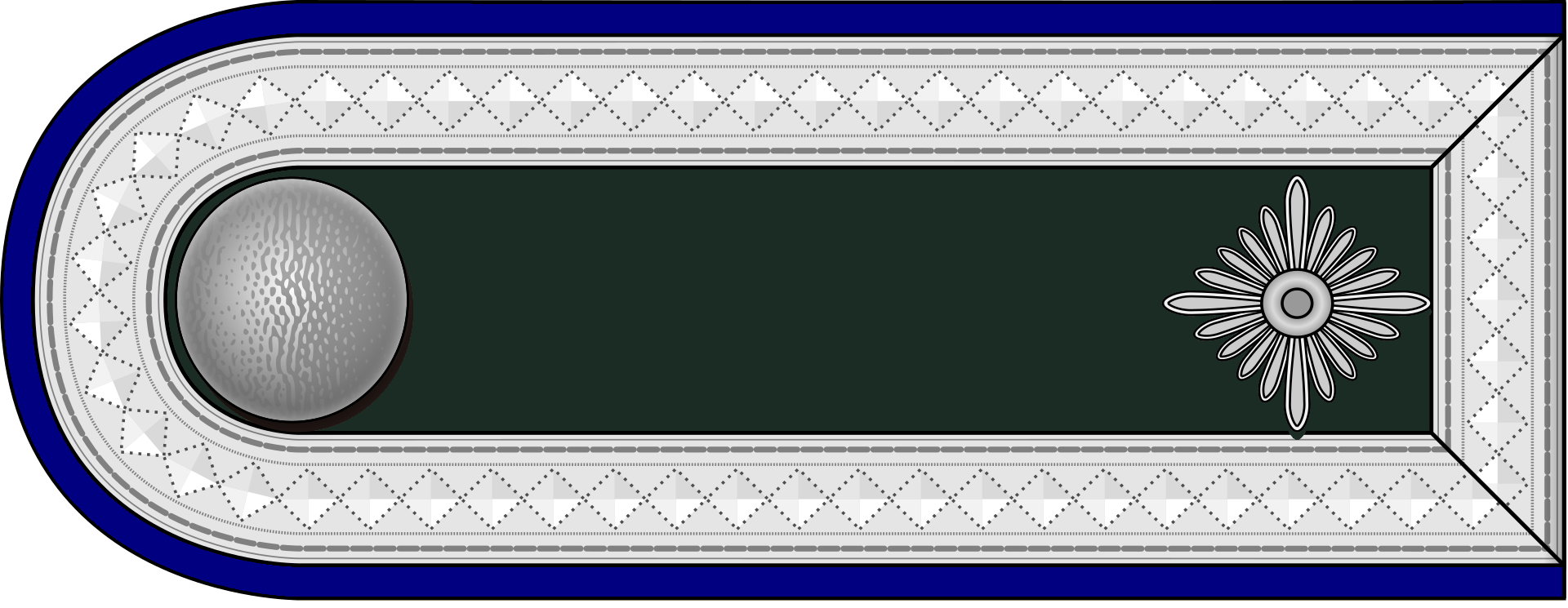
23 mai 43 Cavaillon - St. Rémy - Glanum (ville antique)
du 15 au 23/05. Transport de blessés vers les Pyrénées : Aix - Marseille - Arles - Tarascon - Nîmes - Montpellier - Sête - Agde - Narbonne - Perpignan - Villefranche - Font Romeu/Pyrénées à 2000 mètres d'altitude)
Russie - Ukraine
Fin mai 43 Chargement de la compagnie à Cavaillon
Voyage en train vers la Russie - Ukraine Saproshe - Déchargement
Marche vers Karlowka (hôpital local) et ensuite vers le front d'Izioum
Juin 43 Krasnograd - Poltava - Miusfront
6 juillet 43 Shebelinka (HVP) - Kisseli (HVP)
16 juillet 43 Ssiwash/Bereka (HVP)
Août 43 Repli vers le Dniepr - Likhatchevo - Novo Alexandrovo (beaucoup de HVP !)
Septembre 43 Passage sur le Dniepr - Krinitchki (HVP)
Octobre 43 Kulischka - Krivoï Rog - Nowy Bug
Novembre 43 Chargement vers l'ouest
France
À partir du 15 novembre 43 Châteaulin/Bretagne (hôpital local)
30 janvier 1944 Croix de guerre I. Classe
1944 Invasion
6 juin 44 Débarquement allié en Normandie
11 juin 44 Marche de la compagnie Kerdan - Payben - St. Gilles - Plœuc - Dinge - Montigny - Saint-James - Ponterson - Villedieu - Coutances
24 juillet 1944
Bombardement de notre HVP par 8 Jabos = 13 morts, 5 blessés dans notre section. Le soir, départ pour Villadon-le-Sens près de Nicorps.
27 juillet 44 Départ (fuite devant les chars) Château Champcey (vue sur le parc vers le Mont- Saint-Michel, baie de Saint- Malo)
2 août 44 Saint-Hilaire - Bagnoles-de-l'Orne - La Ferté - Carrouges - Montmirail - Arpajon - Corbeil
20 août 44 Lésigny - Crécy - Château-Thierry - Belleau - Chemin des Dames - Soissons
23 août 44 Saint-Quentin - Le Cateau - Bavay - Frontière belge
31 août 44 Mons
1er septembre 44 Binche - Gosselies - Charleroi - Meux - Tongres
6 septembre 44 Moresnet - frontière allemande - Aix-la-Chapelle - Eschweiler
20 sept. 44 Düren - Euskirchen - Bonn - Dünstekoven
27 septembre 44 Arnoldsweiler (HVP) Ecole du Couvent
18 octobre 44 Büdesheim (HVP) - Münstereifel - Stadt Kyll - Gerolsheim - Schönecken
20 octobre 44 Schönecken/Eifel (HVP)Offensive des Ardennes
16 décembre 44 Bleialf (HVP)
18 décembre 44 Rodt près de St. Vith (HVP)
27 décembre 44 Bleialf (HVP)
1945
Janvier 45 Daun (HVP) - Ütersdorf (HVP)
Février 45 Hohenleimbach/Andernach (HVP)
Hohe Acht près d'Adenau (HVP)
9 mars 45 Prisonnier des Américains. Hôtel Nürburgring (HVP, 200 blessés allemands)
15 mars 45 Camp de rassemblement de Müllenbach - Trèves - Wasserbillig - Stenay près de Sédan
29 mars 45 Camp de base Rennes/Bretagne, Cage 9 Tente 33 (jusqu'au 10 juin) Prisonnier n° 31G P.W.I.B 1362800
13 juin 45 Transfert en captivité britannique, Camp de rassemblement de Rheinberg près de Wesel (camp "E") N° de prisonnier A547280
3 juillet 45 Camp principal 2231 Enghien près de Bruxelles/Belgique Compound 9 Tente 39
27 septembre 45 En captivité en Angleterre - POW Camp 2228 près de La Hulpe au sud de Bruxelles/Belgique
24 décembre 45 Premier message de Maria de Bad Bramstedt/Holstein : une carte du 19 septembre 45
3 mars 46 Libération de captivité anglaise à Nordhorn, frontière hollandaise ("Unfit for work - fit for travel")
6 mars 46 Retrouvailles avec Maria à Bad Bramstedt.
Abréviations utilisée
AK Corps d'armée
Ari Artillerie
EK Croix de fer, croix du mérite de guerre - distinction militaire Esak aumônier militaire évangélique (catholique : Kasak) Flak Canon antiaérien
GPU Police secrète soviétique (Gossudarstwenoje Polititscheskoje Upravlenije)
HJ Jeunesse hitlérienne - Organisation du régime nazi
HVP Poste de secours principal (centre de soins mobile des ambulanciers près de la CPAM)
HKL Ligne de combat principale du front
I. D. Division d'infanterie
Ivan terme allemand pour Russe, soldat russe
Jabo chasseur-bombardier, avion de combat
Jerry terme britannique pour German, soldat allemand
K. Z. Dentiste de guerre
MG Mitraillette
MP Pistolet mitrailleur
OA Médecin-chef
OL Hôpital local - contrairement à l'HVP, aménagé pour soigner les blessés plus longtemps
OStA Médecin-chef
POW Prisoner of War = Prisonnier de guerre
Sankra Véhicule sanitaire
Stuka Avion de combat en piqué, désignant le plus souvent l'avion allemand Junkers Ju 87
Tb Tuberculose
Tommy nom allemand pour les soldats britanniques
U. v. D. Sous-officier de service (sous-officier de garde)
(...) Des commentaires pourront être visible en allemand entre parenthèse pour donner des précisions sur la traduction de certain mots
Préface
Île de Sylt 24. 7. 1949
Sur la rive est de l'île de Sylt, entre Blidselbucht et Vogelkoje Kampen, se trouve une haute dune qui domine la région de loin. Assis en haut de cette dune, j'aperçois devant moi, dans le soleil, l'océan.
La mer des Wadden, recouverte par la marée montante, est d'un bleu éclatant et la côte continentale - loin à l'est, à l'horizon - ressemble à de longues îles pâles. À mes pieds se trouve la magnifique et vaste baie qui s'étend de List au nord à Kampen au sud, puis à Morsum-Kliff en formant un arc immense. Le sable blanc et jaune de la dune mobile brille sous le chaud soleil de l'après-midi ; autour de moi : l'herbe bleu-vert des dunes, la bruyère rouge-brun et l'étroite plage jaune-brun de la mer des Wadden. Des groupes de sternes et d'huîtriers-pie remplissent l'air au-dessus de l'eau d'un blanc étincelant. Dans cette immensité, il n'y a pas un seul être humain.
Je suis allongé et je rêve en regardant cette belle île. J'ai devant moi une lettre de Maria. Elle m'écrit l'adresse du Dr. Bügge, mon ancien médecin-major et chirurgien pendant la deuxième guerre mondiale à la compagnie sanitaire 2/353 I. D.
Le monde de la guerre passée - qui s'est déjà estompé au cours de ces quatre années d'après-guerre - est à nouveau tout près de moi avec ce seul nom, le Dr Bügge. Ici, dans le calme de la solitude de l'île, le monde vécu de ces années sauvages et mauvaises reprend vie. Devant moi se déploie, image après image, un monde qui s'est ouvert à moi le 6 décembre 1939, lorsque j'ai été "incorporé" dans la caserne de recrues de Stettin, et qui a sombré le 3 mars 1946, lorsque j'ai été libéré de la captivité anglaise, amaigri jusqu'à l'état de squelette, totalement sale et déchiré, à Nordhorn, à la frontière hollandaise, et que j'ai frappé deux jours plus tard à la porte de Maria à Bad Bramstedt (Holstein).
Nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 1949. L'un des jours les plus sombres de mes années de guerre a été le 24 juillet 1944 sur le champ de bataille principal de Château Monthuchon, en Normandie, au moment du débarquement.
Ainsi, la coïncidence d'un nom et d'un jour de commémoration est à l'origine des notes suivantes, qui tentent de garder une trace de ce que la 2e section de la compagnie sanitaire 2/353 a vécu à l'est et à l'ouest dans les années 1940-1945.
Le récit de mes expériences de guerre ne commence qu'en été 1941 avec la campagne de Russie (note d'Andreas : Le chapitre 1 suivant, consacré à l'automne 1940, est un ajout de 1981) . Je n'ai rien à raconter de ma formation de base et sanitaire (décembre 1939 - avril 1940) ni de la campagne de France (mai-juin 1940), car en France, nous ne faisions que marcher derrière les unités motorisées beaucoup plus rapides (nous étions une compagnie sanitaire attelée ) et, à l'armistice, le 25 juin, nous n'étions parvenus que dans l'est de la France, dans le triangle fortifié Toul-Metz- Verdun. De là, nous avons été transférés à Varsovie en août 1940. (note d'Andreas : Après coup, Alexander Kern a tout de même noté quelques souvenirs concernant ses premières expériences de guerre en 1939- 40. On peut les lire dans la partie 5 de ses Mémoires de vie (Prison de guerre), et plus précisément dans le paragraphe final : "Gedanken eines Kriegsgefangenen" (Pensées d'un prisonnier de guerre).)
1 Une croix noire à Varsovie – Automne 1940
A Varsovie-Wawer Automne 1940
Après la campagne de France de 1940, notre division a été transférée en Pologne ; plus précisément à Varsovie-Wawer, une des banlieues laides de la capitale polonaise; dans un ancien couvent et dans des maisons privées inoccupées. Notre 2e section a installé un hôpital local dans trois grandes salles de classe d'une école, avec une salle de soins et des infirmeries. La place d'appel de notre compagnie était un grand rectangle recouvert d'une herbe clairsemée, dont un côté était délimité par une clôture en bois brut de deux mètres de haut. Au milieu de cette clôture, une grande croix était peinte à la peinture goudronnée.
Une femme de ménage polonaise qui, trois fois par semaine, nettoyait, essuyait et faisait le ménage dans l'hopital entre autres, m'a raconté dans son allemand approximatif l'histoire de cette croix. Son récit m'a été confirmé plus tard, pour l'essentiel, par un sous-officier de l'administration locale stationné à Varsovie depuis la fin de la campagne de Pologne.
Fin novembre 1939, deux sergents allemands étaient assis dans un petit bar polonais dans un coin - à environ 100 mètres de notre place d'appel - et buvaient, de la bière et du schnaps. Soudain, la porte s'est ouverte et un civil polonais (un fanatique ?) a immédiatement tiré sur les deux soldats depuis la porte avec un pistolet. Ils sont morts sur le coup. Le civil a disparu dans l'obscurité.
La réaction de l'administration militaire allemande (Feldgendarmerie) a été terrible : la nuit même, 30 hommes de la population civile - pour la plupart des pères de famille - ont été tirés de leur lit et pris en otage dans les maisons situées autour du bar polonais. On les a placés devant la clôture en planches et on les a tous abattus, en représailles du meurtre des sergents allemands.
La population de la banlieue a été témoin de ce deuxième acte de violence - pour la plupart des femmes et des enfants qui ont assisté, impuissants et sans défense, à l'exécution de leurs pères, frères, amis et concitoyens pris en otage devant la clôture en planches. Les corps des victimes totalement innocentes et non impliquées dans le premier meurtre ont été jetés immédiatement après l'exécution dans une fosse commune creusée devant la clôture et ensuite aplanie. Tout cela dans le but de "dissuader la population civile, afin d'empêcher de nouveaux attentats contre l'armée allemande", comme l'indiquait un avis affiché du commandement.
Quelque temps plus tard, des inconnus ont peint en noir la grande croix sur la clôture de planches devant laquelle les otages avaient été assassinés et enterrés. Cette croix, nous la voyions tous les jours lorsque nous allions de notre hôpital local à la "Parole", devant l'appartement du médecin-chef de la compagnie sanitaire, le Dr Oellerich.
De la part du fanatique polonais, il s'agissait d'un cas flagrant de double meurtre lâche. La réponse du commandant de la ville, qui avait ses "ordres en la matière", a été à la hauteur : il les a exécutés - sans sentiment ni conscience - comme il l'avait ordonné. On a donc ici répondu (expié ?) à un double meurtre par un meurtre trente fois plus grand. Ce faisant, le deuxième meurtrier s'est également mis dans son tort, car il n'a pas puni le coupable.
La troisième vague de ce type d'actes de violence a eu lieu en 1947 à Nuremberg, où les "vainqueurs" n'ont pas cru les (rares) "criminels nazis" capturés lorsqu'ils ont affirmé qu'ils étaient des "criminels de guerre". "n'étaient que des exécutants d'ordres" qui "n'étaient pas eux- mêmes responsables de ces actes". Il était donc "juste" ("Malheur aux vaincus !") qu'en guise de représailles (encore !), ces âmes meurtrières soient elles-mêmes exécutées.
C'est juste ! Vraiment ? Il y a eu un troisième meurtre en 1947. Ce n'est que dans ces cas-là que "moins fois moins" ne donne jamais "plus". Les trois "exécutants" étaient des criminels potentiels ; et les Américains ne valaient pas mieux que les nazis, qui ne valaient pas mieux que le civil polonais fanatique.
"Celui qui prend l'épée périra par l'épée". Matthieu 26,52
Lorsque nous sommes arrivés à Varsovie-Wawer en octobre 1940, l'"étoile juive" a été introduite huit jours plus tard pour tous les citoyens polonais de confession israélienne.
En même temps, on ordonnait aux "Gebrannt-markten" de ne marcher ni sur le trottoir ni sur la chaussée des rues, mais uniquement dans le caniveau. Donc ni sur le trottoir de la population "aryenne" ( ?), ni sur la chaussée pour les chariots, les roues et le bétail, mais encore plus bas, encore plus profond : dans le caniveau, dans lequel on laisse s'écouler la saleté des rues.
(Note : Ici l'auteur fait référence au massacre de Wawer, de la nuit du 26 au 27 décembre 1939. En fait, 120 hommes seront interpellés et 106 seront tués, la plupart sans même être au courant du meutre des deux sous-officiers allemands)
2 HVP Biely Dom – Janowka – Juin 1941
Une nuit d'été très claire dans la forêt de Račky. Je suis de garde. Il est deux heures du matin. Dans le ciel bleu pâle du matin, une étoile rougeâtre vacille à l'est. Derrière moi, à la lisière de la forêt, des camarades qui dorment. Aucun oiseau n'est encore réveillé. Il y a un grand silence, mais ce n'est pas le calme dans ce silence, c'est quelque chose qui couve, qui pèse et qui menace. Mes pensées me ramènent aux derniers jours : pendant des semaines, nous avons marché de Varsovie-Wawer à Mlawa-Chorzela, en passant par le sud de la Prusse orientale, Johannisburg, Lyck ; depuis hier soir, nous sommes allongés sur le domaine de Biely Dom (Weißes Dom) près de Račky, juste à la frontière entre la Pologne et la Russie, en face d'Augustowo.
Nous avons monté nos tentes du poste de secours principal dans le parc du domaine, sous de grands arbres. Depuis la campagne de France de 1940 déjà, je suis instrumentiste et stérilisateur de la 2e section de la compagnie sanitaire. Depuis des semaines, déjà à Mlawa, on diffusait des "slogans" sur une guerre avec la Russie. J'ai toujours parlé contre : je ne pensais pas qu'Hitler s'engagerait dans une guerre sur deux fronts, l'Allemagne n'était pas assez forte pour cela, car à l'Ouest, l'Amérique attendait l'intervention (comme en 1917 !). Je n'ai pas voulu l'admettre jusqu'à, oui, jusqu'à hier soir, quand l'ordre du Führer a été lu à la "Parole", qui parlait d'une attaque imminente des Russes qu'il fallait anticiper. Ce matin, à 3h05 , l'attaque allemande doit commencer. Maintenant, dans une heure, nous aurons la guerre (redoutée) sur deux fronts !
Comment va-t-elle se terminer ? Les Russes construisent des fortifications de campagne dans le secteur d'Augustowo, c'est bien connu ici. Même la nuit, on y fait des retranchements à la lumière des phares. D'un autre côté, nous avons un grand traité commercial avec la Russie. Hier soir encore, à la frontière, à la gare de marchandises près de Lyck, trois trains de blé russes ont été transbordés sur des wagons allemands : des livraisons de céréales contractuelles. Devant nous, à l'est, se trouve la région forestière d'Augustowo, au sud-ouest de Grodno. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de sang a coulé ici des deux côtés. Il fait de plus en plus clair. Il est trois heures. Exactement 3h05 , le feu de l'artillerie allemande éclate devant nous, des formations de stukas et d'énormes flottes de bombardiers nous survolent et se dirigent vers le soleil. Notre 262e division d'infanterie poméranienne, avec les régiments 303, 314 et 321, se trouve directement à la frontière. Ils doivent prendre le secteur Janowska-Augustowo.
À 16 heures, ma relève arrive. Je vais dans notre tente d'opération pour vérifier une dernière fois tout ce qui a été préparé pour l'intervention d'aujourd'hui. Il y a des choses sur les murs : La table d'instruments, la boîte de seringues record, les ampoules de sérums et autres, la table de médicaments, de grandes quantités de pansements. Au milieu, la table d'opération avec deux grandes lampes (accumulateur). Dans un compartiment latéral, l'installation de stérilisation ; sur un banc des cuvettes de lavage et du désinfectant Sagrotan. Du linge stérile dans des tambours. Vers 6 heures, nous attendons les premiers blessés.
Le bourdonnement des formations aériennes qui arrivent et qui reviennent ne s'arrête plus. A 7 heures, toujours pas de blessé. Une partie de notre 1ère section ont rejoint hier soir le régiment 303 pour être affectés comme brancardiers auprès de la troupe. (Nous avons entendu dire que malgré leurs brassards de la Croix-Rouge, ils ont été durement frappés par Ivan). C'était une bonne chose que des préparatifs complets aient été faits pour soigner les blessés, car l'attaque allemande, l'avancée au-delà de la frontière russe, s'est déroulée tout autrement que ce qui était "prévu" dans cette "attaque surprise". Pourquoi ? On l'a vu le soir du 22 juin.
Le village de Janowka était traversé par des tranchées bien camouflées. Les murs des caves des maisons en rondins étaient aménagés en nids de mitrailleuses ou pourvus de meurtrières pour les tireurs d'élite. Comme le village se trouvait sur une colline, il dominait toute la bande frontalière. Ce village en particulier devait être pris.
A peine les régiments d'infanterie 303 et 314 étaient-ils sortis de la bande boisée qu'ils subissaient déjà leurs premières pertes, la plupart du temps des balles dans la tête. A 8 heures du matin, on ne s'était pas encore approché suffisamment près du village pour pouvoir tenter une attaque sans subir de lourdes pertes. Ce n'est que vers midi que le village a pu être pris grâce à un encerclement et à l'utilisation considérable de lance-flammes. Mais il fallait encore se battre pour chaque maison. Outre une cinquantaine de gardes-frontières russes (tireurs d'élite sibériens), la population civile polonaise est intervenue dans la bataille en tant que partisans. Le soldat sanitaire Heinz Köhn, arrivé au village avec la deuxième vague, voit une femme pointer son pistolet sur lui par une fenêtre : il tire immédiatement de son 08 et "fait mouche". Köhn avait rejoint l'équipe d'assault en tant que brancardier (avec un brassard de la Croix-Rouge) et disposait à ce titre d'un pistolet pour se défendre. Conformément aux lois de la guerre. Toutes les maisons d'où des civils avaient tiré ou dans lesquelles ils avaient été trouvés avec des armes à la main ont été immédiatement incendiées. Les civils qui se battaient ont été rassemblés et abattus. Une grande tuerie commença.
Alors qu'une grande partie du village brûlait, une troupe s'est dirigée vers l'église. Le clocher de l'église avait été bombardé par l'armée allemande et partiellement détruit afin de pouvoir l'utiliser comme point d'observation. Le sergent-major (Hauptfeldwebel) de l'IR 303 a ouvert le portail de l'église. A ce moment-là, une femme polonaise a tiré sur lui : il est mort sur le coup. Avec deux camarades, il a trouvé sa tombe à côté de l'église.
Lorsque le calme est enfin revenu en fin d'après-midi, on a trouvé 40 tireurs d'élite russes morts. Tous avaient d'excellents fusils : fusils automatiques à chargement rapide, chacun avec une lunette de visée ! (modèle 1941 made in USA !) D'où les pertes de nos régiments. Ces tireurs d'élite avaient arrêté deux régiments de notre division pendant près de 10 heures.
Chez nous, au HVP Biely Dom, dès 8 heures du matin, le flux des blessés passait par la tente d'opération, puis par les tentes des blessés. "Nous n'avons rien vu des Russes, nous étions déjà partis", nous ont raconté les blessés. Chez nous, c'est le chef de compagnie, le médecin-major (Kompanie-Chef Stabsarzt) Dr Oellerich, qui opérait. Comme nous travaillions presque en plein air, nous ne gardions que les cas les plus légers. Les blessures plus graves : Les amputations, les blessures au ventre et les lésions cérébrales étaient directement envoyées à l'hôpital de guerre de Lyck ; sur les excellentes routes goudronnées allemandes, cela ne posait aucun problème. Nous avons soigné et pansé la plupart des lacérations. et légères blessures osseuses. C'est ainsi que nous, l'équipe chirurgicale, avons soigné et pansé nos camarades de 8 heures du matin à 11 heures du soir. L'après-midi, notre groupe motorisé (Dr Meinert) se rendait à Janowka et y ouvrait un nouveau HVP pour que nous puissions démonter pendant la nuit. Chez nous, nous avons continuer, Sankra à Sankra, à décharger et soigner les blessés. Deux très graves cas n'étaient plus transportables et ont été placés dans une tente spéciale. Les deux blessés sont morts sur notre HVP. L'aumônier de guerre et notre sous-officier de succession (Nachlaßunteroffizier) ont fait sur eux les derniers devoirs.
La nuit, vers 1 heure, l'équipe chirurgicale avait fini d'emballer et de charger. A 2 heures, c'était le réveil pour la compagnie et le départ en direction de la frontière au lever du soleil. Directement au poste frontière de Janowka, nous sommes passés devant la première tombe de soldat : un pionnier du régiment 314, tombé il y a 24 heures.
Dans le village même, toute l'horreur de la destruction de la guerre : des décombres de maisons fumantes, en partie encore en feu, d'où les cheminées en briques s'élevaient vers le ciel comme des colonnes jaunes ; du bétail brûlé dans les granges, des Russes morts le long du chemin, souvent brûlés jusqu'à être méconnaissables par les lance-flammes. J'ai pris la moitié de la plaque d'identité d'un soldat allemand qui n'était plus reconnaissable qu'à son casque d'acier, sinon terriblement brûlé, et nous sommes partis l"enterrer dans un jardin. Nous sommes également passés devant la fosse commune de partisans civils abattus, au bord de laquelle se tenaient des femmes et des enfants en pleurs.
Je suis retourné à l'église. Seule la tour était criblée de balles. L'autel était encore décoré de pivoines pour l'office dominical d'hier, qui n'a probablement pas eu lieu. À côté de l'église, trois tombes de soldats allemands fraîches. Alors que nous avancions sur la route du village, à droite et à gauche : Des incendies et des destructions. Une odeur horrible et douceâtre de bétail brûlé et de maisons en bois régnait sur toute la région, jusqu'à ce que nous arrivions dans la forêt d'Augustowo. Tard dans la soirée, nous sommes entrés dans cette ville, mais nous n'avons eu qu'une courte nuit de repos, car dès 3 heures du matin, nous avons repris la route en direction de Grodno, derrière les montagnes.
Nous avons fait venir des unités motorisées pour ne pas perdre le contact. Car nous, la 2e section de la compagnie sanitaire, étions une unité tractée, avec deux chevaux par voiture ! Ce furent les premiers jours de plusieurs mois de marche vers l'est, vers la Russie. C'est ainsi que commença pour nous la mission "Barbarossa" d'Hitler, la campagne de Russie.
3 A propos des décorations : a) Croix du mérite de guerre IIe classe – Juillet 1941
Dans l'usage de la guerre, la croix en tant que symbole chrétien n'avait plus guère de relations avec son origine, hormis la Croix-Rouge, la Convention de Genève. Les croix de fer (de toutes les puissances) étaient généralement décernées à ceux qui, avec bravoure et un grand courage personnel, avaient détruit le plus grand nombre possible de vies humaines ou de matériel ennemi, pour le bien de la patrie, bien entendu : après tout, il valait mieux que les autres meurent plutôt que nous, car ce sont eux qui avaient commencé la guerre, les autres. Nous n'avons fait que défendre notre peau. C'est l'opinion officielle ! Lorsque notre chef de la compagnie sanitaire, le médecin- major Dr Oellerich, m'a épinglé la Croix de guerre II sur ma blouse à Wolkowysk en Pologne, je me suis senti étrange. Je n'avais encore jamais été "décoré" de ma vie. De plus, je ne savais pas pourquoi ni pour quoi. Certains officiers et sous- officiers de la compagnie avaient déjà reçu le KVK II l'année dernière. Le chef a parlé avec beaucoup de reconnaissance de l'accomplissement du devoir en HVP et ainsi de suite, mais cela s'appliquait à mon avis tout autant aux autres camarades de l'équipe du bloc opératoire. Seulement, j'étais déjà instrumentiste au bloc opératoire depuis la campagne de France de 1940 et, en tant que tel, responsable de l'ensemble du matériel et du bon fonctionnement de l'équipe. (Après la guerre, on m'a souvent demandé pourquoi j'étais venu au service sanitaire. Je répondais alors : un travail manuel appris, avec des doigts habiles, serait parfois bien utile !). D'ailleurs, j'ai fait le même travail au bloc opératoire en tant que caporal, sous-officier et sergent.
Lorsque j'ai reçu le KVK II, en juillet 1941, nous étions à Volkowysk, une ville de l'est de la Pologne, devenue la Russie occidentale en 1939, après la guerre de Pologne. L'Allemagne a pris le reste de la Pologne comme "gouvernement général". En 1939, les Soviétiques n'avaient rien de plus urgent à faire que de donner au "peuple polonais hautement réjoui" les bienfaits de la U.d.S.S.R., à savoir : Système de parti unique, GPU-Keller (Sowjetische Geheimpolizei) , bâtiments de parti somptueux et " parcs populaires" avec des statues en plâtre de Lénine et de Staline, plus grandes que nature. Nous avons également trouvé tous ces "monuments culturels" impressionnants à Volkowysk. Mais en plus, et c'était beaucoup plus important pour nous en tant qu'unité sanitaire, un parc sanitaire russe richement équipé, c'est-à-dire : d'énormes quantités d'excellent matériel sanitaire, en partie d'origine américaine, à en juger par les impressions. Nous avons par exemple trouvé 20 grands ports de verre d'iode métallique. On comprend mieux la valeur que cela représente quand on sait qu'une cuillère à café d'iode métallique dissoute dans de l'alcool à 96% donne une bouteille d'un litre de teinture d'iode à haut pourcentage. Notre compagnie sanitaire a bien profité de cette réserve jusqu'en 1944 ; à cette époque, les autres compagnies utilisaient déjà depuis longtemps un substitut d'iode rougeâtre.
Notre 2e section avait ouvert début juillet un hôpital local à Volkowysk, dans une aile de l'hôpital russe. "ГОСПИТАЛЬ"7 . Nous y avons soigné non seulement nos blessés allemands, mais aussi environ 70 Polonais. Des civils qui, lors de la prise de la ville, avaient parfois été gravement blessés par des tirs d'aviation et d'artillerie. Les médecins juifs de l'hôpital avaient - de manière compréhensible - pris la fuite à l'approche des Allemands. C'est pourquoi des dizaines de cas graves étaient restés sans soins pendant plusieurs jours. Nous avons soigné, opéré et pansé tous ces gens impuissants avec leurs blessures infectes et infectées. Nous avons également procédé à des amputations supplémentaires là où cela s'avérait nécessaire pour éviter une septicémie généralisée. Nous avions heureusement beaucoup de matériel de pansement. La gratitude touchante des civils polonais a eu un bon écho dans la ville : "Pan docteur" ici. "Dzen kuje (merci), Pan Doktor". j'ai une solide pratique de tous les types d'injections : sous-cutanées, interglutéales, intramusculaires et même intraveineuses (ce qui était normalement réservé aux médecins "qualifiés"). Après 14 jours de travail à Vol-kowysk, nous sommes partis vers l'est. Mais le front s'est rapidement déplacé de plus en plus vers l'est et nous avons dû faire la jonction avec nos unités motorisées.
4 L'attaque de notre bloc opératoire dans le village de Stara Dorogi – 29 juillet 1941
C'est un été chaud. Nous avons notre emplacement HVP avancé dans le village de Stara Dorogi, sur le seul chemin de plusieurs kilomètres à travers les marais. C'est une digue en remblai qui traverse le terrain marécageux. C'est une zone immense. A droite et à gauche de la route se trouvaient des troupes russes dispersées, on le savait. A chaque instant, la route était barrée par des troupes russes, des colonnes allemandes étaient mitraillées, attaquées et brûlées ; des véhicules brûlées gisaient en tas à gauche et à droite du chemin dans le fossé.
Le village de Stara Dorogi se trouvait sur une hauteur dans les marais à environ 20 kilomètres de Bobruisk. Dans ce village, notre 1ère section devait, selon les ordres, établir un HVP avancé pour soigner les blessés renvoyés par la digue de Bobruisk. C'était le 29 juillet 1941. Depuis dix heures, nous travaillions à notre HVP sans interruption. L'après-midi, le village fut envahi par des troupes russes dispersés qui attaquaient. Pour sécuriser le village et notre HVP, seules deux sections d'un escadron cycliste se trouvaient en périphérie. Les Russes ont attaqué la périphérie du village. Le médecin-assistant Meinert (Assistenzarzt), le seul officier et médecin, a téléphoné à l'état- major de la division pour demander de l'aide. Mais au bout de quelques minutes, il n'y avait déjà plus de liaison téléphonique, le câble ayant certainement été coupé par des partisans à l'ouest. Entre-temps, la pression des tirs d'infanterie russes à l'est était devenue si forte que l'escadron cycliste avait dû reculer jusqu'au centre du village, jusqu'à la colline de l'église. Le Dr Meinert a fait répartir les blessés transportables sur toutes les lignes.
Le Dr Meinert a fait charger les blessés transportables sur tous les véhicules propres et blindés disponibles et les a emmenés à 2 kilomètres de là. Mais il y avait quelques blessés très graves dans l'église, qu'on ne pouvait pas déplacer sans mettre leur vie en danger. C'est pourquoi le médecin-major (Stabsarzt) a laissé notre équipe de mitrailleuses (6 hommes au total), formée à l'autodéfense, à l'escadron cycliste qui s'était installé à proximité de l'église, à environ 100 mètres à l'est, à la limite sud du village. Notre groupe de mitrailleuses était composé du caporal sanitaire Hans Kosinski (MG-Schütze 1), d'Eugen Hagen et d'un troisième. Ils ont pris position avec leur mitrailleuse le long du mur de l'église. Kriehel, Köhn et Hohnberg ont été affectés à une section de l'escadron cycliste. D'ailleurs, le drapeau de la Croix- Rouge était placé sur la tour de l'église, visible de loin, et des panneaux de notre HVP étaient également fixés sur le mur de l'église (à l'époque, en 1941, nous le faisions encore !). Il y a huit jours seulement, ils avaient repris un poste de secours principal allemand au nord de Bobruisk, dont les Russes avaient tué ou enlevé tout le personnel et assassiné les blessés.
Une lettre originale d'Alexander Kern a été conservée à ce sujet :
Russie 31. 7. 1941
Ma chère mère !
Après de longues journées de marche, j'ai enfin reçu du courrier hier. Et il y avait trois messages de toi. Deux "conseils" sur les gâteaux et la jolie petite lettre de Vogler. Je te remercie beaucoup pour toutes tes salutations. Seul un morceau du gâteau était déjà moisi, l'autre était encore bon à manger et on ne jette pas si facilement un gâteau quand on ne reçoit que du pain de mie pendant des mois ! Je suis très heureux que tu te sois reposé à Damen, et j'espère que tu as passé de bons jours à Lauenburg auprès de ma petite femme, qui t'a certainement rendu la vie très agréable. Maintenant, tu seras de retour à la maison et le travail t'attendra. J'espère seulement que les Anglais vous laisseront tranquilles la nuit. A Damen, tu étais si bien loin de l'ennemi et surtout chez moi.
La semaine dernière, nous avons à nouveau avancé à grands pas vers l'est et nous ne nous arrêterons pas ici avant que le Russe ne soit complètement détruit. En ce moment, nous sommes de nouveau engagés dans un chaudron.
Le Russe est un soldat très méchant. Il ne fait presque pas de prisonniers. On a observé à la jumelle (Scherenfernrohr) qu'il ont transpercés des prisonniers allemands par derrière à la baïonnette. Pas un seul cas, des dizaines, et ce ici, à quelques kilomètres de chez nous. Les Russes ont fixé des prix de 500 roubles par tête pour les SS. Mais tout cela sera récompensé !
Je te salue chaleureusement pour aujourd'hui, ton alex (Dein Zander, diminutif de Alexander).
PS . La grande carte de journal est très bien, la mienne ne s'étend pas aussi loin vers l'est, loin de là. Elle me sera bien utile !
La version d'Alexander Kern de cet incident est tirée de la version de travail des Mémoires :
Dans les marais de Prijpet, entre Slonim et Beresi- na/Bobruisk, nous avons observé que des blessés allemands, allongés sur des brancards et attendant d'être évacués par des sankras, et dont la place du village avait été envahie par l'infanterie russe, avaient été poignardés par ces derniers avec des baïonnettes russes triangulaires et minces = fixées sur les canons des fusils. Peu de temps après, l'infanterie allemande chassa à nouveau les Russes et trouva les blessés allemands assassinés dans le village reconquis. C'est par autoprotection que nous, le HVP, avons rapidement cessé de déployer des drapeaux de la Croix-Rouge en Russie, car ils étaient visibles. Ce traitement inhumain des blessés et du personnel sanitaire, médecins et gradés du service sanitaire, était déjà connu lors de la campagne de Pologne en septembre 1939 : A l'époque, tout le personnel sanitaire n'était pas armé, conformément à la Convention de Genève. Ensuite, il est arrivé en Pologne que plusieurs compagnies sanitaires aient été fusillées par l'armée polonaise, avec les blessés qu'elles soignaient. Cette perte de personnel sanitaire formé depuis des années était si considérable que les Allemands ont immédiatement formé de nouvelles compagnies sanitaires, ce qui représentait au moins six mois de temps (formation pour les grades inférieurs). C'est sans doute la seule raison pour laquelle j'ai été incorporé comme recrue dans la section de remplacement sanitaire de Stettin-Wendorf en décembre 39. Pendant la campagne de Russie, toutes les compagnies sanitaires étaient armées de pistolets, de fusils, de MP et de MG pour l'autodéfense du HVP.
C'est pourquoi, ici à Stara Dorogi, nous avons dû défendre de toutes nos forces les blessés dans l'église. Deux attaques d'infanterie ont été repoussées par l'escadron cycliste. Mais dans l'après-midi, vers 16 heures, une large troupe de 40 cosaques a fait irruption dans le village par l'est et a tenté de déborder les Allemands.
Les Cosaques s'avancent en pleine chasse, sabre au clair, sur de petits chevaux puissants, à 200 mètres de la position des cyclistes. Celle-ci intensifie ses tirs de mitrailleuse et de fusil. C'est alors que leur mitrailleuse tombe en panne au moment le plus important. Les Cosaques, à peine décimés, avancent. Le lieutenant ordonne alors à l'escadron de cyclistes de se déplacer vers le sud afin de libérer le champ de tir pour notre mitrailleuse à l'église. Pendant le mouvement d'évitement, les Cosaques sont encore au-dessus de l'escadron cycliste. Combat rapproché. Trois de nos soldats sanitaires se tiennent près des cyclistes. Erich Hohnberg se fait arracher la carabine des mains (il se met les mains devant le visage), alors un énorme cosaque surgit devant lui et frappe le bras de Hohnberg d'en haut avec son sabre, lui transperçant les deux avant-bras d'un terrible coup de sabre. Sur le côté de Hohnberg, Rolf Köhn est à l'abri derrière un rempart et peut immédiatement abattre le cosaque avec sa PM.
À ce moment-là, l'Ari allemande intervient et saupoudre le terrain forestier.
Après avoir débordé les derniers hommes de l'escadron cycliste, les Cosaques sont à 80 mètres de l'église lorsque Kosinski utilise sa mitrailleuse, installée en bonne couverture. Tandis qu'autour de lui et d'Eugen Hagen, les impacts des Russes s'abattent sur le mur de l'église, Kosi "s'entête" (comme le dit Eugen) à tenir sans arrêt les Cosaques de gauche à droite, de droite à gauche, dans un sens et dans l'autre. Il n'a qu'une vieille mitrailleuse, 08/15 de la Première Guerre mondiale, refroidissement par eau, mais elle fait son devoir.
Eugen Hagen nous a raconté plus tard qu'il avait admiré le calme et la ténacité de Kosi : "Je peux vous dire, têtu, comme au champ de tir de Varsovie-Rembertow en 1940 (où l'on avait tiré 1x à la mitrailleuse sur des cibles pour l'exercice), quand nous avons eu pour la première fois une telle mitrailleuse en main".
Les cosaques ont été accueillis par notre tireur MG et au vue des pertes, ont rapidement disparu dans les marais en emportant leurs blessés.
Nos blessés graves dans l'église du village avaient été sauvés : Rien n'avait traversé l'épais mur. Avant la tombée de la nuit, des renforts de la division sont venus sécuriser le village de tous les côtés ; notre bloc opératoire a repris son travail. Parmi nos hommes, le soldat sanitaire Erich Hohnberg a été grièvement blessé et deux autres ont été bléssés par balle.
5 HVP Lopatkina près de Smolensk – Septembre 1941
Avant le chaudron de la bataille d'encerclement de Viazma et Briansk. Nous avons installé notre bloc opératoire dans une ferme de la banlieue. Premières gelées ; la première neige est tombée dès le début du mois de septembre ; cela nous obligé à chauffer pour les blessés, surtout dans la salle d'opération, où les blessés doivent souvent être soignés à peine vêtus. Les Russes dans le chaudron nous font régulièrement quelques salves d'Ari le matin vers 11 heures.
Pendant la journée, il y a peu de blessés, les avions de combat rouges et les rata (chasseurs) sont assez nombreux au-dessus de nous. Sur nos côtés, dans la forêt, la Flak de l'armée de terre est déployée, elle intervient avec zèle, mais sans grand succès. Peut-être que l'Ari russe vise ces batteries lorsqu'elle nous tire dessus.
Le plus grand nombre de blessés arrive la nuit. J'ai terminé la stérilisation des instruments médicaux et je suis assis à la fenêtre ; devant moi, un carnet de notes que j'ai acheté à Varsovie sur Uliza Krakowskaja. J'écris des notes, une phrase de motet polyphonique à trois voix sur le choral : "Nun lob, mein Seel, den Herren". Je travaille actuellement sur la ligne "- errett' dein ("sauve ta")
Nous sommes en train de vivre une "pauvre vie" lorsque, à 50 mètres à droite de la ferme russe en rondins dans laquelle est installée notre salle d'opération, le premier coup d'ari nous tombe dessus.
Sur la deuxième page de la cantate, Kern note en haut à droite avec une étoile le moment de l'attaque. Dans la marge, il note : "Lopatkina, 27. 9., 16h00 - En écrivant cette phrase, un obus explosif de 15 cm crève à 20 m de notre bloc. Les éclats traversent les murs de bois, nous disparaissons dans l'abri".
Je suis en train de me demander si je dois disparaître dans l'abri souterrain à côté de la maison avec mes collègues chirurgiens, quand le deuxième impact arrive près de la fenêtre où j'étais assis il y a quelques minutes. Au hurlement de l'obus, je suis déjà à plat ventre sur le sol. Les éclats de la grenade de 15 cm s'écrasent sur le mur en bois à côté de moi. Sous l'effet de l'explosion, la fenêtre et son cadre sont arrachés du mur et me tombent dessus. Heureusement, les murs de la ferme sont faits de 35-40 centimètre d'épaisseur. Au moment de l'impact, je sens quelque chose de chaud passer devant ma main droite. C'est un éclat d'obus de 20 centimètres de long, que j'ai retrouvé plus tard, planté dans le pied de la table. Il est a traversé la poutre en bois sous la violence de l'explosion et est passé à quelques centimètres de ma main. Je m'imagine à quoi aurais pus ressembler ma main ! Chaque nuit, je vois de telles blessures, souvent la main est irrécupérable et doit être amputée. Cet éclat d'obus est passé à côté de ma main. Une coïncidence ? Nous ne croyons pas au "hasard aveugle" ! Après avoir remis de l'ordre dans le bloc opératoire et posé une autre fenêtre, j'ai continué à écrire la ligne après l'attaque par le feu : "- sauve ta pauvre vie".
J'ai ramené l'éclat d'obus plus tard, en vacances, à Lauenburg en Poméranie, pour avoir comme un commentaire tangible de cette ligne de choral.
An Frau Marie Kern Itzehoe/Holstein
Lessingstr. 7
Absender: San.Gefr. Kern
Feldpostnummer 30617
(imprimer sur la carte postale de campagne :)
"Le peuple allemand est conscient qu'il est appelé à sauver l'ensemble du monde culturel des dangers mortels du bolchevisme et à ouvrir la voie à une véritable ascension sociale en Europe". (Extrait de la note adressée au gouvernement soviétique)
Ssinzovo Russie 18. 11.41
Chère maman !
Je te remercie pour les deux gentils paquets qui me sont parvenus récemment pendant la marche. Nous avons à nouveau du travail jour et nuit sur des camarades blessés, l'attaque avance bien et notre objectif est maintenant conquis. On dit que nous allons bientôt prendre nos quartiers d'hiver. Malheureusement, nous avons perdu un camarade dans la compagnie à cause de l'explosion d'une mine. Les Russes préfèrent poser les mines dans les granges, devant les puits, dans les églises, etc. C'est ainsi que de nombreux camarades perdent la vie ou la santé.
Je vous salue maintenant, ainsi que Leusch (surnom de la sœur d'Alexandre, Elisabeth), que je remercie tout particulièrement pour sa salutation, en ce temps de l'Avent.
Ton Alex (Dein Zander)
6 HVP Beresnjaki près de Kalinin – Décembre 1941
Il est 9 heures du matin. Fatigués à en crever, totalement épuisés, nous sommes allongés dans une chaumière russe crasseuse. Le soleil pâle sort à peine des nuages de neige, rouge sang. Nous avons marché toute la nuit, par -30°, sur des chemins verglacés, contre le vent d'est glacial, dont nous nous cachons de temps en temps derrière les voitures à cheval pour avoir un peu d'abri. Les derniers kilomètres n'étaient plus qu'une succession de titubations, d'efforts convulsifs pour ne pas rester en arrière, ne pas perdre le contact avec la colonne de marche et se retrouver seul dans l'immensité du désert de neige. Dans le froid particulièrement vif qui régnait juste avant le lever du soleil, après 9 heures et demie de marche, des façades de maisons noires enneigées émergent enfin du crépuscule. Sur un panneau indicateur russe - curieusement resté en place - je déchiffre "БЕРЕЗНЯКИ" = Beresnjaki, c'est notre destination, notre gîte. Nous sommes ici au sud de Kalinin, juste avant les barrages de Kalinin, à 80 kilomètres au nord-ouest de Moscou. Notre 262e ID avait reçu l'ordre de s'emparer fin novembre de ces importants barrages, qui fournissaient un pourcentage considérable du courant de Moscou. Tout cela dans le cadre de l'avancée forcée : faire en sorte que Moscou soit aux mains des Allemands avant l'hiver. Les régiments 303 et 314 - c'est- à-dire les restes de notre armée exsangue, engagée depuis juin - ont été envoyés en renfort. Les régiments, qui n'étaient pas complètement remplis, devaient réussir cette mission difficile. Notez bien : sans vêtements d'hiver ! Fin novembre, nous avons rencontré un bataillon de ravitaillement en marche : sans vêtements d'hiver. Les carabines - parfois encore sans lanières - devaient être portées à main nue. Pas de gants ; à la place, les soldats avaient mis des chaussettes de la Wehrmacht sur leurs mains ; - 20° à -30° de froid et 30 kilomètres de marche par jour. Ce bataillon de ravitaillement venait directement du lieu de déploiement de la réserve, directement de la garnison ; ces soldats n'étaient donc pas, comme la troupe engagée depuis juin, lentement habitués au climat russe. Un tiers de ces troupes de remplacement n'est pas du tout intervenu sur le front. Des engelures massives aux doigts et aux orteils ont été les conséquences de cet envoi précipité. Bien avant l'intervention, ils étaient décimés, notamment en raison de l'insuffisance de la nourriture et des efforts fournis pendant des semaines de Marches.
Après la conquête de la ligne Kalinin-Klin (fin novembre), toutes les conditions n'étaient pas réunies pour construire une ligne de combat principale stable. Une ligne de combat principale a néanmoins été construite sur le papier. Mais à quoi ressemblait-elle en réalité ? Début décembre, le sol était gelé sur une profondeur de plusieurs mètres. Les mitrailleuses et les tireurs étaient donc à découvert sur le sol plat. Les blessés qui arrivaient par centaines sur notre HVP Beresnjaki parlaient un langage cru !
A 9 heures, nous étions arrivés au village, morts de fatigue. La division nous avait déjà donné l'ordre d'être prêts à 12 heures avec notre bloc opératoire. Il n'était donc pas question de dormir et de se reposer. Le pré-commandement avait désigné une maison en bois spacieuse comme salle d'opération et les maisons environnantes comme salles pour les blessés, dont une école pouvant accueillir environ 70 blessés (plus tard, nous y avons logé 120 blessés). La troupe était logée dans les maisons plus éloignées. Aucune possibilité de dormir n'était prévue pour l'équipe chirurgicale. Nous ne devions pas non plus être nombreux. Arno Mokroß, Eddi Dallmann, Fritz Heise, Fritz Lessenthin et Herbert Dieckhoff, c'était notre équipe chirurgicale restreinte.
Nous avons d'abord nettoyé à fond la salle d'opération prévue. Nous avons enlevé la saleté et les toiles d'araignée vieilles de plusieurs dizaines d'années des coins et du plafond, et avons retiré l'icône sale du "coin des saints", ce qui a suscité une grande désapprobation chez les résidents qui devaient désormais camper dans la grange. J'ai préparé la plus grande table comme table à instruments, pour étaler les couverts stérilisés, une autre pour les pansements, une pour les médicaments et le sérum.
Nous déchargeons nos chariots chirurgicaux : le four de stérilisation reçoit son coin, mis en marche par Dieckhoff avec un brûleur à pression d'essence. Son ronronnement ne s'arrêtera plus pendant les jours et les nuits à venir. La table d'opération est placée à l'endroit le plus accessible de la pièce, afin que les blessés puissent être facilement soulevés de la civière. A gauche et à droite de la table d'opération, deux grandes lampes alimentées par un groupe électrogène (ou de grosses batteries). Au bout de la table d'opération, Arno a une petite table avec les instruments d'anesthésie. Sur un long banc en bois près de la porte se trouvent de grandes cuvettes de lavage, la dernière avec une solution de Sagrotan forte pour l'opérateur (chirurgien), l'assistant et l'instrumentiste. Il y a également un désinfectant, du linge pour les blessés et deux assistants (unsterile Helfer).
Il faut également avoir à portée de main une boîte supplémentaire de comprimés et une autre contenant 20 pommades différentes. Pour un HVP "avancé" il faut une multitude d'objets individuels qui doivent être prêts à tout moment ; souvent, la vie du blessé dépend de la rapidité des soins.
Une fois que les instruments les plus importants ont été ébouillantés (solution de soude), que j'ai choisis parmi le matériel principal et le matériel de collection, je pose sur les tables des couvertures et, par-dessus, des toiles stériles, sur lesquelles je range les instruments par type et je recouvre à nouveau le tout de toiles. Des pinces sont fixées aux extrémités des draps stériles, ce qui permet d'atteindre les instruments sans toucher la table ni le drap.
Entre-temps, les soignants ont également préparé leurs locaux pour l'accueil avec beaucoup de paille, des couvertures et la vaisselle nécessaire. Bien sûr, les locaux des blessés doivent aussi être chauffés. Ce n'est qu'à ce moment- là que le médecin-chef de section est informé que nous sommes prêts à accueillir les blessés et que les panneaux de signalisation que nous emportons toujours avec nous sont placés aux entrées du village; "Hauptverbandplatz".
Un grand panneau rouge et blanc, généralement cloué à un arbre, est apposé sur la maison d'opération elle-même. Les premiers sankras arrivent déjà du front, assez proche ici ; il y a à peine 3 kilomètres jusqu'à la ligne de combat principale.
Celui qui ne l'a pas vu lui-même ne peut pas se faire une idée du flux de misère et de douleur qui passe par un tel poste de secours principal. Outre les trois degrés de gelures, il n'y a pas un seul membre du corps qui ne soit pas blessé par des éclats d'obus, des mines, des bombes d'aviation ou des balles d'infanterie. - Tout d'abord, chaque blessé reçoit 5 centimètres cubes de sérum antitétanique (contre le tétanos). Les plaies cutanées légères sont nettoyées et désinfectées avec une solution de rivanol ; souvent, les bords de la plaie sont également raccourcis dans une brève ivresse de chloréthyle afin de préparer une guérison plus rapide. Les bords de la plaie, généralement dentelés, sont lissés à l'aide d'un scalpel, de pincettes et de ciseaux (excision de la plaie). Ces blessés légers, surtout s'ils sont capables de marcher, sont hébergés dans des salles pour blessés plus éloignées, où ils peuvent d'abord dormir au chaud en mangeant bien, car ils sont généralement vidés jusqu'à la moelle.
Mais d'abord, les cas graves passent avant l'art : blessés, auxquels le médecin de troupe a posé un garrot lorsqu'un gros vaisseau (artère sanguine) était blessé, et qu'il y avait un risque d'hémorragie. Le garrot en caoutchouc est placé au-dessus de la blessure. Sur la fiche rouge et blanche du blessé figure alors la mention : "A soigner immédiatement, le garrot est en place depuis ... heures". Ceci est important, car si le garrot reste trop longtemps en place, le membre peut se nécroser.
Souvent, le blessé a été transporté pendant longtemps sur des chemins cahoteux, il a été bousculé et secoué, et il est maintenant à bout de forces à cause de la douleur, de la perte de sang et du froid. Pour renforcer le cœur, je commence par administrer du Cardiazol par voie sous-cutanée. Ensuite, le blessé est soulevé sur la table d'opération. Cette mise en place est difficile, car elle doit se faire de manière à ce que le blessé souffre le moins possible : Tout d'abord, deux porteurs soulèvent la civière jusqu'à la hauteur de la table d'opération, puis trois autres assistants passent la main sous la tête, le dos et la hanche, un autre tient et porte le membre blessé avec le garrot. Ensuite, la jambe (ou le bras) est débarrassée des restes de vêtement déchirés et sanguinolents et nettoyée à l'eau chaude. Au-dessus du garrot, on fait une saignée à l'aide d'un tuyau en caoutchouc, on desserre le garrot et on l'enlève ; on déroule ou on coupe l'épais bandage. Tout cela se fait en quelques instants.
Il en résulte que le bras est totalement brisé, de larges parties des muscles et des vaisseaux sanguins sont détruits. Si l'on laisse une telle blessure dans cet état, le blessé mourra rapidement d'une infection de la plaie, d'une septicémie. Le chirurgien décide donc de procéder à une amputation. De telles blessures graves se produisent très souvent dans une journée ; l'amputation permet alors de créer des conditions de plaie propres, favorables à la guérison. Quelle responsabilité pour un chirurgien de décider s'il faut sauver le bras ou la jambe, ou si seule l'amputation peut sauver la vie du blessé.
Il y a un jeune soldat sur la table d'opération - selon le livret militaire : fils de paysan du Mecklembourg, 19 ans, mobilisé depuis avril de cette année, ici en Russie depuis 14 jours et maintenant estropié à vie. Ou un autre, bachelier de 18 ans originaire de Stettin, dont la main droite et le pied ont été si gravement écrasés par l'explosion d'une mine qu'il faut l'amputer des deux membres, doit-il rester en vie ? Il ne cesse de demander au médecin-major : "Monsieur le médecin-major, dois-je mourir maintenant ? Je n'ai encore rien vécu, juste après l'école (baccalauréat d'urgence), j'ai fait le service du travail obligatoire, puis la Wehrmacht, où j'ai suivi une courte formation et été envoyé en Russie. Je n'ai pas encore vécu, Monsieur le médecin-major".
Quelle tâche incombe alors à un homme fin et bon, si le médecin-major en est un, et avec quelle cruauté inhumaine, dans de tels moments, une réponse dure et cynique peut aussi blesser l'âme d'un tel garçon, pire que ne l'a fait la mine. Heureusement, nous avions à Beresnjaki un médecin-major particulièrement humain, dont la présence et la sécurité suffisaient à nous rassurer.
J'ai vécu l'inverse en été 1941, sur une HVP dans les marais de Pripjets, devant Bobruisk. Le médecin traitant s'est approché d'un blessé dont la jambe était criblée de dizaines de petits éclats de mines, que le médecin a enlevé avec un gros coton dégoulinant d'iode. "(une manipulation très douloureuse !): "Ne faites pas le malin, vous allez pouvoir tenir encore un peu" ! Nous, les assistants qui nous entouraient, avons échangé des regards éloquents. Le blessé tourmenté, qui serrait vraiment les dents, répondit alors : "Celui qui me dit des choses pareilles dans cet état, je lui souhaite les mêmes douleurs !" Ce à quoi le médecin-major répondit, furieux, rouge de colère : "Taisez-vous, vous n'avez absolument rien à dire ici, je vais vous dénoncer à la troupe pour que vous soyez punis". Le médecin s'appelait Meinert ; nous disions toujours qu'il manquait un préfixe à son nom.
Ce genre de choses ne s'est certainement pas produit uniquement sur une HVP. C'est d'autant plus triste quand l'art médical s'associe à l'infériorité humaine. Il n'est pas étonnant que les unités sanitaires aient été condamnées en bloc sur la base de telles exceptions.
Mais revenons à Beresnjaki : parfois, les blessures semblaient mineures en apparence. Ainsi, deux blessés ont été amenés à Beresnjaki en position couchée, chacun n'ayant qu'un pansement sur le dos. Nous avons examiné les blessures : des éclats d'obus de la taille d'un petit pois sur la colonne vertébrale. Mais cet endroit était en danger de mort. Le nerf principal était blessé, il y avait des paralysies transversales, c'est-à-dire que toute la partie inférieure du corps était paralysée. Les deux blessés sont morts au bout de quelques jours la HVP.
Les blessures au cerveau sont également imprévisibles. Un blessé est arrivé à pied dans notre bloc opératoire avec un bandage sur la tête. Il avait une éraflure très fine mais profonde, probablement due à un petit éclat d'obus. Cette blessure s'est refermée en quelques jours. Malgré cela, le blessé devait rester couché sur le dos pendant 20 jours : c'était l'ordre du médecin. Le blessé insistait sur le fait qu'il se sentait en parfaite santé ; un jour, il s'est rendu sans autorisation aux latrines de la ferme : et est soudain tombé raide mort. Le cerveau était blessé et un caillot de sang s'était formé dans la circulation sanguine principale.
Les lésions cérébrales importantes n'étaient généralement traitées qu'à l'hôpital militaire. Les blessures thoraciques sont immédiatement soigné par le médecin-major. Dans un premier temps, les orifices de tir ont été fermés à l'air libre à l'aide d'un pansement hermétique, ce qui a permis de créer des conditions de pression plus ou moins normales. Mais souvent, il fallait couvrir d'énormes projectiles. Ces blessés ne passaient que rarement. Ces blessures étaient causées par des balles perdues ou par des "obus dum-dum". Les balles dum-dum sont des cartouches de fusil d'infanterie dont la pointe a été limée afin de provoquer des blessures plus importantes. De tels projectiles sont interdits au niveau international par les dispositions de la Convention de Genève. Je me souviens cependant d'avoir soigné un lieutenant pendant la campagne de France en 1940 à Verdun, qui avait été blessé par un tel projectile dum-dum : l'impact avait la taille normale d'une cartouche, le rejet dans le dos était de la largeur d'une main ; le projectile avait emporté la moitié de l'omoplate.
De plus, en juin 1940, lors d'une marche à travers la France, nous avons trouvé dans le fossé près de Nancy une caisse entière de munitions pour fusil français avec des cartouches dum-dum fabriquées en usine, portant le cachet de fabrication à l'extérieur de l'emballage ! "Voilà l'humanité de la grande nation !"
Les blessures les plus graves sont les blessures abdominales : elles doivent toutes être impérativement opérées sur le champ de bataille principal. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, le pourcentage de décès était encore très élevé (de l'ordre de 85 à 90 %), selon les indications du Dr Bügge : Même un petit éclat d'obus peut causer de grandes destructions dans l'abdomen. L'opération d'une telle blessure à l'abdomen exige du chirurgien 2 à 3 heures de travail manuel et intellectuel intensif. Souvent, lors d'une blessure par balle, il faut suturer 12 à 16 trous dans l'intestin, avec du catgut et de la soie, 3 fois ! Et si un seul petit trou est négligé, une péritonite s'installe inévitablement, ce qui signifie généralement la fin. Dès l'ouverture de la cavité abdominale, une vague de sang vient à la rencontre du chirurgien. Si le blessé supporte la longue anesthésie et l'opération, nous devons souvent faire des transfusions sanguines en même temps. Ensuite, il est placé dans une salle particulièrement calme. Pendant trois jours, il ne reçoit rien d'autre qu'un peu de thé non sucré. Des agents circulatoires (Sympatol) et cardiaques (Cardiazol) sont régulièrement injectés par voie sous-cutanée, en alternance. C'est ainsi que nous avons pu sauver certains cas graves.
Mais il arrivait souvent qu'après trois ou quatre heures de travail acharné du médecin et de ses assistants, le cœur du blessé lâche et que la vie s'éteigne encore sur la table d'opération. Le Dr Bügge, notre médecin-major, était alors toujours très abattu lorsqu'il devait constater les limites de son grand savoir-faire.
Les blessés étaient traités sur notre HVP, en fonction de la gravité de chaque cas. Il arrivait qu'un capitaine légèrement blessé doive attendre alors qu'un tireur grièvement blessé se trouvait sur la table d'opération. Seul l'homme comptait alors, pas le grade militaire. Sur des dizaines de blessés d'autres nations : Russes, Français, Anglais et Américains, nous avons souvent effectué de grandes opérations au cours des années de guerre. Chez le Dr Bügge, il n'y avait pas de considération de personne = pour lui, chaque blessé (grave) était un être humain qui avait besoin d'aide, qu'il soit allemand ou prisonnier, et c'est donc lui qui était soigné en premier.
Ainsi, le flot des blessés qui n'avais pas cesser depuis le 5 décembre, s'arrêta aussi à Berezniaki. Les salles des blessés ont vite été surpeuplées. Nous avons dû évacuer au plus vite vers l'hôpital de campagne de Pouchkino afin de faire de la place pour les nombreux nouveaux arrivants. De nouvelles salles pour les blessés ont été aménagées. La troisième nuit, nous avons manqué d'éther anesthésique ; la pharmacie de la division était également épuisée. Nous avons alors reçu suffisamment d'anesthésiques par avion depuis Smolensk.
Pour moi, il y avait une grande difficulté : l'approvisionnement en vêtements chirurgicaux stériles et en linge de salle d'opération pour toutes les grandes opérations qui étaient faites jour et nuit. En tant qu'instrumentiste, j'étais responsable de ces choses. J'avais engagé quatre femmes russes qui lavaient jour et nuit dans le village les draps chirurgicaux et les blouses des médecins, souvent très imbibés de sang. Mais comment faire sécher le linge ? A l'extérieur, le linge gelait en dix minutes et se transformait en planches dures. J'étais donc souvent obligé de stériliser les draps encore humides, et les médecins devaient travailler dans le linge humide. Dans de nombreux cas, les gants en caoutchouc n'étaient lavés que dans une solution de Sagrotan, puis on continuait à opérer avec. Les instruments qui étaient utilisés jour et nuit sans interruption ne sortaient plus du cuiseur. La plupart du temps, je les sortais de l'eau bouillante et les déposais directement sur ma table d'instruments (avec des pinces à grains !). De temps en temps, nous faisions une petite pause pour boire du café fort; les médecins et moi étions "nourris", car nous ne pouvions pas compromettre la stérilité des gants, ce qui aurait nécessité un nouveau lavage (15 minutes). Ainsi, l'opération s'est déroulée du 5 au 7 décembre = 56 heures sans dormir.
C'est alors que le 7 décembre au soir, des nouvelles alarmantes arrivent du front : Les Russes attaquent, les Russes percent ! Klin est déjà conquis et Kalinin est menacé ! Nous avons environ 300 blessés dans le village, à 3 kilomètres de la ligne principale de combat. Un appel de la division arrive : évacuer immédiatement tous les blessés vers Puschkino. Trois sankras pouvant accueillir 12 personnes couchées ou 36 personnes assises sont disponibles à cet effet. L'hôpital de campagne de Pouchkino est à 25 kilomètres. Nous évacuons en permanence, mais le nombre de blessés ne diminue pas, car il y en a toujours de nouveaux qui arrivent.
Autre message d'alerte : avec des chars et des troupes de ski, les Russes ont fait une percée au sud de Kalinin. Selon les informations, ils se trouvent maintenant à notre nord, au nord dede Berezniaki : Aucun des sankras envoyés ne revient de Pouchkino.
Notre adjudant-chef (Hauptfeldwebel) se place au milieu de la route du village et essaie de récupéré des camions vides afin de charger des blessés. Ou bien ces voitures s'enfuient-elles déjà ? Oui, nous commençons à comprendre : c'est la fuite. Notre adjudant-chef ne reçoit guère de réponses à ses questions, il manque même de se faire écraser. Le commandant de la compagnie fait alors arrêter chaque voiture qui arrive de l'avant par un officier (médecin- chef) accompagné de deux gardes armés, le revolver à la main. De cette manière, on parvient à faire monter des blessés dans chaque camion vide, qui sont sommairement enveloppés dans des couvertures. Tous nos véhicules motorisés sont en état de marche, mais sans une goutte d'essence. Cela fait quatre jours qu'il n'y a plus d'essence. Nous avons encore 150 blessés dans le village. Dans la nuit du 8 décembre, nous continuons à évacuer et à envoyer les blessés nouvellement arrivés à Pouchkino. Les blessés morts pendant la nuit dans les salles des blessés (il y en a une trentaine) sont stockés dans une grande grange vide. D'autres plus tard dans l'église, qui sera ensuite utilisé par les Soviétiques comme garage automobile et atelier de réparation.
Vers midi, le 8 décembre, nous avons réussi, au prix d'efforts et de persuasion indicibles face aux chauffeurs de camion, à évacuer tous nos 300 blessés.
Alors qu'il s'agissait jusqu'à présent d'unités de "Troßeinheiten", des troupes de combat commencent à refluer. Nous chargeons notre équipement le plus important, surtout le matériel chirurgical et la pharmacie, sur des traîneaux et des voitures attelées. Tous nos véhicules motorisés doivent rester sur place et sont détruits à la grenade. En de nombreux endroits, les provisions sont brûlées
Nous évacuons le village vers le soir, à la limite Est du village, les Russes tirent avec des chars. Des canons antichars légers et des mitrailleuses sont mis en place par les soldats qui reculent. Les pionniers mettent le feu aux maisons afin de détruire les abris des Russes qui avancent. Les villageois, pour la plupart des femmes et des enfants, se lamentent devant les maisons en feu. Il fait -20°. Les camions en fuite écrasent sans ménagement tout ce qui se trouve sur leur chemin. On entend des cris : "Sauve qui peut ! Les Russes arrivent !" Les Allemands sont en fuite : nous sommes le 8 décembre 1941.
A la nuit tombante, nous marchons au pas de charge derrière nos quelques traîneaux et chariots attelés, en direction du sud, vers l'hôpital de campagne de Pouchkino ; derrière nous, la lueur rouge de l'église en feu de Berezniaki. Mais nos nombreux blessés sont en sécurité. Nous n'avons laissé que 60 morts dans le village, que nous n'avons pas pu enterrer. Toute la nuit glaciale, nous marchons vers le sud jusqu'au lever du soleil.
Des chauffeurs nous ont dit : Le même jour, des scènes terribles se sont déroulées dans la ville de Kalinin. Trente avions tout neufs, des chasseurs, étaient à court de carburant sur l'aérodrome et ont dû être détruits. Des tas de ravitaillement de toutes sortes ont été brûlés sur les places, les dépôts de munitions ont explosé. C'est ce qui s'est passé sur tout le front, de Kalinin à Klin. A Klin, l'hôpital de campagne n'a pas pu être évacué en raison de la percée surprenante des Russes. Les blessés légers fuyaient pieds nus devant les chars russes. Personne ne sait ce qu'il est advenu des autres blessés.
Ce n'est qu'à 200 kilomètres au sud-ouest de Kalinin, près de Subzow, que le front allemand s'arrêta à nouveau dans les premiers jours de janvier 1942. Mais les Russes avaient réussi de profondes percées qui ne purent être nettoyées même durant l'été 42 et qui conduisirent à la bataille décisive de Rshew (en juillet- août), dont les pertes de nos unités dépassèrent de loin tout ce qui avait été fait jusqu'alors.
7 Mitina près de Staritza/Volga – 31 décembre 1941
Saint-Sylvestre, 31 décembre 1941
L'action de propagande de Goebbels est arrivée trop tard : de nombreux soldats allemands ont souffert de gelures, car la Wehrmacht n'était pas préparée à une guerre d'hiver en Russie.
Nous sommes assis autour d'un grand ПЕЧКА (Pjetschko), un four russe en argile dans une ferme (ИСБА), et nous nous réjouissons de la chaleur que dégage le feu qui crépite à l'intérieur. Peu à peu, les membres et les visages figés par le froid se délient. Le jour de l'an 1941 ! Depuis l'aube, vers 8 heures, nous avons commencé à marcher vers le nord-est, jusqu'à une bonne partie de la nuit d'hiver qui commence vers 16h. Ce contre le vent fort de l'est, soi-disant pour ouvrir un HVP le lendemain. A l'arrivée au village de Mitina, nous avons entendu d'autres unités dire que les Russes avançaient à nouveau et qu'ici, à Mitina, la ligne de combat principale serait à nouveau établie dès demain. La torture pour les hommes et les animaux a donc été inutile aujourd'hui. "Une promenade du Nouvel An" dit "Balletto" (vulgairement Fritz Heise). Il repartira probablement demain matin.
Pour la Saint-Sylvestre, le "ravitaillement" pour chaque 3 hommes était une bouteille de vin rouge qui était déjà destinée à Noël et qui était consommé le jour même. Nous sommes étonnés : quel éclat dans notre chalet ! Le vin rouge est intact, seules les bouteilles en verre sont gelées. Mais ce n'est pas grave, car le vin est certainement figé en glace rougeâtre depuis deux mois : il peut donc très bien être distribué "à la pièce", même sans bouteille.
Dès notre entrée dans le village, nous avons utilisé la hache et la scie, toujours à portée de main sur le dessus de notre roulotte, pour prendre deux grosses poutres de bois depuis le mur d'une grange de la ferme. Maintenant, le feu crépite tranquillement dans la cavité en forme d'arc du fourneau en argile ; à l'aide de longues pinces en fer, des crochets à feu et un pot en fer couvert avec des pommes de terre et de l'eau (neige dégelée) qui est glissé dans les braises et recouvert de bûches enflammées ; un autre pot suit avec de l'eau pour le "vin chaud". Après la torture et le froid de la marche du jour, nous voulons vivre ce soir tout à fait "bon" ; "ХОРОШО" (bien), dit Balletto. Nous nous asseyons et nous nous réchauffons, et lentement, avec la chaleur croissante de la pièce, nous retirons les nombreuses enveloppes que nous avons sur le corps. Ici, dans l'hiver russe, nous mettons toujours 2-3 sous-vêtements simples, puis la combinaison de drills, par-dessus un pull et l'uniforme de drap, et par-dessus le manteau. Et pourtant, dehors, le vent glacial de l'Est siffle à travers toutes ces couches. Ce n'est qu'en bougeant fortement, en marchant, que c'est supportable. Mais malheureusement, les nombreuses "peaux" sont un labyrinthe idéal pour les poux. D'habitude, nous allons "à la chasse" pendant les pauses de la marche, surtout le soir, et nous comparons nos "chiffres d'abattage" ; la moyenne est de 60 à 80 unités par homme. Nous ne disons pas : "Nous avons des poux", mais : "Les poux nous ont". Bientôt, nous serons tous assis autour du four, uniquement vêtus d'une chemise et d'un pantalon, et nous attendrons que les pommes de terre soient cuites.
La marche d'aujourd'hui nous a donné, tout au long de la journée, un peu "d'élan", car nous sommes repartis vers l'est ; après le grave revers du début du mois de décembre, lorsque tout le front de Kalinin s'est effondré, après cette période de 14 jours de fuite vers le sud-ouest, les choses avançaient, enfin, à nouveau. Il y avait des slogans : le Führer lui-même avait pris en charge la direction et la reconstitution du front, il était à Subzow, dans le nouveau FHQ (Führerhauptquartier). Nous l'avons appris plus tard : Hitler n'a jamais été sur le front en Russie, il dirigeait tout depuis l'arrière, depuis un FHQ à l'abri des bombes près de Rastenburg en Prusse orientale, la "Wolfsschanze". Et lorsque l'offensive dans le secteur central a échoué début décembre (malgré l'avertissement de Brauchitsch), c'est bien sûr la faute de ce dernier si :
1) les pertes en blessés et en gelures dépassaient de loin le maximum habituel, pourquoi ? Parce que la Wehrmacht n'était pas équipée pour une guerre d'hiver russe, il lui manquait surtout des vêtements d'hiver ;
2) le front s'effondrait parce qu'il n'y avait pas de HKL là où les cartes d'état-major indiquaient une nouvelle ligne de combat principale. En effet, les soldats grelottants se trouvaient en plein champ, sur un sol gelé sur plusieurs mètres, avec leurs mitrailleuses inutilisables en raison des températures très basses, et dont l'huile gelait. Les fortifications n'ont pas pu être creusées du tout.
Ce matin, alors que nous nous dirigions à nouveau vers l'est, nous avons pensé : La Russie a été freinée, il y a de nouveau un arrêt. Cette année d'avancée gigantesque et fulgurante en Russie ne devait donc pas être si désespérée que cela ! C'est ce que nous pensions en marchant dans le froid glacial d'aujourd'hui.
Les pommes de terre cuisent et le vin rouge dégèle. On mange, puis "on s'en met une", comme le dit Balletto quand il s'allume une cigarette. En cette dernière soirée de l'année, nous voyons défiler six mois de la campagne de Russie autour du feu qui nous réchauffe : Les mystérieuses marches nocturnes (interdiction de chanter !) de Modlin-Mlawa en Pologne vers le sud-est de la Prusse, Lyck et Račky à la frontière russo-polonaise ; le jour du début de la guerre en Russie (22/06/41), la journée de Janowka, avec les premières lourdes pertes de notre division par les tireurs d'élite sibériens ; la place d'articulation principale de Biely-Dom ; l'avancée tumultueuse par Grodno ; la bataille d'encerclement de Bialystok-Minsk ; la chaleur estivale - la marche - la marche - la soif insupportable - les puits de village infestés de cadavres d'animaux - Déserts de sable - marche - le matin, à l'horizon, une chaîne de collines bleues - à l'est - marche toute la journée - le soir, à nouveau une vague de collines à l'horizon - plaine russe infinie - marche à pied : 500 - 800 - 1000 kilomètres vers l'est. La nuit, on marchait souvent pour faire la jonction avec les unités motorisées. Tôt le matin, entrée dans un nid de Russes crasseux en -ski, -ka ou -kow ; mise en place de notre HVP en deux heures, tandis que les Sankras chargées à bloc arrivent du front et sont déchargées. Opération - pansement - attelle - plâtre - bandage - amputation - opération abdominale - anesthésie - injections de sérum - anesthésie SEE (scopolamine, éphétomine, eucodal) - ivresse chloréthylique - souvent 24 heures sans repos, souvent 48 heures jusqu'à la limite des forces physiques - sommeil semblable à la mort de quelques heures. Démontage de l'HVP - chargement. Et à nouveau la marche sur les chemins de sable - kilomètres après kilomètres vers l'est sous une chaleur torride, sous de (rares) averses. À travers les marais de Pripjet - Slonim - Bobruisk - Smolensk. La bataille d'encerclement Vyazma- Briansk - le chaudron de Vyazma - automne - la période de boue en octobre - arrêt de l'avancée - 10.000e prisonniers russes à Vyazma, mais pas de fin. Premiers combats de partisans à l'arrière. Préparation de l'encerclement de Moscou et puis, début décembre, la catastrophe : pour la 1ère fois depuis 1939, retour en arrière, front allemand brisé par de grands effondrements des Russes, bien mieux équipés pour affronter les rigueurs de l'hiver.
Ils sont là, mes camarades de l'équipe chirurgicale de la deuxième section. La veille de la Saint-Sylvestre, ils boivent le vin rouge chaud qui a fait le long voyage de la France jusqu'à nous, gelé en glace :
Arno Mokroß, maître ramoneur de Gollnow en Poméranie occidentale;
anesthésiste chez nous (Narkotiseur) ;
Eddi Dallmann, tailleur de Stettin - aide-opérateur (OP-Helfer);
Heinz Kleinke, employé d'administration de Stargard en Pomérani - pharmacien de campagne (Feld-Apotheke);
Fritz Lessentin, traiteur de Stettin - secrétaire d'enregistrement (Aufnahmeschreiber) ;
Hans Kosinski, bachelier de Stralsund - expert en électricité et en groupes (Elektro- und Aggregat-Sachverständiger)électrogènes ;
Friedrich Heise, coiffeur de Groß Tychow près de Neustettin - assistant d'opération (OP-Helfer) et spécialiste des expressions grivoises;
Fritz Münchow, ouvrier boulanger de Köslin - pharmacien de campagne (Feld-Apotheke);
Hänschen Wundschock, pêcheur (Heringsbändiger) à Greifenhagen en Pommern - pharmacien de campagne (Feld-Apotheke).
Le vin rouge chaud nous réchauffe vraiment de l'intérieur et les (quelques) degrés d'alcool font le reste. Lorsque nous nous sommes arrêtés ce midi pour "attraper" de la nourriture dans le canon à goulasch, la soupe de haricots avait gelé sur le bord de l'ustensile de cuisine. Pendant que nous mangions nous ne pouvions déjà plus sortir les dernières cuillères vers le milieu : elles s'étaient figées en une croûte de glace, gelées. Plus aucun de nos cochers n'était assis sur le véhicule, il aurait inévitablement gelé. Ce n'est qu'en marchant à côté des "Zossen" qu'ils pouvaient encore sentir leurs pieds.
Mais tout cela était derrière nous (pour l'instant). Nous fêtions maintenant la Saint-Sylvestre. Un toit sur la tête, un poêle chaud, de la nourriture et une botte de paille sur le sol en terre battue, c'était beaucoup de confort à l'époque ; plusieurs fois en décembre, pendant les courtes pauses de la marche, nous devions nous coucher dans quelque grange pleine de courants d'air et nous nous réveillions peu de temps après à cause du froid, à moitié enneigés.
Les efforts de la marche d'aujourd'hui se font sentir : Nous sommes bientôt fatigués. Nous pensons aussi à la marche de demain, le jour de l'an 1942, et nous nous "tapons" la paille sur le plancher. Nous espérons pouvoir dormir encore quelques heures tranquilles malgré les punaises.
8 OL Karamsino près de Subzow – 05/01 au 10/05/1942
"МАТКА ПОЖАЛЧИСТА, ТОПИЂ, ТОПИЂ ЛЕЖАНКЧ, СИ ЧАС !" (mamie, chauffez s'il vous plaît, chauffez le petit pofen, mais tout de suite !) C'est sur ces mots que quatre sentinelles arrivent de la patrouille sur la longue route du village de Karamsino, dans la chaumière des Russes qui sert de local de garde à notre compagnie sanitaire. Les sentinelles gelées appellent ainsi la vieille paysanne, qui a son siège attitré sur le grand poêle-lit qui occupe 1/6 de la pièce, pour qu'elle rallume le petit four. Il fait un froid de canard cette nuit- là. Le 28 février 1942, 3 heures du matin. Des deux côtés de la route du village, la neige s'étend depuis des mois sur plusieurs mètres, glacée. L'air est clair comme du cristal. En haut, dans le crépuscule du ciel d'hiver, le "U. v. D.", la "machine à coudre" russe, un bombardier de nuit des plus primitifs, qui lance des bombes à la moindre lueur. Il apparaît dès le début de la nuit et nous hante toute la nuit. Il gèle, on mesure cette nuit-là -52 degrés de froid. Nos postes de garde (tous les équipages de la compagnie sont engagés ici !) sont encapuchonnés au point d'être méconnaissables. Au bout d'une heure seulement, ils sont relevés. Mais ce court laps de temps représente déjà une éternité par ce froid mordant. Les larmes viennent involontairement aux yeux des soldats de garde et se transforment aussitôt en glace. Chaque souffle d'air se transforme en croûte de glace devant la bouche dans le couvre-chef. - En maugréant, МАТКА descend de ПЕЩКА, va chercher un fagot de bois de chauffage dans la remise voisine et chauffe à nouveau. Autour du petit poêle, allongés sur le sol, les gardes libres somnolent. En raison d'un risque partisan accru, deux postes doubles doivent surveiller le village chaque nuit. C'est dans ce village que se trouve notre compagnie sanitaire avec le train de ravitaillement. Nous avons ouvert un hôpital local, plusieurs fermes ont été transformées - aménagées - en locaux pour les blessés et les malades. Par-dessus les multiples enveloppes et le manteau, les sentinelles ont encore enfilé des chemises de camouflage de neige qui recouvrent aussi le casque d'acier. Sur les mains, ils ont enfilé des chaussettes de la Wehrmacht, deux paires, dans lesquelles des trous ont été découpés pour le doigt de la détente de la carabine, car il n'y a pas de gants. Le visage est recouvert jusqu'aux yeux par le couvre-chef vert, seuls les yeux restent libres.
Les fermes russes sont disposées en rangées irrégulières de part et d'autre de la route et d'un cours d'eau, maintenant seulement indiqué par une dépression dans le désert de neige. Juste derrière la dernière ferme commence la solitude neigeuse de la plaine russe infinie.
Après leur relève, les 5 postes s'épluchent avec des yeux figés. de leurs nombreuses enveloppes. Par ce froid, le Landais ne peut se déshabiller complètement que dans le sauna et dans la salle d'épouillage. Combien de fois avons-nous été épouillés, mais au bout de cinq ou six jours, les premières petites bêtes reviennent, restent là et se multiplient de manière inquiétante. Mais ici, elles ne sont pas seulement gênantes, elles représentent un danger mortel, car elles transmettent le typhus, la fièvre tachetée. A la sortie nord du village, notre compagnie a installé une station d'isolement du typhus. Près de 70 cas graves s'y trouvent. Ces jours-ci, la troisième équipe de soins a été mise en place en l'espace de 14 jours. Les deux premières équipes ont toutes été contaminées. Les soins sont très difficiles. Dans leur délire fébrile, les malades veulent souvent se jeter hors des chambres dans le froid extérieur. Il faut souvent les attacher sur les lits. Celui qui contracte le typhus à plus de 35 ans est généralement condamné à mort.
Chaque jour, 20 Russes travaillent à creuser des fosses pour les défunts dans un sol dur comme la pierre. Après 12 heures de travail, ils ont creusé trois trous peu profonds dans la terre. Comment les Russes peuvent-ils supporter ce travail difficile par un froid pareil, c'est une énigme pour nous.
Il y a actuellement peu de blessés dans notre secteur du front. La plupart des victimes sont dues à la fièvre et au froid. Il existe bien un sérum anti-typhus, mais il est loin d'être disponible en quantité suffisante, malgré le récent institut du sérum créé à Cracovie. Bien sûr, tous les infirmiers des services de soins intensifs sont vaccinés à titre préventif avec le sérum, mais ils tombent tout de même malades les uns après les autres. Forte fièvre pendant 4-6-10 jours, 40-41°. Le cœur travaille comme un fou. Les malades sont généralement inconscients. Ils ne veulent rien manger pendant les jours de fièvre, mais si on ne leur en donne pas régulièrement de force, ils meurent littéralement de faim. Puis vient le treizième jour. La fièvre tombe rapidement à 37°, 36,5°. C'est alors que survient la crise : le cœur lâche, le malade meurt d'insuffisance cardiaque. C'est ce qui arrive à tous les hommes âgés. Les plus jeunes tiennent généralement le coup. Mais alors apparaissent chez eux les séquelles du typhus : chute des dents, des cheveux, graves malformations cardiaques et perte de mémoire, etc. Il n'a pas l'air très "héroïque", ce décès par le typhus en plein hiver russe. Combien de soldats doivent être déposés dans un creux de terre peu profond, enveloppés seulement dans leur toile de tente, dirigés par un petit commando funéraire, plus rarement par le curé de la division, qui est parfois aussi secoué par la fièvre.
Le travail très difficile des soignants dans le service d'isolement n'est pas non plus très "décoratif", car la vaccination préventive n'empêche que l'inconscience pendant plusieurs jours en cas de fièvre extrême. Mais certains malades s'en sortent aussi en recevant du sang d'un malade du typhus déjà guéri. Dans les cas graves, il faut injecter toutes les demi-heures des médicaments pour le cœur et la circulation sanguine par voie sous-cutanée. Dans les cas limites de décès, il est parfois possible d'injecter du digipurate directement dans la région du cœur ou du glucose à 40% dans la veine du coude. Des prisonniers russes sont également hospitalisés dans notre service de typhus, mais ils survivent sans problème à la maladie. La plupart d'entre eux ont déjà souffert d'une légère infection par le typhus dans leur jeunesse et ont donc suffisamment de défenses dans le sang.
Les blessés du front souffrent souvent, en plus de leurs blessures par balle, de graves engelures, du 1er au 3ème degré. Premier degré : orteils ou doigts fortement rougis avec une peau nue et rouge-bleu. Deuxième degré : grosses cloques de gel sur les membres gelés (comme des cloques de brûlure). Troisième degré : nécrose, peau et tissu musculaire déjà noircis par la décomposition, avec des orteils et des pieds complètement morts. Dans le dernier cas, l'amputation immédiate est nécessaire si l'on veut sauver le malade d'une septicémie générale.
Une fois, cet hiver, mon camarade Arno Mokroß a frotté pendant plus de deux heures les pieds d'un campagnard qui avait les deux pieds gelés avec de la neige et lui a ainsi évité l'amputation, car après ce traitement, la vie avait repris dans les pieds ; certes, la peau était comme en lambeaux, mais il a pu garder les pieds !
Nous traitons les gelures du premier et du deuxième degré avec des pansements transalpins pour le foie en couches épaisses et des bandages durables et adaptés à la marche. Notre salle de pansements se trouve dans une pièce, une classe de l'école russe du village, le seul bâtiment de deux étages ici. Dans trois grandes pièces se trouvent d'énormes poêles qui sont chauffés jour et nuit (plusieurs granges en bois y passent !). Parmi les nombreuses troupes qui passent à Subzow, un pourcentage important reste toujours chez nous pour se faire panser les mains et les pieds gelés. Nous en gardons beaucoup et les envoyons à l'hôpital de campagne de Latachino, à l'arrière. Souvent, nos médecins procèdent à l'amputation urgente des doigts et des orteils. Malheureusement, ces engelures peuvent s'accompagner d'infections qui continuent à se propager : de nombreux camarades ont perdu la vie dans ces circonstances.
Partout, les vêtements d'hiver manquent. En décembre et janvier, on entendait à la radio la propagande grandiloquente du don de Goebbels = "des vêtements d'hiver pour le front". Mais la chose la plus importante n'a pas été claironnée sur les ondes, à savoir que le commandement de la guerre allemand ne s'était pas attendu à une guerre d'hiver en Russie et n'était pas du tout préparé. Lorsqu'en mars, les vêtements d'hiver chauds arrivèrent enfin jusqu'au front, des dizaines de milliers de soldats étaient déjà morts de froid.
Je me souviens d'une soirée d'automne, en pleine période de boue. Nous avions ouvert un centre de collecte de malades à une vingtaine de kilomètres au sud de Smolensk : le village s'appelait Kritzkowzschina (tout simplement !). Plus tard, j'ai même trouvé cet endroit sur une bonne carte ! Un soir, toute une colonne de voitures est arrivée. Des officiers généraux en sont descendus et ont fait une pause chez nous. L'un de ces messieurs majestueux a dit avec condescendance à notre sous-médecin de service : il ne restait que peu de choses à régler, le commandement suprême de l'armée prévoyait, dans le meilleur des cas, la capitulation complète de la Russie au plus tard fin novembre. C'était en octobre 1941 ! Très bien !
Les nombreux malades de la dysenterie que nous avons recueillis à l'infirmerie de Kritzkowzschina en octobre et que nous avons envoyés à l'hôpital de guerre de Smolensk étaient clairement dus à la période de boue, pendant laquelle la troupe a parfois dû compter sur le ravitaillement "du pays" pendant plusieurs semaines, car le ravitaillement ne suivait pas. Certains jours, nous devions patauger dans la boue sur 20 kilomètres et nous n'avions pas le choix. Nous avons souvent poussé les chariots bloqués sous l'attelage de 8 chevaux (avec 20 hommes derrière et à côté de chaque chariot !) jusqu'aux mollets dans l'eau boueuse. Le soir, nous étions heureux de pouvoir prendre une marmite de pommes de terre (КАРТОШКИ) et un peu de sel (СОЛЬ) au "panje". De temps en temps, il y avait du miel en rayons d'abeilles réquisitionné dans les fermes, mais nous le redoutions et souvent nous ne le prenions pas du tout, car il provoquait régulièrement des diarrhées épouvantables dans nos estomacs affaiblis. Le ravitaillement ne suivait pas, car les gros camions s'enlisaient dans la boue. On ne pouvait guère appeler "routes" ces chemins de campagne russes. Il y a un proverbe russe qui dit : "Si la route ne te plaît pas, cherche-en une autre". C'est ainsi qu'on contournait les "Chemins" autour des trous de boue de 100 mètres de large et les trous de boue se succédaient. La situation ne s'est améliorée qu'avec l'arrivée du gel. Le 6 septembre, la première fine couche de neige est tombée du ciel, nous étions alors encore devant le chaudron de Vyazma, puis le gel brutal est arrivé fin octobre et l'épaisse couche de neige. Et celle-ci ne disparut - ne dégela - que début mai ! Voilà à quoi ressemblait pour nous l'hiver 1941/1942 dans le secteur central.
9 Panaritium, morphine et punaises – Janvier 1942
Une lumière de Hindenburg dans une chaumière de paysan russe, dans la section centrale de la Russie, janvier 1942, dans Karamsino près de Viazma
La pâle lueur du jour de cette courte journée d'hiver céda assez rapidement la place à l'obscurité de la nuit hivernale russe. Il faisait très froid. Je me trouvais malade dans une cabine russe, à l'équipement rudimentaire, sur un lit de bois dans la pénombre, dans la puanteur, l'odeur, la saleté, au milieu de la vermine ; et l'avenir de notre armée allemande, ici en Russie, semblait aussi sombre que mon environnement. Lorsque, après avoir fui les bassins de retenue près de Kalinin, nous sommes enfin parvenus à nous reposer et à prendre nos quartiers à Karamzino, au sud de Subzow, après quatre semaines de retraite précipitée, la nouvelle année 1942 avait déjà commencé, c'était la première semaine de janvier. Dehors, il faisait un froid inhumain (-35° à -40°), selon les critères de l'Europe occidentale. Les troupes sibériennes fraîches, habituées à l'hiver, qui avaient avaient percé le front allemand entre Kalinin et Klin et réalisé de profondes percées, et étaient remarquablement bien équipés. Ils avaient des fourrures épaisses, de bons lainages, des chemises blanches de camouflage de neige et avançaient rapidement sur leurs skis ; s'ils devaient passer la nuit dehors, ils étaient équipés de coussins chauffants chimiques (sachets) qui, une fois humidifiés, diffusaient une chaleur de 30° à 40° sur le corps, pendant des heures. Tout cela manque aux soldats allemands.
Afin de maintenir ouvertes les voies de communication entre notre village et Subzow, puis Vyazma, pour les camions de transport militaire, des hommes et des femmes russes ont été recrutés dans le village pour creuser des tranchées et des chemins creux dans les hautes congères : c'était un travail très dur, qu'il fallait accomplir chaque jour pendant des heures, avec un long trajet d'approche. Le canon à goulasch servait à alimenter les "Panjes" avec une louche de soupe chaude pour le déjeuner.
Lors de ma fuite de notre poste de secours principal de Beresnjaki vers le sud-ouest, en direction de Rshew, j'avais contracté une inflammation du lit de l'ongle, un panaris, au pouce gauche. La chose suppurait et était très enflée, le doigt était considérablement douloureux. Bien sûr, je n'ai pas pu assurer, avec un tel pouce "infectieux", mon travail au bloc opératoire de la salle de soins de l'hôpital local de Karamsino. Je ne pouvais pas continuer à exercer, surtout pas en tant qu'instrumentiste : j'étais désormais "non stérile" et handicapé, j'ai été mis en congé maladie.
Le 5 janvier, le médecin-major avait "soigné chirurgicalement" ma suppuration du lit de l'ongle ; c'est-à- dire qu'il avait, sous anesthésie locale (anesthésie locale avec une solution de novocaïne à 3 %), pour donner de l'air au foyer de pus, d'abord fendu l'ongle du pouce en deux, puis en avait retiré les moitiés. (Les traces évidentes de cette ablation de l'ongle n'ont pas disparu au cours des 40 années qui se sont écoulées depuis ; l'ongle a beau avoir repoussé de nombreuses fois ; on voit encore aujourd'hui l'incision pratiquée à l'époque au milieu de l'ongle).
Après que l'anesthésie se soit dissipée, le bout du pouce est resté très sensible, même après la disparition de l'inflammation et de la douleur. Il a fallu encore plusieurs semaines avant que l'ongle ne repousse. A la fin du mois de janvier, j'ai tout de même pu aider un peu à l'hôpital local avec ma main droite saine.
Mais les 14 premiers jours, j'ai dû "faire une pause" et se couchait ou s'asseyait dans le quartier, dans la chambre du fermier.
Eh bien, je n'étais même pas fâché de cette pause dans le service de chirurgie. Après la chasse à l'homme de l'opération HVP, de juin à décembre 1941, c'était la première fois que je n'avais pas la responsabilité de l'instrumentation et que je n'étais pas soumis à la tension nerveuse pendant les opérations. J'avais "congé", je pouvais faire la fête "malade".
Je dois décrire un peu plus en détail mon environnement de l'époque dans le "quartier", dans le salon de la maison russe. Nous étions six (l'équipe chirurgicale) à loger dans une maison en rondins faite de gros troncs de pin. Les troncs ronds étaient empilés les uns sur les autres avec des chevilles en bois. Une petite fenêtre double donnait à la pièce (environ 6x4) une lumière crépusculaire, car les vitres étaient sales, à moitié opaques, et les fentes latérales étaient collées avec des bandes de papier ; cela signifiait : on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre pour aérer (pas avant mai-juin !), c'est ainsi que les Russes retenaient la précieuse chaleur (le renfermé) dans la pièce. Dans un coin de la pièce se trouvait le grand poêle carré (ПЕЧЬ), sur la large surface duquel, juste sous le plafond en bois, le panje et sa nombreuse famille avaient leur couche de peaux et de couvertures.
Au milieu de la pièce se trouvait un four plus petit, pour la cuisine et la pâtisserie, lui aussi en argile (ЛЕЖАНКА). L'unique porte, donnant sur l'étable et la grange, était capitonnée de sacs remplis de paille qui gelaient en une épaisse couche de glace de condensation.
Dans presque toutes les chambres de ferme (dans la partie centrale et plus tard en Ukraine), où nous avons également pris nos quartiers, nous avons trouvé un coin de l'iconostase sur une étagère en bois au-dessus de la banquette. Oui, vraiment, un "coin du Seigneur" russe !
Et ce, malgré la propagande athée et impie des Soviétiques - c'est-à-dire après 25 ans, depuis 1917 ! Sur les consoles, on trouvait tantôt de bonnes vieilles peintures d'icônes, tantôt de vulgaires impressions grecques orthodoxes en couleurs, décorées tout autour de dentelles blanches et rouges en toile de lin brodée. Le tout était couvert de crasse et était un eldorado pour les araignées, les mouches et les cafards, qui s'empressaient de prendre la fuite dès qu'on enlevait l'icône ou qu'on la touchait. Mais le coin des saints n'était pas indifférent à la famille paysanne = ils se plaignaient bruyamment lorsque nous le nettoyions.
Les habitants russes avaient résolu la question des "lits" en installant un camp familial en haut de la plate-forme du four. Nous avons construit nos dépôts de la manière suivante : Quatre barres de bois brut ont été calées verticalement entre le plafond bas en poutres et le sol en terre battue. Ensuite, nous avons placé des planches transversales à l'horizontale à hauteur de siège et, pour le lit supérieur, à hauteur de tête ; nous avons posé sur ces planches de longues planches en vrac comme "matelas" ; puis quelques bras de paille et la couverture par dessus : le lit double était prêt.
On passait beaucoup de temps sur les couchettes, car à cette époque de l'année, la nuit commençait déjà à 3 heures de l'après-midi. Cela venait du fait que la Wehrmacht ne connaissait qu'une seule heure de Rshew en Russie à Calais en France. Donc pas d'heure en fonction de la longitude : Europe de l'Ouest, l'heure de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, une seule heure, l'heure allemande. Pour nous éclairer, nous ne disposions que de pauvres "tranfunzels", appelés "Hindenburglichte", une masse puante et blafarde : une petite mèche flottait sur une sorte de substitut de stéarine dans un couvercle en carton.
Les fissures et les espaces entre les grosses poutres de la maison en rondins étaient remplis de mousse. Elles étaient - et sont certainement encore aujourd'hui - une cachette idéale pour toutes sortes de vermines, punaises, puces, cafards et poux. Par nécessité, nous avons pratiqué une entomologie intensive dans ces quartiers. La principale nuisance était les punaises.
Voici un bref flash-back littéraire de notre époque civile, avant la guerre : il y eut - vers 1925 - un livre aussi drôle que satirique de Manfred Kyber : "Unter Tieren" (Parmi les animaux), qui imitait très habilement l'histoire de la guerre. "Jungle Book" de Kipling traduit en "européen". Un chapitre de ce livre"Parmi nous, la vermine", c'est ce que nous, les soldats, avons vécu dans notre propre chair en Russie. Parmi les cinq espèces énumérées par Kyber dans cet ouvrage : Punaises, puces, poux, blattes et poux de bibliothèque, seule la dernière espèce ne nous a pas été présentée. Tous les autres : à fond !
Quand on entrait dans une chaumière russe, notre première question portait sur les insectes. Nous demandions : Babouchka, ХЛОБ Ч ВАС ? (Grand- mère, y a-t-il des punaises chez vous ?) La réponse était toujours : НЕТ, ГОСПОДИН, СЧДА НЕТ ХЛОБЙИ ! (Non, Monsieur, il n'y a pas ici !).
D'un point de vue sophistique, c'était même parfois vrai : pour les Russes, les punaises n'existaient quasiment pas, ils étaient immunisés contre les morsures depuis leur jeunesse. Ils ne ressentaient guère non plus les poux de tête, car c'était une vieille habitude qu'ils affectionnaient. C'est pourquoi les Russes ont également été préservés de la contamination par le typhus, transmis par les poux. Déjà dans leur jeunesse, ils ont été immunisés contre cette maladie par une "vaccination précoce".
Le soir, lorsque nous, les soldats, étions assis autour de la table, à moitié nus, à la chasse aux poux dans les nombreuses enveloppes de nos vêtements, nous posions un couvercle de boîte de cirage, sur un petit support en fil de fer, au- dessus de la flamme de la lampe Hindenburg. Nous jetions chaque poux trouvé dans le couvercle chaud et aussitôt "explosé" le pou, est parti avec un petit "crac" en l'air.
L'invasion de punaises !
Comme les punaises ont pu se réjouir d'avoir du sang frais d'Europe de l'Ouest en abondance avec les troupes allemandes ! Il leur suffisait de saisir ou de mordre. Ces animaux n'aimaient pas la lumière, c'étaient des travailleurs de l'ombre, des travailleurs au noir. Mais dès que la dernière bougie du Hindenburg était éteinte (il fallait bien faire des économies !), ils sortaient de leurs fissures, par sections, bataillons, régiments, de la punaise de 3 millimètres brun noirâtre et puante principale jusqu'à la punaise microscopique, A propos de l'odeur : Kyber parle d'un parfum pénétrant, appelé "Peau de punaise", ce qui, traduit d'un français poli, ne signifie finalement que "odeur de peau de punaise", chez Mme Krabbelbein, conseillère supérieure. On est tenté de continuer dans le style de Kyber. Peut-être comme ceci "Le cri de guerre des insesctes retentit : Réveillez-vous, les enfants, s'écria la grosse babouchka, la grand-mère des punaises, réveillez-vous, il y a quelque chose de bon à manger ce soir : de nouvelles grosses bêtes chaudes sont arrivées en bas, juste avant le coucher du soleil. C'est une toute nouvelle saveur, un parfum délicat. Attention, la lumière va s'éteindre ! Certains d'entre eux, en bas, ont été malins, ils ont mis leurs montants de lit dans des boîtes de conserve remplies d'eau. Mais cela ne vous dérange pas ! Vous avez rampé vers le plafond jusqu'à ce que vous soyez juste au-dessus des ballots de sommeil, vous avez fait le point et vous avez atterri en sautant de manière ciblée ! Sur eux ! Ces nouveaux grands animaux, avec leur peau blanche et fine, portent bien des gants et des pulls, mais vous trouverez déjà les petites bandes de peau nue, comme ça, entre le gant et la manche, comme ça, autour du poignet et du cou ; et c'est là que vous commencez à mordre et à sucer". Elle, l'Ur-Babouchka des punaises, était assise devant une large fente de bois, sa villa, dans la poutre juste sous le plafond, et observait d'un œil exercé le personnel en bas, juste au-dessus du sol, sur les lits de paille. La nombreuse famille Panje sur le Pjetschko n'était pas du tout intéressante pour elle et sa famille. Mordre et sucer les Allemands, c'était un festin pour les plus de 1000 membres de la famille. Mais pas seulement pour eux, mais aussi pour les puces qui aiment sauter et les poux de tête qui s'affairent ; seuls les cafards, les cancrelats, cherchaient des restes du pain".
Comme le dit Kyber à la fin de son histoire de vermine "Ça démange littéralement !" C'est certainement exprimé de manière très "proche de la peau", mais : les allemands en Russie n'étaient pas seulement démangés par la vermine, "formelle", mais réelle, et ce au centuple, tout au long de la nuit.
Les morsures s'enchaînaient, surtout autour du cou et des poignets : cela ressemblait à une ceinture de points rouges le lendemain matin. C'était un tourment pour lequel nous n'avions pas solution.
Malheureusement, il n'y avait "pas de remède" pour Kate ; par où commencer dans cette saleté ? Désinfecter l'endroit était sans espoir. Il n'y avait qu'une seule exception réjouissante dans le village : notre salle de traitement à l'école. Bien sûr, il y avait aussi des punaises, mais nous nous attaquions à elles dans les fissures des poutres et dans les coussins de mousse avec une solution chaude de savon de crésol, que nous traitions profondément et radicalement à l'aide de seringues clystères de 200 centimètres cubes munies de grosses canules. Nous avons ainsi soigneusement nettoyé tous les espaces entre les poutres, de haut en bas, et avons systématiquement détruit des générations de familles de punaises prometteuses. Nous avons également frotté le sol avec une solution savonneuse chaude : là, c'était le calme ! Au moins là !
Mais j'étais maintenant allongé dans la boîte russe avec mon pouce blessé que j'essayais de protéger avec une chaussette de la Wehrmacht que je mettais sur le bandage.
Comme j'avais beaucoup de douleurs dans les jours qui ont suivi l'intervention, j'ai eu l'idée (impossible en temps normal en travaillant en salle d'opération, mais pas tout à fait absurde maintenant) de m'injecter moi-même, à titre d'essai, quelques-uns des analgésiques contenus dans l'armoire dont j'avais la charge. Je l'avoue : mes douleurs ont aidé ma curiosité. Cela signifiait tester moi-même l'effet des anesthésiants, que j'avais l'habitude d'utiliser tous les jours.
Parmis les douzaines de comprimés ou d'injections aux blessés. Il y avait surtout les deux narcotiques :
1) la morphine dérivée de l'opium - Morphium hydrocloricum, et
2) le mélange de trois anesthésiants : SEE, qui est
a) Scopolamine
b) Eukodal
c) Éphétonine
Ce mélange convient particulièrement bien pour l'induction de l'anesthésie, qui se poursuit ensuite avec de l'éther (flacon compte-gouttes) sur le masque d'anesthésie. Pour les interventions qui ne durent que quelques secondes, nous utilisions l'ivresse chloréthylique. Le premier soir, j'ai commencé le SEE, je me suis injecté l'ampoule de 2 centimètres cubes par voie sous- cutanée dans l'avant-bras gauche, avec une seringue record et une canule très fine - nous l'avions appris : scier la tête de l'ampoule, placer la canule sur l'extrémité, aspirer le liquide de l'ampoule dans la seringue Rekord, arroser pour faire sortir l'air de la seringue Rekord (risque d'embolie gazeuse), puis enfoncer la canule à plat sous la peau, enfoncer le piston jusqu'au bout.
L'effet a été assez rapide, au bout de quelques secondes seulement. Je suis tombée dans un état d'anesthésie qui a duré environ ¾ d'heure. Ensuite, l'effet s'est rapidement estompé et au bout de deux heures, la douleur a recommencé. Pendant l'anesthésie, je me suis sentie très léger, comme si je vivais en dehors du corps douloureux, détachée de la lourdeur terrestre. Après le réveil, je n'ai pas ressenti de séquelles désagréables, d'étourdissement ou de maux de tête. Mon indolence m'a semblé trop court, j'ai répété l'injection. Cette fois, l'anesthésie s'est transformée en un profond sommeil jusqu'au matin.
Le deuxième soir, j'ai essayé "Mo". Nous avions appris lors de la formation des services sanitaires : Morphium hydrochloricum, alcaloïde principal de l'opium. Formule : C H O171932 O N-H. Dose unique la plus élevée : 0,02 (0,1 ou 0,2 sont déjà des doses mortelles). Après l'injection, l'effet de cette drogue n'a pas été aussi rapide qu'avec le SEE : ce n'est qu'au bout d'une dizaine de minutes que je suis tombé dans un état de somnolence, mais je me sentais étrangement à moitié éveillé. Mais ensuite, ce fut une expérience merveilleuse, dont la beauté ne peut être décrite. Les douleurs se sont soudainement envolées. J'ai eu l'impression de flotter en apesanteur dans l'espace, à environ un mètre au-dessus de mon lit, de me sentir merveilleusement léger et heureux ; une vague de bien-être a envahi tout mon corps. Des jeux de couleurs, généralement rouge-jaune-violet, se mêlaient à des expériences acoustiques où la musique classique alternait avec des compositions contemporaines. Des passages d'oratorios de Haendel alternaient avec des arias spirituelles de Bach, transparentes et merveilleusement de certaines musiques, je n'ai gardé en mémoire qu'un motif qui apparaissait régulièrement : C'était le motif principal du "Vieux château" de Moussorgski, une image sonore de "Tableaux d'une exposition" (1874). Tonalité de sol dièse mineur, avec le point d'orgue mélancolique en sol dièse majeur et le rythme solennel qui palpite.
Et dans cette musique, qui n'était pas jouée dans l'édition originale pour piano, mais dont le motif était interprété par un cor anglais, doux et triste, comme dans la version orchestrale des "Images" de Ravel - dans cette manière infiniment tendre, infiniment mélancolique, on répétait ce deux-zones français : "- des roses demi fanées sur le marbre d'un escalier". Le texte est tiré d'un poème romantique dont je cherche l'auteur depuis de nombreuses années.Les deux : la musique et la poésie s'unissaient en une unité enchanteresse. (Note de bas de page d'Alexander Kern : "Devant une façade rose, sur le marbre d‘un escalier." Aus "The Picture of Dorian Gray" von Oscar Wilde, 1891. )
D'un point de vue visuel, je pense que des souvenirs de châteaux et de jardins que j'avais vus un jour sont entrés en jeu. Peut-être la terrasse du palais Łazienki dans le parc près de Varsovie, ou au château de Charlottenburg, ou encore un bref aperçu d'un château néoclassique, couché au clair de lune, devant lequel nous avons défilé - entre Mlawa et Johannisburg - une nuit d'été, en juin 1941. Comment décrire de manière exhaustive cet état d'euphorie ? Pour moi, ce soir-là et le suivant, c'était un état dont parle Shakespeare dans le monologue d'Hamlet : "une consummation devoutly to be wished" Dans la traduction de Schlegel : "un but, à souhaiter intimement".
Après ces expériences, j'aurais aussi été prêt à souscrire au récit de l'écrivain anglais Thomas de Quincey (1822), qui s'exprime avec tant d'exubérance dans ses "Confessions d'un mangeur d'opium anglais" : "Ô opium juste, infiniment délicat et puissant, que tu apportes aux cœurs des pauvres et des riches sans distinction ... un baume apaisant. Opium puissant de la parole, que par ton discours, tu rends à la force d'une nuit les espoirs de sa jeunesse... Des profondeurs des ténèbres, de la matière imaginaire fantastique des cerveaux, tu fais apparaître des villes et des temples plus beaux que les œuvres de Praxitèle... et de l'anarchie du sommeil des rêves, tu appelles les visages de beautés depuis longtemps enterrées... Toi seul distribues ces dons aux hommes, et tu conserves les clés du paradis, ô juste opium, infiniment délicat et puissant !"
J'ai moi-même ressenti une grande partie de ce qui est dit ici sous l'emprise de la morphine, dans les fantasmes oniriques anesthésiés. Ils ont duré à l'époque - heureusement - pendant plusieurs heures. Mais - en se réveillant des beaux ravissements, en reconnaissant la misère grise des jours de guerre, si différente du ciel, dans l'étroitesse sourde, sombre, froide et sale du trou d'habitation de la chaumière russe, avec la blessure lancinante au doigt, l'inactivité forcée, tout l'environnement triste - les dures épreuves se sont révélées.
Les contraires, le choc de deux niveaux de vie totalement opposés. Les visions de rêve Mo, l'euphorie, étaient une fuite physique que je provoquais consciemment vers la sphère de vie antérieure de la paix, vers un "monde meilleur", comme l'a dit le poète Schober et comme l'a mis en musique Franz Schubert avec une beauté impérissable, au début du 19e siècle. Ainsi, à Karamsino, ma curiosité sur les effets des narcotiques a été satisfaite d'une manière particulière et complète. Lors d'essais ultérieurs, qui se sont prolongés jusqu'à la captivité, j'ai constaté que curieusement, les somnifères Veronal et Luminal (dérivés de l'acide barbiturique) ne m'ont pas donné de telles fantaisies : il n'y avait alors qu'une perte de conscience sourde et grave, et au réveil de violents maux de tête.
Le 4e soir, j'ai arrêté les injections d'anesthésiants :
1) parce que je n'avais presque plus mal et 2 ) parce que je pensais au traitement de nos blessés graves. Après des opérations du ventre et des amputations, nous leur avons fait des injections de Mo pendant trois soirs. Mais pour éviter que les blessés ne s'habituent à cet état (sans douleur), qui est certainement très souhaitable pour eux, nous avons remplacé le 4e soir le Mo par de l'eau distillée en quantité égale (2 centimètres cubes). Huit fois sur dix, les blessés ne remarquaient pas cette "correction" ; autrement dit, une fois qu'ils avaient reçu "leur" piqûre, ils étaient calmés et s'endormaient vraiment. "Pia fraus (pieuse tromperie) ?" Certes, mais faire naître un "morphiniste" est une méthode très dangereuse.
C'est une chose. J'ai toujours eu en tête le destin de mon parrain, le Dr Hugo Flemming, qui a travaillé quatre ans comme médecin d'état-major à l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale, sur des terrains de formation de troupes et des HVP. La terrible charge nerveuse l'a conduit à se faire "pour calmer" les nerfs d'injecter du Mo ; bien sûr, les doses augmentaient avec le temps : il est revenu de la guerre malade, mophinique au plus haut degré, n'a pas pu non plus se débarrasser du poison et s'est, désespérément, suicidé, à 36 ans.
Une pâle lueur du jour passait à travers la petite fenêtre opaque de notre maison russe : une nouvelle journée commençait ; pour moi, en apparence, une journée d'inactivité et d'inconforts divers, une journée d'attente de guérison. Et pourtant, cette journée était encore riche par rapport à celle de certains de mes camarades, car j'avais encore ma musique. Même ici, à plusieurs centaines de kilomètres de tout instrument de musique, je pouvais faire de la musique en esprit, sur le papier à musique de mon carnet, je pouvais écrire des notes, inventer des mouvements de chœur, des mouvements d'orgue, je pouvais composer ! C'était mon monde particulier d'activité intellectuelle intense, qui, même si ce n'était que pour une courte période, me permettait de me concentrer sur la musique.
Je me suis distingué de manière réjouissante de la misère qui m'entourait, de la "guerre et des grandes horreurs qui couvrent le monde entier", comme l'a écrit Paul Gerhardt pendant la guerre de Trente Ans.
Et c'est ainsi que j'ai devant moi aujourd'hui un trio pour orgue sur ce choral ("Nun laßt uns gehen und treten" EKG n° 42), que j'ai composé le 15 janvier 1942 dans la salle des paysans. 4 ans plus tard, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur mon orgue à Itzehoe, de le faire résonner pour la première fois. Et je n'ai pas eu besoin de changer une seule note : la sonorité que j'avais imaginée dans le désert de neige infini de la Russie centrale a résonné dans la réalité de l'espace familier de l'église, sur deux claviers et pédale.
Eté 1942, Alexander Kern n'a pas fait de récit écrit de cette période sur le front russe - il était en partie en vacances en Poméranie.
(photos à mettre)
10 Marseille – 24 décembre 1942
24 décembre 1942
Fin novembre 1942, notre division a été relevée en Russie. Pour nous "réapprovisionner" (Note: suite en réalité à de lourdes pertes subis par la division sur le front russe), nous sommes allés en France, dans l'ancien grand camp de troupes français de Mailly-le-Camp, près de Châlons-sur-Marne. De là, nous avons été transférés le 20 décembre dans le sud de la France, dans la zone française jusque-là non occupée. Lorsque nous nous réveillons le matin dans la paille de notre confortable les rives de la Méditerranée défilent devant nos yeux. A la gare de Marseille, nous sommes déchargée. Le 12 décembre, les Allemands ont occupé le sud de la France, jusque-là inoccupé, afin d'anticiper une invasion alliée depuis le Maroc.
Dès le départ, le bleu azur de la Méditerranée nous saluait. Une couleur tout à fait improbable, possible uniquement sous ce ciel ensoleillé. Nous marchons avec nos bagages dans les rues, en montée. L'ancienne cité couvre maintenant la grande baie du Golfe du Lion jusqu'en haut du versant de la montagne. Le soleil brûlant de la Provence se pose sur des villas d'un blanc éclatant, des jardins verts, des parois rocheuses gris argenté, scintillant de chaleur. Nous nous émerveillons devant la végétation : dans les jardins, palmiers, lauriers, cyprès, haies de roses. Avec la chaleur et la marche, l'uniforme nous donne bientôt bien chaud, alors que nous n'avons même pas de manteaux.
Quel changement : il y a quatre semaines, fin novembre, nous marchions en Russie (du Sud), dans la région de Ssytchevka, et nous nous réjouissions de chaque vêtement que nous pouvions enfiler pour rester au chaud dans cette neige infernale. - C'est l'été ici ! Nous continuons à monter jusqu'à la banlieue résidentielle d'Allauch. Nous sommes maintenant à environ 200 mètres au-dessus de la baie et avons une très belle vue sur le golfe, la ville et son grand port, des montagnes et des baies. Sur notre route de campagne, des particuliers travaillent dans leur jardin. Un vieil homme à gauche du chemin est en train de planter de petites salades délicates dans la terre noire et meuble. Décembre ? Noël ? Ici, on ne remarque pas l'hiver. Lorsque nous prenons nos quartiers, dans un grand bâtiment d'internat, les camarades sont bientôt en maillot de bain sur la terrasse et prennent un bain de soleil. Cela paraît invraisemblable, mais c'est ainsi.
Moi-même, je suis logé dans une grande villa vide. Salle de musique lambrissée, beau grand piano à queue, féerique quand on a passé 1 ½ an en Russie. Dans le jardin de mon quartier, j'admire les boutons de roses qui viennent d'éclore. Nous ne devons faire une "pause" ici que jusqu'à demain matin, puis nous partirons pour Aix-en- Provence. C'est donc ici, à Allauch, que nous passerons la veillée de Noël. En guise de saptin de noël, on ne trouve qu'un tout petit pin maigre, un parent de notre pin, ils poussent en haut des rochers au- dessus de notre internat. Nous décorons le petit arbre avec trois souches lumineuses et quelques guirlandes. Mais l'ambiance de Noël ne s'installe pas vraiment dans cet environnement. Lorsque la soirée à la compagnie se termine par une beuverie générale, je me retire dans "ma" villa et joue en solitaire dans la salle de musique de l'école de musique. "Histoire de Noël" de mon professeur Hugo Distler. Il est mort il y a six semaines à Berlin (j'ai appris pourquoi et comment des années plus tard). Le lendemain matin, je pouvais partir en vacances à Lauenburg en Poméranie, en passant par Marseille, Lyon, Strasbourg, Francfort, Berlin, Stettin - de nombreux kilomètres vers le nord.
11 OL Aix-en-Provence – De janvier à mai 1943
Janvier-mai 1943
Je traverse le magnifique cloître romain du couvent Saint-Sauveur d'Aix pour me rendre dans la cathédrale gothique. C'est le 1er jour de Pâques, à 6 heures du matin. Malgré la vingtaine de niches et d'autels latéraux qui disparaissent dans le crépuscule, l'intérieur médiéval d'un rouge sombre somptueux - colonnes imposantes et riches voûtes d'arêtes - est orienté vers l'immense maître-autel scintillant d'or sur lequel, aujourd'hui, en cette fête de la résurrection du Christ, des dizaines de lourds cierges sont allumés et brûlent dans une splendeur silencieuse, illuminant comme de l'intérieur la belle sculpture dorée du retable. Il semble que les figures des apôtres et des saints prennent vie dans la lueur vacillante. A gauche du maître-autel se trouve le siège épiscopal couvert, dont le mur du fond est orné des fleurs de lys des Bourbons. Je m'assieds tout au fond, près du portail ouest, sur un siège de prière. J'ai passé une nuit difficile, avec beaucoup d'émotions et très peu de sommeil.
Dans notre service de chirurgie de l'hôpital local, à "l'Hôtel de Dieu", à quelques pas de la cathédrale, nous avons opéré jusqu'à 12 heures du matin. En fin de soirée, des blessés graves sont arrivés de Marseille, victimes d'un attentat contre des soldats allemands, ce qui n'était pas rare à l'époque. Dans ce cas, un nègre avait sauté sur un tramway sur lequel se trouvaient plusieurs de nos soldats. Le nègre portait un panier couvert dans lequel se trouvaient des grenades à main qui, une fois explosées, tuèrent plusieurs compatriotes et civils, en blessèrent d'autres et tuèrent le nègre.
Après avoir soigné tous les blessés d'Aix jusqu'à minuit, j'ai dû monter 4 fois dans la nuit pour donner de la morphine et du cardiazol à plusieurs camarades qui étaient entre la vie et la mort et qui étaient constamment surveillés par nos infirmiers. L'Hôtel de Dieu est un grand hôpital civil français, nous avons installé notre unité chirurgicale de 70 lits dans une aile, et dans la salle d'opération de laquelle nous effectuons nos interventions.
Aujourd'hui, matin de Pâques, je veux entendre une parole de résurrection et j'ai confié pour une heure la surveillance du poste au sous-officier sanitaire Dall-mann. J'essaie de m'imprégner du calme de cette vieille nef. J'entends le grégorien ample de l'antienne, chantée par des voix de moines bien formés. Introït - Kyrie - Gloria in excelsis. Les lectures de l'Écriture ne sont pas faites en latin, mais en français ; je peux bien comprendre les mots familiers dans l'autre langue. (l'Évangile selon saint Marc 16, 1-3)
L'orgue se limite à de courts interludes. Beaucoup de bonnes vieilles tuyauteries dans les registres. Les chants de l'assemblée des fidèles semblent musicalement faibles à côté du grégorien bien en main, ils sont accompagnés avec beaucoup de parcimonie et de retenue. Dans la tribune de l'orgue, je vois l'organiste assis à la console devant une magnifique façade baroque. De puissantes tempêtes de basses. Je pense à mon orgue de Lauenburg et aux services de Pâques que nous y avons tenus ces dernières années dans le vieux cimetière, entre les tombes, avec le chœur de trombones : "tôt le matin, avant que le soleil ne se lève".
Ici, à Aix, je suis presque dans un autre monde, loin au sud de l'Europe, dans la ville du peintre Cézanne, dont la plaque de bronze est placée au-dessus d'une des nombreuses fontaines de la ville. La montagne Sainte-Victoire, qu'il a si souvent peinte, salue la chaîne de collines au-delà de la Durance, à l'est. Les cyprès sombres et flamboyants qui se trouvent devant font office de coulisses ; les cyprès dont le vert noir a tant plu à Vincent van Gogh. Il a rencontré la ville de manière unique lorsqu'il a peint ses tableaux dans les environs, à Arles et à St-Rémy. L'Aix-les- Bains de la province romaine de Gallia - culture ancienne, siège épiscopal et université. Des fouilles autour de la ville indiquent déjà la présence de colonies phéniciennes et pré- grecques dans la région. Des haies de cyprès noirs, des rochers gris et arides, des oliveraies gris argenté et la splendeur rose (en février déjà) des amandiers au printemps, le mistral nerveux qui traverse la vallée de la Durance. Il faut avoir vu ces intenses combinaisons de couleurs pour comprendre Cézanne et Van Gogh. En sortant doucement de la cathédrale après la messe de Pâques, de l'ombre fraîche au soleil éclatant qui vient d'un ciel bleu irréel, je suis heureux d'avoir ressenti quelque chose de Pâques, de cette foi en la résurrection qui unit tous les chrétiens d'Europe, au-delà de toutes les haines des belligérants.
En sortant doucement de la cathédrale après la messe de Pâques, de l'ombre fraîche au soleil éclatant qui vient d'un ciel bleu irréel, je suis heureux d'avoir ressenti quelque chose de Pâques, de cette foi en la résurrection qui unit tous les chrétiens d'Europe, au-delà de toutes les haines des belligérants.
12 Notre-Dame-de-Paris – Mai 1943
Mai 1943
Prélude : le médecin-major (Stabsarzt) Dr. Bügge est revenu à Aix après un voyage de service à Paris. Il s'extasiait sur les beautés de la métropole française. A la fin de son rapport, il me demanda : "Etes-vous déjà allé à Paris, Kern ?" Moi : "Non, Monsieur le médecin-major, malheureusement" ! - Pause - Puis le Dr Bügge dis : "Ça me fait penser, Kern, vous n'avez pas les pieds plats ?" (Je pense : Pieds plats ? J'ai parcouru 2500 kilomètres rien qu'en Russie avec mes pieds valides, qu'est-ce qu'il veut dire ?) A haute voix : "Oui, Monsieur le médecin-major, je les aient" Dr. Bügge : "Vous voyez, Kern, pour cela, vous avez besoin d'urgence de semelles pour vos bottes, et ces semelles ne sont fabriquées qu'à l'hôpital de guerre de Suresnes, en banlieue parisienne. C'est donc là que vous devez vous rendre ; et puis ils resteront quelques jours à Paris jusqu'à ce que les semelles soient prêtes. Je vous ferai établir tout de suite au bureau les pièces d'identité nécessaires pour ce voyage de service". Moi : "Oui, monsieur le médecin-major". Conclusion : sourires compréhensifs des deux côtés.
Un voyage d'affaires m'amène d'Aix à Paris. J'ai trois jours pour visiter cette belle ville. Je suis enthousiasmé et commence à deviner ce qui a attiré Hugo, Rilke et Ernst Jünger dans cette ville : la Seine et ses ponts, la place de la Concorde, les Champs-Élysées, l'Étoile, les Tuileries, le Louvre, le Dôme des Invalides, le Panthéon, la Sorbonne, le Bois-de-Boulogne, le Quai d'Orsay, la Tour d'Eiffel (que je trouve assez laide !), La Madeleine, St.Germain-des-Prés, Ste.-Chapelle, St.-Sulpice, L'Opéra, Place Vendôme, etc. Par où commencer ? Mais le graal pour moi, c'est la cathédrale Notre-Dame. Je suis devant l'immense façade ouest ; la tripartition horizontale et verticale de ce magnifique édifice, d'où émergent les tours tronquées, est d'un effet merveilleux dans ses dimensions harmonieuses. Je reste longtemps sur le "centre" de la France, sur la place devant la cathédrale. Puis j'entre, par l'un des lourds portails d'airain, à l'intérieur, dans la pénombre de la forêt de piliers. Les colonnes qui s'élèvent vers le ciel laissent plus deviner que voir la voûte du plafond dans la pénombre. Dans son rythme tranquille de piliers, la nef semble puissante, pleine de silence, hors du temps, en paix avec elle- même.
Je fais le tour du maître-autel et de toute l'abside, du demi-cercle des chapelles latérales, j'entre aussi dans le trésor de la cathédrale, je vois des calices, des crucifix, des coupes de plusieurs siècles, des ostensoirs et des évangéliaires étincelants d'or et de pierres précieuses, j'admire des sculptures anciennes, des grilles artistiquement fondues et forgées et des fresques très anciennes sur le mur du déambulatoire. Soudain, des chants grégoriens retentissent. Je retourne dans la nef. Une messe de requiem est célébrée devant le maître-autel. Le cercueil est exposé dans l'allée centrale. Un organiste aux cheveux blancs joue sur le grand orgue du jubé, à gauche du chœur. Je m'assieds sur l'un des nombreux tabourets de prière, j'écoute et je regarde.
Le requiem est terminé. Maintenant, pour accompagner le défunt, les prêtres et les enfants de chœur traversent solennellement l'allée centrale jusqu'au portail ouest. Des vêtements médiévaux aux couleurs vives, généralement blancs et rouges. En tête, une sorte de héraut avec un bâton d'argent, suivi de 8 prêtres et 30 enfants de chœur en petits manteaux rouges avec des cols de dentelle blanche. Puis vient le cercueil chargé de fleurs, porté par des hommes en noir, sur lequel se trouvent les proches et le cortège funèbre. L'organiste à l'orgue du jubé accompagne ce cortège avec la fugue en do mineur de Jean-Sébastien Bach.
Cette musique aux formes parfaites, le cortège funèbre mesuré et coloré qui traverse la nef de la cathédrale et la forêt de colonnes, forment une unité et une cohérence incroyables. On a l'impression d'être dans un autre monde. Les "démonstrations" de l'Église catholique ? Certes, mais ici tout a du style, tout est à sa place. Pour moi, Notre-Dame de Paris est l'une des plus belles églises gothiques.
Je l'ai vue trois fois pendant la guerre.
Les suites du voyage : De retour à Aix-en-Provence, j'ai contacté le chef de section, le médecin-major Dr. Bügge, et j'ai raconté mon histoire, visiblement pour lui faire plaisir. À la fin, le médecin-major me demanda en passant : "Et les semelles orthopédiques pour les pieds plats ?" Je répondis : "Vous savez, Monsieur le médecin-major, c'était comme un sort à Paris : je n'ai pas pus aller à l'hôpital de guerre de Suresnes ; il y avait toujours un empêchement !" Médecin-major : "C'est compréhensible, et ce n'étiat pas si urgent que ça comme intervention. On verra, peut-être la prochaine fois". Ce à quoi répond un échange de regards compréhensifs entre le médecin-major et le sergent, entre l'officier supérieur et le sous-officier, dans le sens de "We will try to make the best of it !" (aussi en anglais dans le texte original). Le terme "it" désigne certainement l'aliénation temporaire de notre vie privée par la guerre.
13 HVP Shebelinka/Isjum –17 juillet 1943
Front d'Izium-Mius en Ukraine, 17 juillet 1943
Après l'effondrement du front allemand entre Stalingrad et Rostov durant l'hiver 42-43 (au moment où nous étions en train de nous redéployer à l'ouest, car notre division avait subi de très lourdes pertes lors de la bataille défensive de Rshew), se trouvent nous maintenant, depuis juin, dans l'arc du Donetsk à le front du Mius , une position de réception au nord-ouest de Stalino, au nord de Dnepropetrovsk. Le site La 2e section de la compagnie sanitaire 2/353 a établi un poste de secours principal avancé dans le village de Schebelinka, à environ 2 kilomètres de la ligne de combat principale formée par la rive de la rivière Mius. Le village se compose d'une trentaine de maisons situées dans un ravin qui s'ouvre à l'est - vers l'ennemi - et qui est - probablement - visible par l'ennemi.
(Note de la version de travail : Le mépris de l'être humain avec lequel les certains généraux s'approprient des croix de chevalier avec les sacrifices de leurs compatriotes : "s'approprient", voir notre général de division Schmidt "mal au cou" : un régiment entier envoyé inutilement contre l'ennemi, à la mort, sur le front du Mius/bassin de Donetsk.)
Notre 2e section a reçu des remplaçants l'année précédente pour les nombreux départs, des blessés et encore plus de malades de la dysenterie et de la malaria. Les remplaçants nous avaient rejoints dans le sud de la France, où notre division avait été révisée et réapprovisionnée avant cette nouvelle mission à l'est.
Les Russes, on le savait, se trouvaient avec des forces supérieures sur l'autre rive du Mius. Notre division avait 40 kilomètres de rives à occuper sur la ligne de combat principale, contrairement à la longueur habituelle de la zone de la division qui n'était que de 12 à 14 kilomètres.
Nous avons à peine le temps de nous installer dans une ferme spacieuse et de former les remplaçants qui, venant directement de la garnison, n'ont que très peu d'expérience pratique, que les sankras arrivent déjà avec leur lot de douleurs et de blessures. Le travail sur les blessés commence et se poursuit sans relâche, surtout la nuit.
Parmi les "nouveaux" de notre équipe chirurgicale, je remarque un très jeune gradé du service sanitaire, Heinz Kares, de Düren en Rhénanie. Il vient d'être mobilisé après avoir terminé ses études secondaires, arraché à de beaux projets de formation professionnelle, il veut devenir musicien d'église. Il est ici, dans l'insouciance du jeune homme de 19 ans, le "Benjamin" de notre équipe, le plus jeune camarade que tout le monde aime (Benjamin, en hébreu se traduit littéralement par "fils de joie, fils de bonheur" !). Arno Mokroß l'emmène pour anesthésier, et Heinz se montre très réactif. Bien que le spectacle terrible, voire parfois horrible, des graves blessures et des grandes opérations soit tout à fait nouveau pour lui, il garde toujours l'attitude. J'ai l'impression que chez Heinz, plus tôt que chez certains autres camarades, le travail au front renforce le principe suivant : on peut faire beaucoup, si on veut aider. Hühnerbein (recte : Werner Fleischfresser, un tailleur très habile de Stettin, où il habite dans la Hühnerbeinstrasse : drum !) et Holzerland (un enseignant de Rostock, plus âgé et d'une pédanterie sans faille) sont nos deux nouveaux assistants "non stériles". Hühnerbein a déjà travaillé dans notre compagnie de la fin de l'été 1942 jusqu'à l'automne, dans la section du milieu. "Seppl" Draws (auxiliaire de dissection de l'institut de pathologie de Gotenhafen) utilise maintenant l'appareil de stérilisation et est exemplaire dans la précision de son travail. Après 14 jours, nous sommes bien rodés à Schebelinka et pouvons soigner un grand nombre de blessés.
Une journée ensoleillée et radieuse en Ukraine. Nous avons parlé de nuit, de nombreux blessés ont été soignés. Le médecin-major, le Dr Bügge, a sauvé une très mauvaise blessure à l'abdomen au cours d'une opération de trois heures. Maintenant, dans la matinée, une pause est intervenue.
Je suis allongé avec Heinz Kares sur le versant de la vallée profonde gorge à la lisière du village. Nous regardons le ciel bleu, aujourd'hui très paisible. Devant nous s'étendent des champs de tournesols à perte de vue. Une mer de corolles dorées qui vient de fleurir et qui s'étend jusqu'à l'horizon : un spectacle rare et magnifique. Heinz me parle de ses premiers essais à l'orgue lors des services religieux : il est musicien dans l'âme et très ouvert à tout ce qui peut le faire progresser dans la musique. Fils unique, ses parents ont toujours fortement encouragé ses penchants. Il a de grands projets pour ses études de musique sacrée. Nous parlons de la beauté inaltérable de la musique de Bach. Je parle des cérémonies d'orgue que j'ai jouées en France, de la diversité et de la beauté des cathédrales françaises. Nous méditons aussi sur le grand écart entre ce beau monde de la musique, ces valeurs d'éternité, et l'atrocité des génocides contemporains. Nous connaissons tous deux, même sans le dire, la paix qui est supérieure à tout ce qui est terrestre.
Un bruit sourd de moteur sur la hauteur au-dessus du village nous met la puce à l'oreille. Quelques chars allemands rampent sur le chemin d'altitude et tournent ensuite dans notre vallée, sans toutefois toucher notre village. (Nous nous en souviendrons plus tard : les observateurs ennemis ont dû voir cela et ont certainement supposé que les chars seraient arrivés chez nous, dans le village).
La journée s'écoule sans nouvelles arrivées de blessés.
Nous avions certes creusé des tranchées autour de la maison d'opération, des locaux pour les blessés et des abris, mais lorsque le soir, vers 11 heures, l'artillerie lourde russe a commencé à tirer sur notre village, nous n'avons pas eu le temps de nous mettre à l'abris. Elle s'abat sur nous par surprise, les impacts se succèdent sans interruption. Ce sont de puissants morceaux; les éclats bourdonnent et hurlent, ils s'enfoncent dans les épaisses poutres des murs en bois derrière lesquels nous sommes allongés à plat sur le sol. Heinz Kleinke et moi avons sauté dans une pièce voisine de la salle d'opération et nous nous pressons contre le sol en ciment, près du mur. La fenêtre au- dessus de nous se fend en deux sous l'effet des explosions et des éclats et est arrachée de son cadre. Les impacts sont très près du mur de la maison.
C'est une mauvaise situation : on est couché à plat sur la terre et on est totalement impuissant face à ce qui arrive, est-ce que ça te touche ou pas ? Il faut de l'énergie pour garder son sang-froid et ne pas se précipiter à la recherche d'une (peut- être) meilleure couverture, d'une tranchée. Il faut avoir des nerfs d'acier et de l'expérience.
Heinz Kares s'était rendu vers 11 heures dans la salle des blessés, en face de la salle d'opération, pour rendre visite au blessé grave de la nuit dernière pour lui faire une injection de morphine pour qu'il dorme tranquillement. Lorsque les premiers obus crépitent, Heinz est sur le chemin du retour. Il se jette immédiatement derrière un remblai de terre avec une couverture du côté ennemi. Le Dr Bügge, qui vient d'une autre salle des blessés, se jette à côté de lui. Nous n'avons cessé de répéter aux "nouveaux": à plat ventre, c'est le seul moyen de s'en sortir, à moins d'être touché de plein fouet. Ceux qui sautent sont généralement perdus à cause des éclats qui se baladent.
On aime la terre dans ces moments-là, on voudrait s'y glisser. On devient tout petit, on voudrait être encore plus petit. Les impacts se rapprochent à nouveau. D'après les secousses, il doit s'agir d'obus de 15 cm au moins. L'ennemi remonte lentement la rue du village à tâtons avec ses salves. Le Dr Bügge et Heinz sont à environ 15 mètres de la maison d'opération, à 3 mètres de la route. La couche suivante atterrit à 2 mètres de la salle d'opération. Les impacts suivants se trouvent tous autour de notre maison, tout autour, comme par miracle aucun ne touche directement . L'attaque, d'environ 30 tirs, ne dure que 11 minutes, mais celles-ci nous paraissent éternelles. On entend d'abord chez l'ennemi, sur l'autre rive du fleuve, le tir sourd, puis une pause, puis un fin chant aigu qui se rapproche à toute vitesse et s'intensifie, se dirige vers nous et se transforme en un son clair et hurlant. À ce moment-là, on sait déjà à peu près où ça va tomber : devant, à côté ou derrière nous. Le décompte des impacts tâtonnants, qui semblent chercher des vies humaines, fait froid dans le dos : voilà, les impacts sont à 100 mètres à droite, à 50 mètres à droite, à la prochaine salve ce sera notre tour, non, la chose crève à 10 mètres derrière nous, la suivante à nouveau à 50 mètres à gauche. C'est un calcul avec la mort. On n'est pas très courageux, on sue "sang et eau", même si l'habitude de ce genre de tirs fait beaucoup. On a peur, très peur ! Celui qui prétend le contraire est un menteur
Lorsqu'il y a, enfin, une pause de quelques secondes entre les tirs, Heinz veut faire les quelques pas qui le séparent de la salle d'opération.
À ce moment-là, l'un des derniers obus éclate au milieu de la route, à 20 mètres de là. Un éclat de cette grenade atteint Heinz à l'abdomen. Il arrive jusqu'à la porte du bloc opératoire, puis s'effondre. Le Dr Bügge est le premier à le rejoindre. L'attaque par le feu s'arrête aussi soudainement qu'elle a commencé. Comme s'il voulait encore avoir cette victime.
Arno, Heinz et moi sortons en courant de notre salle. Le Dr Bügge dit : "Tout de suite sur la table, attention". Je retire à Heinz le casque d'acier qu'il avait mis pour se protéger des éclats. Nous ne voyons sur lui aucune blessure, pas de sang. Nous allumons les deux grandes lampes d'opération qui fonctionnent sur batterie. Heureusement, ils sont restés intacts (comme tout ce qui se trouve dans la salle d'opération !); ils donnent une pâle lumière du jour verdâtre. En un éclair, Heinz est déshabillé. Ce n'est pas une grande blessure : un éclat de la taille d'un ongle a pénétré dans l'abdomen par le côté. Mais cet éclat a dû faire de terribles ravages dans l'intestin, car Heinz dépérit sous nos mains. Ses yeux effrayés sont de plus en plus grands, son visage de plus en plus pointu.
Un peu de tissu dépasse de la plaie abdominale. "Du filet", dit le docteur Bügge. Son regard laisse présager le pire. Nous préparons rapidement tout pour une transfusion sanguine. Il n'est pas question d'opérer dans un tel état de choc et de faiblesse. Heinz doit avoir perdu beaucoup de sang, des hémorragies internes, des déchirures intestinales. Dès le début de la transfusion, le cœur ne peut être ranimé que par des moyens puissants, le pouls s'arrête temporairement, la respiration s'affaiblit, nous lui donnons de l'oxygène. Le blessé ne supporterait pas un instant d'anesthésie. Il doit d'abord se rétablir avant que l'on puisse faire quoi que ce soit d'autre qu'une transfusion sanguine. Nous allongeons provisoirement Heinz sur une de nos couchettes. Je m'assieds à côté de lui et je lui administre en permanence des médicaments pour le cœur et la circulation sanguine par voie sous-cutanée.
En nous tous, il y a une grande tristesse : c'est justement Heinz, le plus jeune, notre benjamin. Le Dr Bügge essaie de faire des injections qui renforcent le cœur, et puis avec du digipurate, l'un de nos médicaments les plus puissants, qui a déjà permis de soigner de nombreux blessés graves. Mais chez Heinz, en plus de la blessure, l'effet du choc est trop grave : la respiration, le pouls, l'activité cardiaque s'affaiblissent de plus en plus. Heinz murmure des mots incohérents : "Aidez donc !" et "Les blessés" ! Le docteur Bügge lui caresse la tête pour le rassurer, cette tête qui semble maintenant aussi petite que celle d'un enfant. - C'est ainsi que Heinz Kares s'endort. Il est juste avant minuit. Son visage a une expression calme et étonnée.
Alors que nous nous efforçons tous d'aider Heinz, d'autres camarades amènent notre infirmier Friedrich Baumann sur une civière. Alors qu'il conduisait les blessés légers de sa salle dans les tranchées, il a lui-même été grièvement blessé au fémur. Nous soignons la blessure, pas trop importante mais dangereuse, et posons une attelle sur la jambe avec un grand plâtre de transport. Chez Baumann, l'effet de choc est inhabituel est très fort. On lui donne beaucoup de médicaments pour le cœur afin de le fortifier. Il est ramené le lendemain, il retourne à l'hôpital de campagne ; mais le surlendemain, le chauffeur de Sankra nous annonce la nouvelle, que Friedrich Baumann est décédé.
Le matin du jour suivant , nous avons trouvé à Shébelinka, rien qu'autour de la maison, 6 trous d'obus, dont chacun, si il avait explosé dans la maison, nous aurait emportés avec tout l'équipement de la salle d'opération. Les fenêtres avaient été arrachées et brisées, un dommage qui à été rapidement réparé.
Mais à midi, après notre déclaration de pertes, la division a donné l'ordre de déplacer le poste de secours principal vers le village de Kisseli, à environ 3 kilomètres à l'ouest. Cela a été fait avant tout pour évacuer de la zone de feu les blessés qui se trouvaient chez nous, car un certain nombre de nos blessés légers avaient été à nouveau blessés à Schebelinka lors de l'attaque.
Le 14 juillet, au coucher du soleil, nous avons enterré Heinz Kares, avec deux autres camarades, sur une colline de bouleaux au nord de Kisseli. Le prêtre de la division a tenu une brève cérémonie funèbre devant les tombes ouvertes et a parlé : "Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie". (Apocalypse 2,10) Le matin, alors que nous creusions les tombes sur la colline au-dessus de la maison du bloc opératoire, nous sommes tombés sous l'herbe sur les fondations d'une ancienne abside de chapelle, dont rien n'était visible au-dessus de la terre. C'est ainsi que nous avons pu enterrer Heinz Kares, à qui nous avions remis un tournesol dans ses mains jointes, dans une vieille terre d'église.
14 HVP Kisseli/Ukraine – Août 1943
Mort de fatigue, je suis allongé par terre sur un brancard à côté de la table d'opération et j'essaie de dormir. Nous avons encore opéré jusqu'à minuit. Le bruit saccadé de notre groupe électrogène, qui alimente notre salle d'opération en électricité, s'est arrêté. Hans Rugenstein, un jeune étudiant en mathématiques qui nous a rejoints en tant que remplaçant de Heinz Kares, est un homme discret et fin, spécialement formé pour l'appareil de radiographie léger dont nous disposons depuis peu et qui est d'une grande aide pour nos médecins en cas de blessures internes, de blessures par balle et de fractures par balle complexe.
Soudain, je sursaute : le bourdonnement subtil d'un Sankra qui démarre et qui a encore besoin de quelques minutes pour atteindre la maison d'opération. Comme il n'y avait pas de maison appropriée dans le village, la 4e section de la compagnie (autrichienne) a installé une baraque de la Wehrmacht dans un ravin étroit, avec de hauts murs de sable à droite et à gauche. Maintenant, le chauffeur de sankra klaxonne juste avant la maison. Je me lève et réveille l'équipe chirurgicale ; Rugenstein met en marche le groupe électrogène, Hühnerbein et Ebbe déchargent. C'est un blessé grave. Fritz Lessentin prend l'identité du blessé, il faut faire vite, car il est pâle à cause de la perte de sang. Il porte un garrot, on voit de graves déchirures au niveau de la jambe droite: une blessure de mine.
J'appelle le Dr Bügge, qui dort dans une ferme à 100 mètres du bloc opératoire. Sa voix est fatiguée au bout du fil. Je dis les choses nécessaires, probablement une amputation. Nous coupons le pantalon du blessé, ses sous-vêtements ; tout est couvert de croûtes de sang. L 'appareil de stérilisation de Seppl Draws est en ébullition déjà, bientôt les instruments nécessaires seront prêts. Le Dr Bügge apparaît en pyjama. Un coup d'œil : "Il faut poser le pied", me dit-il doucement. Je donne tout de suite du SEE faible (scopolamine- eucodal-éphédonine) comme induction de l'anesthésie ; le blessé est fatigué, calme, détendu.
L'équipe chirurgicale, qui se tient autour de la table, commence maintenant son travail ; tout a été répété des centaines de fois et bien rodé jusqu'au bout : les deux bras et la jambe saine du blessé sont attachés à la table d'opération à l'aide de sangles, mais rembourrés de manière à ce qu'aucun nerf ne soit comprimé ou coincé. La jambe blessée est lavée, la surface d'opération est rasée et iodée. Le blessé est maintenant à moitié endormi, Arno ajoute au début du chloréthylène, mais peu. Il met le masque d'anesthésie sur le nez et la bouche du blessé, il a recouvert les yeux d'une couche de gaze. Maintenant, il fait couler lentement le liquide du flacon compte-gouttes (éther) et dit au blessé : "Maintenant, compte lentement à rebours à partir de 100". Il ne compte que jusqu'à 94 et perd conscience. Arno a commencé par le chloréthylène et passe maintenant à l'éther. Sa main gauche tient le masque et touche en même temps la carotide du blessé avec le petit doigt, afin de pouvoir contrôler le pouls à tout moment. Plus tard, il vérifie souvent le réflexe des pupilles : en cas d'anesthésie profonde, la Pupille est petite, si elle s'agrandit, il y a danger. A côté d'Arno se trouvent : Pince à langue, barrière buccale, seringue record, Lebelin, Cardiazol et Digipurat. Une fois que le blessé s'est endormi, les assistants "non stériles" appliquent une poche de sang sur la cuisse à l'aide d'un fin tuyau en caoutchouc, qui est fixé à l'aide d'une chaîne.
Pendant ces préparatifs, le Dr Bügge et moi nous sommes lavés pendant ¼ d'heure avec une brosse et du savon de Marseille, jusqu'au coude, puis encore 5 minutes dans une solution de Sagrotan. Les brosses à main ont également été ébouillantées de manière stérile. Avant le lavage, j'ai disposé sur une table spéciale : Des blouses chirurgicales stériles, des serviettes chirurgicales et des gants en caoutchouc.
Sur la petite table mobile se trouvent les instruments ébouillantés pour l'amputation, ainsi que de la gaze stérile et des drains en caoutchouc. A portée de main, j'ai 3 bocaux avec des rouleaux de catgut de 3 couches d'épaisseurs et de la soie pour le bandage et les sutures. Après la toilette, je remets au Dr Bügge de la gaze stérile pour sécher les mains et les tampons saupoudrés de talc dans les gants stériles pour poudrer les mains avant d'enfiler les gants en caoutchouc.
L'amputation commence alors : du linge stérile sont fixés autour de la cuisse et de la jambe à l'aide de pinces. Seul le drap d'opération reste libre, le blessé ayant été préalablement recouvert. Un assistant tient le pied, un deuxième la cuisse vers le haut : les deux saisissent sous les draps stériles. Le drap d'opération est rouge-brun à cause de la peinture à l'iode. Le Dr Bügge commence par une incision de la peau en direction de la cuisse, afin de créer des lambeaux principaux suffisamment grands pour recouvrir le moignon. L'opération se déroule presque sans bruit. On entend seulement de temps en temps de brefs ordres du médecin lorsqu'il demande un instrument particulier. Les instruments nécessaires au cours de l'amputation, je les donne sans les poser de question : chaque outil est connu. Le Dr Bügge souhaite travailler dans le plus grand silence. Jamais un mot d'excitation n'est prononcé, jamais personne n'est accosté. (Nous avons également vu des médecins tout à fait différents qui, pleins de rage, tiraient des instruments dans la région lorsque les choses n'allaient pas comme ils le souhaitaient ou [ce qui est aussi arrivé !] lorsqu'ils ne savaient plus quoi faire et cherchaient maintenant un "coupable", comme par exemple le Dr Meinert [de sinistre mémoire] à Ssinzowo !)
Ensuite, l'amputation : la jambe ou le pied doivent être coupé assez haut (pour le pied, au niveau du molet) de manière à 1) laisser suffisamment de peau et de tissu musculaire pour recouvrir le moignon de l'os, 2) conserver le plus possible de la jambe, en raison d'une future prothèse. Le Dr Bügge détache la peau avec des scalpel, coupe deux bandes le long de la jambe et replace la peau. Les paquets de muscles sont maintenant à nu. Je présente le grand couteau à lamelles, un couteau très tranchant et large, avec lequel on coupe en une seule fois tout le tissu musculaire jusqu'aux os en faisant une incision circulaire ; on repousse ensuite la membrane osseuse du tibia et du péroné avec la râpe, on applique la scie à arc et on scie les os. La jambe détachée est ensuite enveloppé dans un drap chirurgical et emporté par l'assistant non stérile. Dehors, il est saupoudré de chlore et enterré dans une fosse que nous aménageons à cet effet sur chaque site de HVP. Il arrive que nous ayons besoin de plusieurs fosses.
Ensuite, les bords tranchants des extrémités osseuses sont arrondis à l'aide de la pince à os (double) ; la moelle est extraite de la cavité à l'aide d'une cuillère tranchante. Tous les gros vaisseaux visibles sont clampés dans la grande surface du muscle et plusieurs fois piqués avec du catgut et de la soie à l'aide d'une aiguille tranchante, ou ligaturés. Le nerf principal blanchâtre est retiré à l'aide d'une grande pince et brièvement coupé, il repart en arrière, profondément dans le moignon. Ce n'est qu'à ce moment-là que le vide de sang est relâché et que les petits vaisseaux qui saignent encore sont clampés et ligaturés. L'amputation est ainsi terminée. Le champ opératoire est propre. Les niches des lambeaux principaux sont recouvertes de gaze iodoformée. Une suture de situation fixe les extrémités de la peau sur le moignon ; celui-ci est enveloppé dans de la gaze stérile et proprement relié avec de grandes bandes, rembourrées de cellulose. Une grande barre conductrice en fil métallique est formée en arc de soutien, et le moignon est ensuite fixé à la partie supérieure par des bandes.
L'anesthésie a cessé depuis longtemps. Tout cela se passe en une heure à peine. Le patient fraîchement opéré est amené dans l'une des salles réservées aux blessés et installé. L'infirmier est assis à son chevet jusqu'à ce qu'il soit complètement réveillé de l'anesthésie. L'opéré reçoit alors une injection d'analgésique, qui le fait dormir à nouveau.
Nous avons vécu une situation déplorable,également en août 43, sur cette HVP.
Cela fait une heure que nous travaillons au bloc. Le médecin- major, le Dr Bügge, tente de faire passer une grave blessure à l'abdomen. Laparotomie = opération du ventre. Il fait si chaud dans notre baraque chirurgicale que nous ne portons qu'une chemise et un pantalon de sport sous notre blouse. Soudain, une attaque de soldats soviétiques commence.
La veille, le village de Kisseli a reçu des renforts de la troupe combattante. Notre baraquement chirurgical se trouve dans un ravin latéral, mais en direction de la route des avions. Les impacts de canon se rapprochent.
Le Dr Bügge ordonne alors à tous les membres du bloc opératoire de se rendre dans le bunker construit dans la paroi abrupte du ravin, à quelques mètres de l'entrée du bloc. A Arno (anesthésiste) et à moi (instrumentiste), le médecin-major dit : "Je ne peux pas vous ordonner de rester auprès du blessé ! Mais la vie du blessé dépend du fait que vous restiez à ses côtés" ! J'ai rapidement recouvert la grande blessure au ventre, avec l'intestin grêle qui a gonflé, de grandes couches de gaze stérile et je maintiens le tout dans cette position avec mes mains. Arno continue à mettre très peu d'éther sur le masque et contrôle le pouls du blessé. Les impacts des canons se trouvent maintenant dans la ferme d'à côté. Arno et moi sommes là, cloués au sol, et nous nous regardons. Un avion de combat rouge survole la baraque à basse altitude et tire sans s'arrêter. Une balle passe à travers la fenêtre derrière moi et à travers le plancher en planches à côté de mon pied droit, d'autres vont dans le mur du ravin à côté de la baraque et dans le toit. Au bout de trois minutes, c'est la fin de la hantise. Il ne nous est rien arrivé : nous avons été, une fois de plus, préservés. Le Dr Bügge sort du bunker les mains en l'air (pour préserver la stérilité) L'opération se poursuit, 2 heures, le camarade parvient à s'en sortir.
15 A propos des décorations : b) Croix de guerre de première classe – 30 janvier 1944
Châteaulin près de Brest/France, 30 janvier 1944
Depuis la fin de l'automne 1943, nous étions basés à Châteaulin, un petit chef-lieu d'arrondissement au sud-est de Brest, en Bretagne, dans l'ouest de la France. Châteaulin se trouve sur la petite rivière Aulne, à environ 12 kilomètres de la côte atlantique et du Mur de l'Atlantique. La division poméranienne (262e, 353e, 328e) a été reconstituée pour la 3e fois à l'ouest, après avoir été saignée à blanc pour la 3e fois en Russie depuis 1941.
Nous avions installé un hôpital local dans un internat catholique de la petite ville. C'était une période très calme pour nous. Le nombre de malades était faible ; il y avait parfois des blessés lors d'accidents. Tout au plus, un appendice pressé nous tirait-il un jour de nos lits la nuit : un travail d'étape tranquille ; dormir chaque nuit dans son lit, manger et faire son service à l'heure était un conte de fées après les missions à l'Est !
J'avais demandé à l'aumônier catholique de l'église de la ville (Monsieur le Curé), très prévenant, de m'indiquer l'emplacement de la clé de l'orgue dans l'église, pour moi et le camarade Kurt Reichl (licencié en théologie catholique) qui a été mon intermédiaire. Reichl était rédacteur de la feuille d'admission et de la feuille de maladie dans la compagnie sanitaire. Nous avons tous les deux fait une fois de plus l'expérience suivante : quand on parle à la population civile française dans sa langue, on obtient un tout autre rapport (positif) avec elle.
A l'époque, je jouais souvent à l'église de la ville le soir après le service. A deux reprises également (à la demande du médecin-major, le Dr Bügge), j'ai donné des concerts d'orgue pour les soldats allemands du site de Châteaulin et des environs. Au programme : Bach, Buxtehude, Pachelbel, Lübeck, Bruhns et des improvisations.
Le climat de la Bretagne était étonnamment doux. La péninsule, qui s'avance dans l'Atlantique, est tellement exposée au Gulf Stream qu'elle ne peut pas s'en passer. La ville est peu exposée au gel et à la neige alors qu'elle se trouve à la même altitude que Munich. Les palmiers peuvent rester dans les jardins tout l'hiver, nous n'avons connu qu'une courte chute de neige de novembre 43 à avril 44, et même celle-ci a dégelé le matin même.
Si notre chef de compagnie sanitaire (Sanitätskompaniechef) de l'époque, le médecin-chef (Oberstabsarzt) Gebhardt, n'avait déjà rien fait d'autre que signer et boire en Russie, l'accent était maintenant mis sur la beuverie. Célibataire, médecin militaire actif, cela signifiait, selon notre expérience de la guerre, ni soldat ni médecin. Pendant la guerre, nous, l'équipe chirurgicale, préférions travailler avec des médecins de réserve qui avaient déjà accompli quelque chose dans leur spécialité dans la vie civile. Le commandant de compagnie Gebhardt avait, en dehors des "occupations" déjà mentionnées, très peu d'intérêts intellectuels. Ses désirs littéraires étaient largement couverts par les Lore-Romane, si vivement brochés en jaune et rouge.
Un jour qu'il était à court de lecture en Russie, il m'a envoyé son garçon (il savait que j'avais toujours une petite valise avec une sélection de livres dans mon chariot de chirurgie, même si ce genre de choses "privées" était interdit). J'ai envoyé à Monsieur le médecin-major, volontiers et de manière circonstanciée, deux livres sur la médecine. deux célèbres romans : Henri Murger : "Scènes de la vie de bohême" et Oscar Wilde : "The Picture of Dorian Gray" ; bien sûr, tous deux texte original, pas les traductions. Cela aurait été une honte. Cela aurait été une insulte pour un universitaire. Après quelques jours, le chef a renvoyé les livres : "qui ne lui conviennent pas !" Très bien ! Il n'y a rien à faire.
Le médecin-chef (Stabsarzt) de la compagnie était le Dr Bügge. Il avait travaillé avec notre équipe chirurgicale en été et en automne 1943 en Ukraine, lors de la retraite du front d'Izioum sur le Dniepr vers Krivoy Rog et Nikolaevka, jusqu'à l'épuisement sur une douzaine de places HV, alors que le "chef" n'avait pas soigné un seul blessé pendant tout ce temps.
Le Dr Bügge avait été proposé fin 1943 pour le KVK I. Il avait été proposé à la division. Comme le commandant de compagnie n'avait pas encore cette médaille, c'était pour lui un défi à relever. Le médecin de la division avait observé à plusieurs reprises le travail de la 2e section sur les blessés en Russie lors de la violente retraite et savait ce que le Dr Bügge y avait accompli. J'avais alors été désigné par la compagnie pour la même "décoration" à la division, remise en personne par le Dr. Bügge.
Le 30 janvier 1944, le chef a fait entrer la compagnie en ligne, après le discours du Führer, habituel ce jour-là. Nous étions dans la cour de l'internat de Châteaulin, encore un peu sonnés. de la bravade et du vœu de victoire suspect du Gröfaz (acronyme de Größter Feldherr aller Zeiten le plus grand guerrier de tous les temps, surnom donné à Hitler). Le chef m'a mis l'étui avec le KVK I. dans la main ; il n'a même pas essayé de l'épingler ; les yeux vitreux, légèrement chancelant, les mains tremblantes) déjà fortement ivre le matin : c'est ainsi qu'il fête la "Prise de pouvoir de notre grand leader". Un chef, certes, exemplaire !
Le Dr. Bügge est arrivé avec un regard latéral indéfinissable sur le chef, s'est approché de moi et m'a félicité. Nous n'avions tous deux échangé qu'un regard alors que le "chef" sortait à peine les ordres nécessaires au départ de la compagnie. Mais Le regard en disait long. Dieu merci, Il y avait bien d'autres médecins dans la Wehrmacht que ce Oberstabsarzt.
France 01/02/1944
Ma chère mère !
Comme je sais que tu te réjouis avec nous, je voudrais t'écrire que j'ai reçu le 30 janvier la croix du mérite de guerre de 1ère classe avec épées. Six semaines avant moi, le Dr. Bügge l'a également reçue pour sa dernière mission difficile à l'Est. Comme il s'agit d'une distinction relativement rare, celà nous a fait très plaisir et je crois que j'en suis un peu fier.
Nous avons calculé qu'au cours des 3 mois de retraite, donc de l'engagement le plus dur, nous avons soigné environ 6800 blessés, et ce sur notre HVP. Ce n'est qu'un chiffre, mais il représente une montagne de souffrances, de douleurs, de patience et d'attitude admirable face aux pires blessures, et il signifie pour nous de nombreuses nuits de travail, de nombreux travaux dans des conditions extérieures très difficiles et des tirs fréquents. Ces jours-ci, j'ai reçu un paquet de Noël de la mère d'un cher camarade que nous avons perdu sur le Donets sous les tirs de l'artillerie, le caporal Heinz Kares, un jeune musicien d'église. J'ai alors donné à la mère un rapport détaillé sur les dernières heures de son fils, qui m'était également proche. Elle m'a envoyé, entre autres choses, un livre sur la facture d'orgue moderne provenant de la bibliothèque de son fils. J'ai été bouleversé par ce message et j'en suis très reconnaissant à la mère. Je suppose que tu t'es habituée à cette vie et que les petits-enfants ne te font pas trop de soucis. Ma Maria semble aller mieux et j'en suis très content. Je te salue, toi, Leusch et les petits.
Cordialement
On peut avoir des avis très partagés sur les médailles et les décorations. Actuellement (1949), ils sont largement méprisés. Personnellement, il me semble plus judicieux, d'un point de vue humain, d'aider à sauver et à préserver des vies humaines. Il n'y a pas de raison pour que la croix, symbole de l'amour du prochain, soit décernée à des personnes qui ont contribué de manière particulièrement active à la destruction de la vie humaine. Mais qui, en temps de guerre, demande un point de vue humain ?! La haine des peuples obscurcit tout !
En cela, dans l'engagement inconditionnel à aider, à sauver ce qui pouvait l'être dans les terribles blessures de la guerre, j'ai vu mon devoir pendant les six années où j'ai été soldat.
Je peux dire par expérience que beaucoup a été fait dans ce domaine, par les médecins et le personnel sanitaire, beaucoup plus que ce qui a été rendu public ; car ce travail s'est fait en silence, dans des circonstances peu héroïques, souvent au prix d'efforts indicibles et, sur le front, le plus souvent au prix d'un danger quotidien. C'était un travail difficile ; mais pour celui qui, Il a été fait dans le bon sens, dans le sens de la croix chrétienne. Il a été récompensé par la croix.
Que d'injures, de blasphèmes et de railleries ont été proférés à l'encontre du "caporal-chef sanitaire" pendant et après la guerre !
Qui écrira enfin l'éloge de l'accomplissement silencieux du devoir de 10 000 médecins et grades sanitaires allemands pendant la dernière guerre, qui ont souvent fait leur travail au péril de leur propre vie ? Ce serait un acte de justice ! Mais rares sont ceux qui ont vraiment appris à connaître et à respecter ce travail silencieux et fidèle. (Il rajoutera plus tard que cela à été fait grâce au livre de Peter Bamm (Stabsarzt Curt Emmerich) "Die unsichtbare Flagge", en anglais "The invisible Flag", traduis en français sous le nom de "l'étendard invisible" et difficile à trouver en version française)
16 HVP Château Monthuchon – 25/06 au 24/07/1944
Le 6 juin 1944, l'invasion des Alliés avait commencé sur la côte normande. Nous étions venus en Normandie depuis Châteaulin près de Brest, en Bretagne, au cours de longues marches nocturnes. Notre quartier général à partir du 25 juin était la ferme dans l'ancien parc du château de Monthuchon près de Coutances, qui se trouvait sur la route Coutances- Périers-Carentan. C'était un beau château Renaissance au milieu d'un parc très ancien. Dès le 6 juillet, nous avons installé notre salle d'opération dans le château et avons soigné de très nombreux blessés jusqu'au 24 juillet. Les conditions spatiales étaient favorables : au rez-de-chaussée, nous avons installé deux salles d'opération, les admissions, la pharmacie et, dans l'aile droite, la cuisine. Nous avons pu loger confortablement les blessés dans de grandes salles au premier étage. Nous avions en général une cinquantaine de blessés, les cas les plus légers étant transportés à l'hôpital de campagne d'Avranches. Dans le parc, nous avions aménagé un cimetière pour les Allemands décédés sur le champ de bataille et pour deux Américains qui sont décédés après de lourdes opérations. Notre menuisier de compagnie, le soldat Ernst Beyer, avait construit les croix funéraires et une grande croix de chêne sculpté, qui se trouvait ensuite au-dessus des tombes décorées de géraniums.
Dès le début de l'invasion, les Allemands ont eu pertes très importantes. Cela s'est encore aggravé fin juillet. Les chasseurs-bombardiers américains, appelés "Jabos", empêchaient presque tout ravitaillement en plein jour. Des blessés nous ont raconté comment, dans "certains milieux", on faisait face à cette entrave, à cette difficulté. Des groupes de SS près de Paris (selon les blessés) eurent l'idée "géniale" d'acheminer tout simplement des munitions vers le front dans des véhicules sanitaires, car ces véhicules ne seraient pas bombardés. Ainsi, fin juin, des wagons sanitaires et des camions entiers ont transporté des grenades vers l'avant : l'ennemi ne s'apercevrait de rien. (Pour ces "messieurs", il s'agissait certainement d'une "ruse nordique" autorisée. N'importe qui d'autre aurait considéré cela comme de la méchanceté et une violation de la convention internationale de La Haye) ! Mais l'ennemi "sentait la mèche" ; peut-être était-il aussi informé par des émetteurs secrets de la "Résistance". Début juillet, des jabos ont attaqué une colonne de Sankras à Saint-Lô avec des canons de bord. Le premier wagon a explosé dans un grand nuage de fumée, le deuxième a explosé, le troisième et le quatrième ont suivi. C'est là que les Américains sont devenus très méfiants, ils savaient ce qui se passait. Des rumeurs de représailles ont circulé par l'intermédiaire de la population civile, et notre poste de secours principal au Château a également été cité. Un soir nous avons reçu une alerte urgente concernant une attaque d'artillerie sur notre château. Nous avons reçu l'ordre de nous réfugier dans le voisinage. Nous sommes partis avec rapidement dans les allées de haies denses à 2 kilomètres du Château et rien ne s'est passé. Du flan ?!
Le 7 juillet, un jabo avait tout de même lâché 4 bombes sur la maison du gardien, située sur la route à environ 300 mètres de la cour du château. Un civil a été tué, un de nos légionnaires (Hiwi) a été blessé et une salle des blessés a été partiellement détruite. Comme une bifurcation de la route passe tout près de la conciergerie, nous avons pris ces jets comme une coïncidence, car la route elle-même était souvent bombardée. La confiance en la Convention de Genève avait tout de même été quelque peu entamée depuis.
Le 24 juillet, notre poste de secours principal devait être transféré. A midi, nous avions évacué tous les blessés vers Avranches. J'avais immédiatement emballé tout le matériel chirurgical avec l'équipe et l'avais chargé sur les chariots en acier. Les deux chariots de chirurgie déjà emballés se trouvaient dans le parc derrière le château, à environ 20 mètres du bâtiment principal et de la chapelle. Le toit du château, les façades nord et sud, les pelouses de la cour intérieure et La pelouse du parc était signalée par de grands drapeaux de la Croix-Rouge comme terrain de bandage principal, ne serait- ce que parce que les avions ennemis ronronnaient toute la journée.
L'après-midi, vers 3 heures, les gens de la pharmacie étaient en train de charger leurs médicaments. Deux gros camions étaient stationnés à cet effet devant la porte de l'aile sud, dans la partie nord de la cour intérieure, les chariots pour l'appareil de radiographie, le chariot du casino avec les bagages des officiers et deux camions du ravitaillement avaient été montés et étaient en train d'être chargés. Leur voiture était garée devant la maison des artisans, ils faisaient encore leurs bagages dans leurs quartiers.
A l'époque, les jabos passaient tellement au-dessus de nos têtes que nous n'y faisions même plus attention. Un jour, le Feldwebel Tesch a levé la tête par hasard et a remarqué qu'un des jabos avait soudainement tourné vers notre château et descendais. Moi-même, à ce moment-là, il était peu avant 3 heures, je suis allé avec trois personnes de ma deuxième section contourner la tour du château par la gauche, au sud, pour arriver à la chapelle du château et y chercher des brancards encore entreposés et les charger. J'étais accompagné du soldat Spieß (secrétaire du bloc opératoire), du soldat Reichl (secrétaire de dossier médical) et Werner Fleischfresser.
En quelques secondes, notre château a été attaqué par 8 Jabos qui, par groupes de quatre, ont déversé leur charge de bombes sur le château, les bâtiments de la cour et surtout la cour intérieure. Lorsque les premières bombes (de 100 kilos) ont explosé au milieu de la cour, tout le monde s'est empressé de se mettre à l'abri dans les tranchées, dans la cuisine et dans la cave du château. Nous quatre, nous nous sommes précipités dans la chapelle très massive ; à peine étions- nous dans l'entrée qu'une nouvelle bombe a explosé dans un fracas assourdissant, juste derrière nous, sur le mur sud, près de la tour. Nous disparûmes dans la chapelle et nous jetâmes sur le sol dans un étroit couloir de liaison avec le bloc II. A peine étions-nous allongés qu'une nouvelle bombe explosa sur le mur sud de la chapelle, arrachant la fenêtre de son cadre. Des plaques de plâtre se sont détachées de la et nous sont tombées dessus avec les tuiles.Nous attendions la prochaine bombe dans la chapelle, cela aurais été notre fin. Mais la suivante est encore tombée dans la cour. Pendant les minutes qui ont suivi, nous sommes restés tétanisés, comme paralysés. Le hurlement des Jabos, le fracas des explosions, généralement de quatre bombes, l'une après l'autre. étaient à couper le souffle. L'attaque terroriste (car s'en était une !) n'avait duré que 10 minutes. Pendant ce temps, 25 bombes d'un quintal sont tombées sur le Château et les environs immédiats. Lorsque le calme est revenu et que les jabos se sont éloignés, la première chose que nous avons entendue a été le cri de douleur de nos camarades blessés.
Les blessés qui se trouvaient chez nous il y a encore peu de temps étaient heureusement partis depuis midi.
Toujours dans l'attente d'une nouvelle attaque, nous avons couru autour de la tour sud vers la cour intérieure pour apporter notre aide. Le toit de la chapelle était maintenant entièrement recouvert. Le spectacle qui nous attendait dans la cour intérieure était le suivant : tous les camions et les voitures qui étaient arrivés étaient en flammes, des nuages de fumée et des flammes aveuglantes permettaient à peine de reconnaître les véhicules. La façade avant du château était éventrée au tiers par les explosions, la bibliothèque ouverte au premier étage était en feu. La porte d'entrée n'était plus qu'un tas de ruines, le quartier des artisans sur la droite un tas de pierres fumantes. Plusieurs grosses bombes non explosées se trouvaient juste à côté des camions en feu et devant la maison de la porte. A cause de la fumée et des flammes, nous ne pouvions presque rien voir de nos camarades blessés, mais nous les entendions. Ainsi, alors que le vent chassait la fumée, nous avons vu Hans Rugenstein allongé derrière le camion de radiologie. Sous le chariot du casino en feu, avec les bagages des officiers, se trouvait le garçon du chef, Obergefreiter Kothe, qui ne bougeait plus et brûlait comme le chariot au- dessus de lui. Comme nous ne pouvions pas passer à cause des grandes flammes du camion du pharmacien, nous avons fait le tour de la chapelle en courant et sommes passés par le bloc I et la salle d'opération. Le sous-officier Rafoth a été le premier à le rejoindre. Nous avons rapidement mis des garrots aux deux jambes. Rugenstein perdait beaucoup de sang ; il avait des fractures aux deux jambes dues à des éclats de bombe. Nous avons commencé par faire des bandages d'urgence. Le docteur Bügge sortit d'une des fosses à gravillons du parc au nord du château. Il a tout de suite demandé : "Qu'est-ce qui se passe avec Rugenstein" ? Il examina les graves blessures à la jambe et je compris que la situation était très grave. Rugenstein gémissait de douleur et me criait : "Morphine, sergent, morphine ! Je n'en peux plus !" De notre chariot chirurgical au fond du parc, j'ai très vite eu sous la main le matériel d'urgence ; et pendant qu'Ebbe et Hühnerbein appliquaient un deuxième pansement pansement sur le premier, qui était imbibé de sang, j'ai mis du morphium dans la peau de l'avant-bras, immédiatement après, Rugenstein s'évanoui. Il n'y avait plus rien à sauver pour le caporal-chef Franz Kothe sous le fourgon des officiers ; nous l'avons sorti de la zone de feu et couché sous les arbres du parc derrière le château.
Dans la reception, le sergent Tesch était allongé sous une table. Il avait un gros éclat dans le cerveau et était en train de mourir. Nous avons trouvé le caporal-chef Herbert Dieckhoff sur un talus à côté de la (ancienne) maison d'artisan ; il s'était vidé de son sang : un éclat lui avait traversé la cuisse: artère principale déchirée (fémorale). Il a dû se vider de son sang en quelques instants. La blessure se trouvait au niveau de l'aine. Un bandage aurait été impossible. (Herbert Dieckhoff était dans la même compagnie que moi depuis décembre 1939 ; ensemble, nous avions connu 3 fois la France et 2 fois la Russie ,maintenant, c'est ici, en Normandie, que ça l'a pris).
Le Dr Bügge avait sauté dans l'une des tranchées à éclats derrière l'aile nord du
château et s'en était sorti avec de petites égratignures sur la peau et un tympan perforé. Mais à seulement 10 mètres de lui, sur le côté nord du château, se trouvait notre cuisine de campagne, sur laquelle le sous-officier Bruno Marquardt, notre cuisinier, et un légionnaire, Rahimow, étaient en train de travailler ; c'est là qu'un coup direct était tombé. Il y avait maintenant un entonnoir de deux mètres de profondeur à l'endroit où se trouvait auparavant le canon à goulasch. Le lendemain, des camarades ont déterré leurs restes.
La maison des artisans du côté sud a également été touchée de plein fouet ; trois camarades ont été ensevelis - ils sont morts étouffés. Il s'agissait des caporaux Cholm, Ziethlow et de l'Obergefreiter Beyer, qui avait terminé et érigé la grande croix de chêne dans notre cimetière deux jours auparavant. A 25 mètres du château, derrière la maison des artisans, dans le jardin, nous avons trouvé le corps du sous- officier Bischoff, déchiré en deux. Une heure avant l'attaque, il était rentré de mission avec une compagnie du génie à Saint-Lô en disant : "Ici, chez vous, c'est quand même un peu plus calme que devant". Les photos de famille de son portefeuille entouraient son torse horriblement brûlé. Nous n'avons retrouvé que l'épaule et la tête d'un conducteur d'ambulance, le caporal Kaiser, qui se trouvait dans la cour du château.
Au moment du bombardement, le sergent-chef Anklam et le sergent Schenke (de passage) se trouvaient dans notre cimetière militaire. Tous deux se sont immédiatement jetés contre un talus sous les arbres ; le premier n'a rien eu, le sergent à côté de lui a eu le dos et la poitrine tellement déchirés par un gros éclat de bombe qu'il est mort immédiatement. La bombe dont les éclats l'ont atteint a explosé sur la tombe d'un Américain ; le sergent Konrad Wörpel se tenait près du cimetière. L'explosion lui a arraché la tête. Il était rentré il y a 14 jours son congé de noce.
Parmi les blessés, le sergent Heinz Bialonski avait une profonde blessure à la cuisse (c'était déjà sa 5e blessure !); le caporal Starck avait un éclat dans la jambe, les caporaux Delatre et Thiesen avaient des blessures plus légères.
Après avoir pansé nos blessés, nous avons à nouveau remarqué plusieurs jabos qui se dirigeaient vers le château. Bien sûr, nous nous sommes immédiatement mis à l'abri dans le parc avec les civières, le plus loin possible du château. Bien qu'il n'y ait plus eu de bombes, nous étions épuisés de l'attente d'un possible nouveau passage.
A l'accueil, le sergent Tesch était mort sans avoir repris connaissance. Au premier étage, la vieille comtesse Michel de Monthuchon gisait sur le seuil de sa chambre, morte, sans blessure apparente.
C'étaient les victimes du bombardement. Notre 1ère section avait ouvert il y a quelques jours un HVP dans un séminaire à environ 4 kilomètres au sud de Coutances, La Guérie. Comme nous ne pouvions pas soigner de blessés pour le moment, nous avons chargé nos blessés dans un sankra intact et les avons conduits au HVP de la 1ère section (médecin-chef Franke) à la Ferme La Guérie. Là-bas, Arno Mokroß, sergent sanitaire, était le responsable du bloc opératoire. Ils ont alors fait tout ce qui était humainement possible pour sauver Hans Rugenstein ; 2 transfusions sanguines, amputation de toute la jambe droite - mais il est quand même mort en début de soirée. Il était la 13e victime de cette journée.
Au Château Monthuchon, en fin d'après-midi, le Dr Bügge, a donné l'ordre d'atteler les chevaux, puis nous sommes sortis par l'arrière du parc avec les charettes encore disponibles, car vers l'avant, vers la rue principale, le chemin à travers le parc était trop étroit. La porte s'était effondrée et des bombes non explosées se trouvaient devant. Mais même derrière, nous devions d'abord ouvrir une brèche dans la clôture pour pouvoir sortir.
Nous avons agi de manière mécanique. J'étais comme assommé par ce bombardement et les lourdes pertes de la deuxième section : 13 morts et 4 blessés sur 30 hommes ! Lors de notre départ du Château Monthuchon, le corps central était en feu, de précieux livres anciens à moitié brûlés gisaient sur le pavé de la cour intérieure. Sur la pelouse devant le château, autour de deux profonds entonnoirs de bombes, se trouvaient les restes déchiquetés du grand drapeau de la Croix-Rouge que nous avions posé. - Nous avons passé la ville de Coutances et la ferme La Guérie pour nous rendre à la ferme Villadon-le-Sens près de Nicorps, à environ 3 kilomètres au sud de Coutances, où nous avons pris nos quartiers sans construire. Nos pertes matérielles lors de l'attaque furent également considérables : tout le kit sanitaire divisionnaire B avec tout l'équipement de rechange divisionnaire d'une compagnie sanitaire complète avait brûlé, ainsi que toute Pharmacie (Hauptverbandplatz-Apotheke), notre appareil de radiographie léger, un grand camion de vivres, mais que signifiait tout cela par rapport aux sacrifices en vies humaines !
Les restes des camarades disparus - ensevelis - ont été déterrés le lendemain matin au château de Monthuchon. Le château a complètement brûlé, seule la chapelle, bien que habimée, est restée debout.
L'après-midi du 26 juillet, nous avons enterré nos camarades dans le verger de la Ferme Villadon. C'était une longue file : Konrad Wörpel, sergent, 25 ans, agriculteur, était allongé là. Sa jeune femme, avec laquelle il avait fêté ses noces trois semaines auparavant, l'attendait à la maison.
Le caporal Herbert Dieckhoff, coiffeur de Deutsch-Krone, était allongé là. En rassemblant ses affaires personnelles, j'ai trouvé des lettres de sa femme qui répétaient : "- si seulement tu revenais de cette terrible guerre" !
Le sous-officier Bruno Marquardt, maître-boucher de Stettin, 46 ans, notre cuisinier depuis 1940, dont les remarques mordantes en marge du communiqué du parti et de la propagande de guerre étaient toujours suivies du récit de sa vie privée, qu'il appelait de ses vœux avec la fin imminente de la guerre, était allongé là.
C'est là que se trouvait notre tailleur de compagnie, le soldat Hans Ziethlow, Il n'avait jamais vraiment pénétré dans le monde de l'uniforme et, bien que certains se moquaient de lui, il restait un gentil garçon très solitaire. Il était resté un solitaire discret et sympathique.
Et là se trouvait le caporal-chef Hans Rugenstein, 20 ans, étudiant et fils de recteur de Stettin. En tant que mathématicien, il avait souvent la table des logarithmes sur la plaque de son appareil de radiographie. Il était intellectuellement bien au-dessus de la moyenne de beaucoup de ses camarades, un homme avec lequel on pouvait aussi discuter de sujets de nature intellectuelle. Mais il ne voulait pas entendre parler de politique, comme la plupart des soldats à l'extérieur. Son espoir : en finir au plus vite avec la guerre et reprendre ses chères études.
C'est là que se trouvait le caporal E. Cholm, 45 ans, sellier de Prenzlau, que sa femme et ses quatre enfants attendaient désormais en vain à la maison.
Le caporal-chef Hans Kothe, 50 ans, serveur dans la vie privée, était couché là, chez nous, auprès du chef de compagnie.
Et c'est là que se trouvait le jeune menuisier de 21 ans de la compagnie, le soldat Hans Beyer. La grande croix de chêne qu'il avait fabriquée et installée quelques jours plus tôt pour le cimetière militaire dans le jardin du château était maintenant devenue sa propre croix funéraire.
Et c'est là que se trouvaient aussi les camarades : sergent Tesch, sergent Schenke, sous-officier Bischoff, sous-officier Kaiser et le légionnaire Rahimow, qui se trouvaient tous "par hasard" sur notre place de formation principale au moment du bombardement et qui ont été frappés par la mort.
Tandis que nous nous tenions ainsi devant les tombes ouvertes, je m'imaginais que peut-être, à cet instant, les femmes ou les parents de tous ces camarades silencieux écrivaient des salutations à ceux qu'ils croyaient en bonne santé et vivants ; et que leurs salutations continueraient à parcourir l'Europe pendant des semaines, jusqu'à ce qu'ils fassent leur triste retour avec la mention phraséologique : "Adessat gefallen für Großdeutsch-land".
Le pasteur protestant de la division a prononcé un discours simple et une bénédiction. Le médecin de la division a parlé avec beaucoup de reconnaissance, puis nous avons fermé les tombes et les avons décorées avec toutes les fleurs que nous avions pu trouver à la Ferme et dans les jardins des environs.
Le Dr Bügge, s'est approché de la 2e section et a serré la main de chacun d'eux. Puis il a dit doucement : "Hans Rugenstein". Cela sonnait comme un adieu : nous le pleurions tous particulièrement. Puis nous sommes restés immobiles à la vue des nombreuses tombes. Aucun d'entre nous n'a bougé et aucun d'entre nous n'a manqué les larmes dans les yeux de notre chef de section. Cet homme exemplaire et excellent médecin ne nous a pas seulement commandés, mais il nous a aussi guidés dans le meilleur sens du terme et il a tout porté avec nous.
Au-dessus de nous, à Villadon, passaient des centaines de bombardiers quadrimoteurs, superforteresses des Alliés, dont les tapis de bombes ont littéralement effacé le front allemand entre Saint-Lô et Caen.
Le lendemain commença notre fuite, la fuite vers l'est de ce qui restait des armées allemandes de l'Atlantique, la fuite devant les chars et les jabos américains, via Avranches, où nous échappâmes de justesse à la capture, via Ducay, St-Hilaire, Bagnoles-de-l'Orne, Évreux, Rambouillet, Corbeil, Montmirail, Soissons, St-Quentin, Mons - la fuite qui ne s'arrêta ensuite qu'à Aix-la-Chapelle, à la frontière de l'Allemagne.
Notes d'Alexander Kern dans le texte au propre : L'attaque du Jabo sur notre place de formation principale de Monthuchon n'était pas un cas isolé : Helmut Günther écrit dans son récit de guerre : Nous roulions depuis quelques heures déjà, nous avions laissé derrière nous Tessy, Le Mesnil-Raoult, Cerisy-la- Salle et traversé la route Coutances-Saint-Lô. C'est alors que nous avons vu, peut-être deux kilomètres devant nous, des nuages de fumée noirs et jaunes qui s'élevaient. En s'approchant : une odeur pénétrante. Puis nous nous sommes approchés ; une image chaotique ! Environ 6 grands bus sanitaires complètement brûlés sur le bord de la route. Les quelques rescapés se tiennent debout, apathiques, à peine capables de réagir. Les restes de corps carbonisés jonchent la route. Certains blessés ont tenté de s'éloigner en boitant des véhicules en feu. Ils n'ont pas réussi à s'en sortir ! D'autres se sont accrochés aux fenêtres sans vitres. Les pauvres bougres, qui espéraient être bientôt soignés dans un hôpital militaire, étaient éparpillés sur une cinquantaine de mètres. Les hommes de notre convoi ont aidé les infirmiers survivants à enterrer les morts. Ce transport de blessés, parfaitement identifié comme tel, avait été entièrement mitraillé par les Jabos. On reconnaissait encore les contours des immenses croix rouges sur les toits calcinés par le feu. "Ils n'arrêtaient pas de voler et de tirer de toutes leurs forces jusqu'à ce que plus rien ne bouge", a raconté l'un des infirmiers. "Une performance remarquable de l'armée de l'air", a déclaré Graf avec amertume. C'est ce qui s'est passé sur la route Marigny-Saint-Sauveur en Normandie le 14/06/1944 !
17 Avranches/Normandie – 30 juillet 1944
Depuis la fin juillet, le front d'invasion avait vacillé, les Alliés s'étaient mis en marche. Avec mille bombes, ils avaient détruit notre ligne de front. La division de la jeunesse hitlérienne "Großdeutschland", engagée vers le 20 juillet dans la région de Saint-Lô-Périers, avait subi de très grosses pertes. Un jeune homme de 17 ans avais été capturé par les Américains, avaient coupé son pantalon d'uniforme en "short" et l'avait renvoyé vers les lignes allemandes avec la mention mention : "Nous ne faisons pas la guerre aux enfants" !
Les blessés (en partie certains vraiment très jeunes) de cette division qui sont passés par notre station de soin (HVP) ont parlé des tapis de bombes : "Même si les bombes et les mines aériennes n'explosaient pas directement devant ou à côté de nous, nous étions tout de même projetés à des mètres de hauteur hors des trous de nos abris par la force de la pression de l'air".
L'ennemi progressa rapidement à Caen et Saint-Lô, la presqu'île de Cherbourg fut coupée. Début juillet, le front se trouvait encore quelque temps en travers de la presqu'île à Périers. Puis, avec l'avancée des Américains sur St-Lô, tout le front s'est mis en mouvement, après la rupture du mur de l'Atlantique, ce n'était qu'une question de temps. Au premier jour de l'invasion anglo-américaine et du débarquement rapide dans la baie de Caen, nous avons entendu des détails sur les blessés indignés à la station de soin principal. Un caporal-chef (Obergefreiter von der Ari) près de Carentan raconte : "Lorsque les navires ennemis sont entrés dans la baie le 6 juin, nous avions l'interdiction de tirer depuis minuit. Celle-ci n'a pas été levée lorsque les premières barques de débarquement se sont approchées de la côte ; sur les demandes de plus en plus pressantes de notre officier, nous avons finalement obtenu l'autorisation de tirer alors que Les chars étaient déjà sur la plage".
Un autre soldat du Mur de l'Atlantique près d'Arromanches, qui nous a rejoints via Saint-Lô, raconte : "Le 4 juin, les munitions de notre batterie ont été chargées et emportées pour être échangées contre des 'nouvelles', comme on disait. Le 6 juin, elle n'était évidemment pas là. C'était un coup monté, mais au détriment de nos vies ! Dans le secteur voisin, les chefs de pièce n'avaient pas le droit de tirer, même si les Américains et les Tommies atterrissaient sous leurs yeux. Ce n'est que lorsqu'il était trop tard que l'autorisation de tirer est arrivée, mais il y avait déjà des chars ennemis entre nos bunkers" !
Ce sont deux rapports de personnes différentes que j'ai entendues sur la HVP. L'organisation de la défense du mur de l'Atlantique le 6 juin 1944 n'était sans doute pas aussi irréprochable que cela. - Or, fin juillet, le front allemand était déjà en pleine désintégration. Nous étions venus de Villadon en deux marches nocturnes vers le sud, dans la région d'Arvanches. Nous avions peint toutes nos voitures en blanc à l'huile et dessiné de grandes croix rouges sur les bâches. Dans la nuit du 29 juillet, des bombardiers de nuit et des jabos ont attaqué les colonnes en marche devant et derrière nous. Dans la lumière vive des arbres de noël (Cascades lumineuses au magnésium, allumées depuis les avions pour éclairer la zone de largage des bombes la nuit) , nos voitures se détachaient si bien que nous n'étions pas harcelés : la croix rouge était respectée ! Le matin, à 5 heures, nous avons fait une pause dans un très beau château appelé Champcey, dans la baie de St-Malo, juste avant Avranches. Le château est situé dans un magnifique et vaste parc avec de magnifiques groupes de pins qui s'étend jusqu'à l'eau de la baie.
"Nous devons être prêts à partir", a dit le chef. Nous avons donc remballé. (Mais le midi arrive, le soir arrive...) et le chef n'avait toujours pas reçu d'ordre de départ de la division. Mais il ne pouvait (devait) pas partir sans cela, car ce genre de chose était très mal perçus, comme une "fuite" et tout ça. Dans l'arrière-pays français, il y avait des barrages de la Feldpolizei, les "chiens à la chaîne" comme on les appelait, ils en voulaient vraiment ! Nous avons transporté nos quelques blessés à l'hôpital de guerre de Bagnoles-de-l'Orne, près d'Argentan. -
Nous n'avons sorti que le minimum necessaire et avons soigné quelques blessés qui se présentaient chez nous. Lorsque le chef de compagnie s'est réveillé et a appris que la 2e section (Dr. Bügge) avait déjà soigné des blessés après l'agitation de la nuit, sans qu'on lui ait demandé l'autorisation, il était furieux. Lorsqu'il apprit en plus que nous avions même déjà stocké des blessés chez nous, ce fut la fin ! Nous avons dû immédiatement remballer tout le matériel et avons reçu l'ordre de refuser et d'envoyer d'éventuels nouveaux blessés ailleurs. Raison invoquée : Nous "devions être prêt à partir d'une minute à l'autre". Nous avons donc remballé.
Avec les officiers, je me suis assis, à l'invitation des habitants du château (l'homme avait été fait prisonnier par les Allemands en 1916-1918), dans la grande salle du jardin avec vue sur le magnifique parc à l'anglaise : des groupes d'arbres pittoresques, des pelouses bien entretenues et par un passage entre les arbres, on avait une vue magnifique sur le Mont Saint-Michel, situé au milieu de la baie de Saint-Malo.
Cette montagne-église se dresse sur un haut rocher de granit qui émerge de la mer des Wadden dans la baie et sur lequel se trouve une ancienne abbaye couronnée par une église gothique = le rêve d'une architecture médiévale ! Avant le coucher du soleil, nous sommes montés sur la tour du château de Champcey et de là, dans les derniers éclats du soleil couchant, nous avons vu le magnifique édifice gothique se dresser devant nous dans la mer. L'ancienne église fortifiée est entourée d'une muraille.
La haute tour pointue pointe vers le ciel comme un doigt. Déjà à l'époque des Celtes, bien avant la naissance du Christ, il y avait ici un sanctuaire druidique et, selon la légende, longtemps après la christianisation de la France, des prêtres druides ont continué à vénérer les dieux celtes dans cet endroit isolé. L'église-forteresse, île fermée dans la mer a été assiégée à plusieurs reprises par la suite, mais aucune armée de siège n'a pu la maintenir, l'endroit étant sans cesse inondée. C'est ainsi que ce bel édifice a été préservé au fil des siècles.
C'était comme si la Normandie, ce beau morceau de paysage français, nous offrait ce soir-là une dernière vue d'Avranches sur le Mont-Saint-Michel, saluait avant notre fuite vers l'est, vers l'Allemagne. La paix de cette image contrastait tellement avec l'actualité l'actualité qui nous entourait ces derniers temps, ces jours et ces semaines. Nous nous tenions en silence sur l'altan (terrasse), jusqu'aux premiers bancs de brouillard sombres de la mer : la silhouette du Mont-St. ternissaient, puis s'effaçaient. En bas, dans la salle du jardin, avec la vue sur le parc, j'ai joué, à la demande du médecin-major sur le très bon piano à queue. Encore quelques morceaux de Bach et de Schumann. Les résidents français du Château m'ont remercié, cela a dû leur plaire, cela m'a plu. La nuit, les impacts de l'Ari américaine se rapprochaient dangereusement. Nous avons encore reçu quelques blessés en état de marcher, mais nous nous sommes contentés de leur faire de nouveaux pansements et nous avons continué à les envoyer.
Le 30 juillet, à 6 heures du matin, un informateur de la division est venu déposer un blessé à la jambe chez nous, mais il n'avait pas encore d'ordre de marche pour le chef. Celui-ci devint alors très nerveux. Le tumulte de l'Ari se rapprochait. Finalement, vers midi, un message indiqua notre nouveau lieu d'intervention à l'est d'Avranches. Nos chevaux se mirent à trotter à toute vitesse. Personne n'avait besoin de donner d'ordre. L'air au-dessus de la route principale d'Avranches, dans laquelle nous nous sommes engagés depuis le château, grouillait vers le sud de jabos et de chasseurs, mais ils ne nous ont pas attaqués.
Notre "chef" avait depuis longtemps disparu vers le sud, derrière l'horizon, dans sa voiture, avec son "état-major" (Führungsstab). L'officier supérieur était maintenant le Dr Bügge. Le "chef" s'est sans doute dit : "Maintenant, tu vas voir comment tu vas sortir cette bande du pétrin ! Un vrai "Führer", comme on dit, ce chef de compagnie Gebhardt ! Pour notre médecin-major, c'était une tâche peu agréable. Nous avons dû suivre la route principale vers le sud pendant environ 2,5 kilomètres avant de tourner à gauche vers l'est. en direction de Saint-Hilaire. Sur la route, nous avons dû
pas une tâche très agréable. Nous devions encore suivre la route principale vers le sud sur environ 2,5 kilomètres avant de pouvoir tourner à gauche vers l'est en direction de Saint-Hilaire. Sur la route, nous avons dû passer tout près de camions et de chars en feu qui avaient été venaient d'être abattus par des jabos. Les chevaux s'effrayaient devant les hautes flammes. Nous, les soldats, nous marchions toujours au au pas de course derrière et à côté de nos voitures.
C'est alors que le cri "chars américains en hauteur" est venu de derrière nous ! Cela signifiait donc à peu près à la hauteur du Château Champcey que nous venions de quitter. C'est alors qu'a commencé une chasse effrénée, une fuite éperdue. Les conducteurs frappaient les chevaux avec frénésie, ceux-ci partaient au grand galop ; nous nous sommes accrochés aux planches et aux sièges des véhicules. Au-dessus de nous, les obus de chars américains hurlaient en bombardant la ville d'Avranches devant nous dans la vallée.
Là - enfin - notre chemin a tourné à gauche, vers l'est ; nous nous sommes engagés dans cette rue latérale et la chasse sauvage a continué pendant plusieurs kilomètres, maintenant dans la forêt ; la plupart du temps, c'était en descente et la route était bonne. Puis nous nous sommes arrêtés dans une section de forêt dense. Les chevaux étaient complètement épuisés.
Sur la route d'Avranches, à cette époque, les chars américains nous avaient dépassés vers le sud et avaient pris la ville. Le lendemain déjà, ils bloquaient la Bretagne à Rennes. Seules les bases allemandes : Brest, Lorient, St-Nazaire et La Rochelle se maintinrent encore quelques mois.
Nous avons continué à marcher vers l'est.
Peu avant un village, quatre jabos nous sont tombés dessus. Nous avions encore ces bêtes sur l'estomac depuis Monthuchon. Nous avons disparu comme la foudre dans les fossés à droite et à gauche. Les bombes ont explosé dans un grand fracas à 50 mètres de nous. Ils ne nous ciblaient pas, mais un petit pont de pierre sur la Sélune. Les Jabos sont encore passés trois fois au-dessus de nos têtes et ont lancé leurs bombes ; mais même avec 12 bombes, ils n'ont pas atteint le pont. Lorsqu'ils sont partis, nous avons pu passer sans encombre. La marche s'est poursuivie tard dans la nuit. Nous avons dormi quelques courtes heures sous les arbres près du village de Ducey,qui nous avait été indiqué comme nouveau lieu d'intervention. Mais il a été si vite occupé par les Américains que nous ne nous sommes pas installés. La course avec les chars américains s'est poursuivie dans toute la France jusqu'à la frontière allemande.
Nous avons ainsi échappé de justesse à la captivité américaine en Normandie.
18 HVP Maison forestière Rodt/Belgique – 26 décembre 1944
Le dernier effort de la Wehrmacht, le 16 décembre, a enfoncé un coin important dans le front américain. Les troupes allemandes arrivèrent à l'ouest, par temps favorable (brouillard et pluie), tout près de Dinant, car l'aviation américaine ne pouvait pas opérer.
Les points chauds de St. Vith, Clervaux, Wiltz, Houfflize ont été pris, Bastogne a été encerclée. Le succès de la surprise dura jusqu'au 25 décembre. Puis le temps devint clair et les bombardiers alliés arrivèrent : tout ravitaillement fut interrompu pendant la journée. Dans la région de l'Eifel, environ 10.000 Américains furent pris au piège et se rendirent le 19 décembre.
Lors de notre 1er HVP à partir du 15 décembre à Bleialf, au nord-ouest du cirque de Schneeeifel, nous avons soigné non seulement de nombreux Allemands, mais aussi quelques dizaines de soldats américains.
L'attaque soudaine des Allemands les avait chassés de leurs quartiers confortables (tentes chauffées !) dans les forêts enneigées des sommets. Au bout de deux jours, beaucoup d'entre eux se sont rendus, victimes de gelures aux deuxième et troisième degrés. Ces Américains étaient loin d'être aussi endurcis que leurs compatriotes allemands.
Le chroniqueur américain John Toland indique dans son rapport : Nous avons fait remarquer à la "bataille des Ardennes" que c'était la première fois que l'armée américaine vivait une guerre d'hiver et que les pertes dues aux engelures étaient aussi élevées que celles dues aux blessures. Nous avons appliqué d'épais pansements d'huile de foie de morue sur les membres gelés des Américains avant qu'ils ne soient envoyés à l'hôpital.
Un caporal du convois de ravitaillement m'a apporté cinq livres de musique dans des enveloppes jaunes, provenant du quartier d'un officier américain quitté précipitamment. Il m'a dit : "Il y a des trucs d'opéra dedans, je ne peux rien en faire" ! Il s'agissait de 5 partitions de poche (Eulenburg) de symphonies de Beethoven ! Le caporal avait tiré de "op. 125" (9ème symphonie) "opéra". C'était bien sûr pour moi un cadeau des plus bienvenus. - La préparation allemande pour cette offensive des Ardennes avait été très minutieuse. Afin de confondre les postes de commandement dans l'arrière-pays, toute une compagnie d'Allemands parlant bien l'anglais avait été formée pendant des semaines : Uniformes, armes, nourriture, objets usuels, enseignement tactique, divertissement en anglais uniquement. L'unité était dirigée par le major SS Skorzeny, le libérateur de Mussolini.
En tant que "coursiers", ces hommes étaient conduits derrière les lignes américaines vers les états-majors dans des jeeps ; ils échangeaient ou détruisaient des groupes entiers de panneaux routiers. Ils semaient la panique dans les postes de commandement à l'arrière en donnant de fausses informations sur les incursions allemandes. Ils devaient s'emparer des ponts sur la Meuse. Lorsque, après plusieurs jours, les Américains ont pris le contrôle de la ville, ils ont été contraints de se retirer. Comme les Allemands "sentaient le rôti", la police militaire effectuait des contrôles à chaque carrefour. On demandait aux GI ou aux officiers inconnus qui arrivaient des choses purement américaines comme : "Qui est le bombardier marron ?" La réponse devait être : "Le boxeur Joe Louis". Ou "Comment s'appelle la petite amie de Mickey Mouse ?" Celui qui répondait de manière insuffisante était désarmé et capturé, soupçonné d'être un "Skorzeny man". Même un général américain a été arrêté et détenu pendant sept heures de cette manière ! (Général Bruce Clarke)
Même sur notre HVP, nous avons reçus deux Allemands déguisés en Américains, qui se sont fait remarquer en répondant tantôt en anglais, tantôt couramment en allemand. Ils ont été dirigés vers la division.
Notre HVP Forsthaus Rodt (depuis le 20 décembre) se trouvait à peine à 3 kilomètres de l'un des points chauds de l'offensive, St Vith. Nous envoyions nos blessés transportables à l'hôpital de campagne installé dans la grande école du couvent de Saint-Vith. Sur notre HVP, toutes les salles disponibles ont été rapidement occupées. Il était dérangeant qu'au premier étage, cinq officiers SS s'étaient déjà installés (déjà avant notre arrivée). Ils faisaient peut-être partie de la 1ère ou 2ème division blindée SS engagée dans la région de Malmedy.
Lorsque nos salles du bas étaient pleines, le médecin-major, le Dr Bügge, est monté au premier étage. De manière courtoise, il a demandé aux SS de nous faire de la place pour d'autres blessés, en se contentant d'une des trois grandes chambres qu'ils occupaient actuellement. Il (Bügge) pourrait ainsi stocker plus de blessés. La réponse fut un refus moqueur ! Ce à quoi le médecin-major répondit qu'il devrait alors utiliser le grand couloir spacieux de l'hôpital. L'un de ces "messieurs" prétentieux m'a alors dit : "Si vous faites cela, attendez- vous à ce que nous marchions sur vos hommes !"
De retour au rez-de-chaussée, le Dr Bügge a immédiatement choisi 10 blessés, uniquement des unités SS, et les a fait allonger sur de la paille et des couvertures de laine au premier étage, dans le couloir. Il ne s'est alors rien passé du côté des officiers SS. "Bande d'enflures !" C'est ainsi que les a qualifiés le médecin-major. "Camarade = SS !"? Et le lendemain matin, les cinq héros SS avaient discrètement disparu, ils s'étaient faits tout petits. Ils n'ont laissé derrière eux qu'une batterie entière de bouteilles d'alcool vidées, la plupart du temps du Hennessy XXX, symbolique pour les consommateurs !
Afin de rendre inutilisable pour les Allemands le carrefour routier décisif de St.Vith, de l'anéantir complètement, 300 bombardiers anglais Lancaster et Halifax arrivèrent le jour de Noël, par un temps désormais clair, et déversèrent leur charge sur la petite ville (où se situais aussi un hôpital militaire). Il ne restait plus qu'une ville en ruines et en feu. Sur 1000 civils, 200 sont morts dans les caves !
Du premier étage de notre maison forestière, nous avons vu et entendu cet inforeno d'un tapis de bombes où les maisons et les arbres s'élevaient littéralement dans les airs avant de s'effondrer en tas de débris.
Nous avons appris un terrible destin individuel à St-Vith deux heures après le bombardement. Un sous-officier sanitaire de notre connaissance, Reimann, de l'hôpital de campagne de l'école du monastère, nous a raconté, les larmes aux yeux, qu'un coup direct avait touché la spacieuse salle d'opération de l'école, que tout le sol avec les médecins, le personnel de la salle d'opération, les blessés, les tables d'opération, les lampes des groupes électrogènes et tout l'équipement s'était effondré dans la cave profonde. La dernière vague de bombardiers ennemis avait lâché des tas de bombes au napalm sur le champ de ruines, dont les énormes jets de flammes incendiaient tout.
Le sous-officier Reimann s'était réfugié dans une cave à l'extérieur du couvent pendant le bombardement. Après le bombardement, il a couru vers l'hôpital de campagne pour voir s'il y avait encore quelque chose à sauver. C'est alors qu'il entendit par une trappe de la cave des appels à l'aide. Il a grimpé dans la cave remplie de fumée où, sous l'inclinaison de poutres tombées, il a trouvé son ami coincé jusqu'au milieu du corps, sans possibilité de sauvetage, en train de crier, de gémir. Un bloc de ciment le retenait jusqu'à la taille. Des poutres enflammées tombaient d'en haut dans la cave. Toute tentative de sauver le camarade était vaine. "Je ne sens déjà plus mes jambes", dit l'homme enseveli. En peu de temps, l'incendie du rez-de-chaussée va dévoré la cave. "J'ai pensé à lui laisser mes 7,65 Mauser pour qu'il ne périsse pas vivant dans l'incendie", a dit Reimann, "mais comme la respiration devenait de plus en plus difficile dans la fumée et la chaleur, mon ami Heinz m'a dit : 'Sauve-toi toi-même, personne ne peut me sortir d'ici ! Je lui ai alors injecté dans le haut du bras les cinq ampoules de morphine que j'avais dans ma trousse ; j'espère qu'il était inconscient avant que les flammes ne l'atteignent ! Puis je me suis enfui de la cave".
Un destin unique : un brave camarade de l'hôpital de campagne de St-Vith ! C'était le jour de Noël 1944.
19 Deux grades d’infirmier – 1944-1945
A Un sergent-major sanitaire (Ein Sanitäts-Feldwebel)
Nous allons revenir sur la période en Normandie pour cette partie, Ceci proviens d'un chapitre qui à été rédigé par Alexander Kern en tant qu'histoire séparée, puis collé plus tard comme copie d'une transcription dactylographiée dans le manuscrit original des Mémoires de guerre. Je vous passe les détails de l'attaque sur la station de soin détaillé dans le chapitre 16.
Parmi les blessés de notre deuxième section se trouvait Heinz Bialonski, qui avait reçu un éclat de bombe et avait une grande blessure saignant abondamment à la cuisse, autour de laquelle nous avons rapidement posé un bandage solide. Cette blessure était la cinquième de l'adjudant Heinz Bialonski, qui servait depuis quelque temps dans notre compagnie sanitaire ; il avait été détaché auprès de notre HVP lorsque nous étions encore à Châteaulin, en Bretagne. De là, nous nous étions rendus en Normandie par des marches de nuit au début du mois de juin.
Heinz Bialonski était étudiant en médecine au 4e semestre, avant d'être mobilisé en 1942. C'était inhabituel, car on laissait généralement les étudiants en médecine jusqu'au 5e-6e semestre, c'est-à-dire jusqu'au "Physicum" pour les envoyer ensuite sur le front en tant que sous-officier de campagne. (Feldunterärzte) Il a été appelé prématurément au service militaire parce que sa grand-mère n'était pas tout à fait "aryenne", comme les dirigeants allemands de l'époque l'estimaient absolument nécessaire. C'est lui, le petit-fils, qui a été rendu responsable de cette "imperfection" dans la généalogie !
Heinz était issu d'une famille de médecins de Greifswald et, stimulé par la diversité intellectuelle de son père, ses intérêts allaient bien au-delà de sa spécialité. Il avait une bonne culture littéraire et s'intéressait à l'art et à l'histoire de l'art, que ce soit la peinture ou la musique. Il jouait lui-même du violoncelle, et c'est ainsi que nous avons eu très vite de nombreux points communs.Lorsque je trouvais un piano quelque part en France dans une maison abandonnée ou ailleurs, j'étais assis à côté de Heinz. Heinz s'installait à côté de moi et me disait : "Maintenant, joue un peu de musique. de la musique classique" (contrairement aux autres camarades qui demandaient des chansons plus modernes). "Classique", cela signifiait pour Heinz le plus souvent Haendel, Bach, Mozart ou Beethoven. Et sur le très bon vieil orgue à registres frottés de l'église municipale de Châteaulin, dont l'aimable Monsieur le curé m'avait confié la clé (après une visite courtoise de ma part avec une conversation entièrement en français) Heinz faisait aussi parfois du "vent" avec la soufflerie à pédale située à l'arrière de l'orgue ("Calcant").
Avant d'être affecté à notre compagnie sanitaire après sa quatrième blessure, Heinz n'avait eu que des commandements de grade sanitaire à la troupe. Il a rapidement été promu caporal sanitaire, puis sous-officier, en raison de son excellente disponibilité.
"Mais ensuite", raconte-t-il, "c'était fini ! Je ne pouvais en aucun cas aller plus loin, tu sais, à cause du paragraphe sur l'aryanité. A partir de là, j'ai toujours eu le sentiment (certainement exact) qu'on m'envoyait délibérément dans les pires coins, lors des offensives, des Sonderkommandos et autres, pour que je sois tué : alors on n'avait plus besoin de me décorer et de me promouvoir. C'est ainsi que j'ai été blessé quatre fois en mission permanente". (Après sa 5e blessure sur le HVP de Monthuchon, Heinz a reçu l'insigne d'or des blessés !) Ce à quoi je réponds : "Mais quand tu es arrivé chez nous, en Bretagne, tu étais déjà sergent sanitaire, et tu avais aussi la EK II ?", "Oui, mais c'était tout à fait contraire au règlement". C'est ce qui s'était passé :
Russie - Section centrale - Été 1943
La compagnie d'infanterie à laquelle Heinz était affecté marchait vers l'est. C'était dans la région de Smolensk. Un après-midi, la colonne de marche a passé un tronçon de rivière dont les rives étaient minées par les Russes. La troupe en marche se tenait scrupuleusement sur l'étroit passage délimité par de petits drapeaux jaunes avec lesquels on marquait les couloirs déminés. Le long de la colonne, une moto couvert de poussière a essayé de passer le plus rapidement possible ; il a alors percuté une voiture dans laquelle se trouvaient deux officiers. En raison de sa vitesse de déplacement, le conducteur a été dévié vers la gauche, vers la rive du fleuve, et a fait un vol plané d'environ 8 mètres dans le champ de mines. Tous les soldats s'arrêtèrent, se figèrent et retinrent leur souffle. Mais il ne se passa rien !
Il s'est levé, a redressé sa moto et a fait un pas de côté. Ce faisant, il s'écarta de quelques centimètres seulement avec son pied gauche, et à ce moment- là, une mine antipersonnel explosa à côté de lui dans un grand fracas, un éclair de feu et un épais nuage de fumée. Lorsque le vent a soufflé sur le côté, tout le monde a vu le conducteur couché dans le champ de mines : il a appelé à l'aide à haute voix, sa jambe gauche était à hauteur de l'épaule. Il s'agrippait au moignon d'où s'échappait le sang. Le sang giclait par saccades.
Aucun membre de la colonne de marche n'osait faire un pas dans le champ de mines pour aider le blessé.
Le sous-officier médical Bialonski franchit alors la clôture de mines sans réfléchir longtemps et, en quelques grandes enjambées, se retrouva près du bléssé. Pour Bialonski, il n'y avait que le camarade qui se vidait de son sang, pour la vie duquel chaque seconde était précieuse. En un clin d'œil, Heinz avait posé un garrot et ligaturé la jambe, le saignement dangereux était arrêté ! Heinz a alors crié à ceux qui se trouvaient sur le chemin de faire venir quelqu'un pour transporter le blessé grave avec lui sur le chemin sûr. Mais ils hésitaient, bien que Heinz leur ait déjà montré la voie. Finalement, un caporal vint l'aider, en s'efforçant prudemment de marcher exactement dans les pas de Heinz, jusqu'au blessé. C'est ainsi que les deux hommes ont porté le bléssé sur le chemin sans mines et il ne leur est rien arrivé !
Après ce récit, Heinz m'a dit : "Dans ce genre de cas, le campagnard dit : Tu as eu du bol ! (Hast Du aber Schwein gehabt!) Ce qui signifie probablement 'chance'. Mais moi, je me sentais comme protégé par une force bienveillante, même si j'avais bien sûr très peur avant d'entrer dans le champ de mines".
Quelques officiers de l'état-major du régiment avaient assisté à cette scène au bord de la rivière. Un capitaine s'est approché de Heinz alors que le blessé était en sécurité, lui a dit qu'il le remerciait et lui a rendu hommage pour avoir sauvé la vie d'un camarade (au plus grand péril de sa vie) qui, sans cet acte de courage, se serait probablement vidé de son sang en peu de temps. Après le rapport de l'officier à l'état-major, Heinz Bialonski a été proposé pour la EK et la promotion au grade de sergent-chef sanitaire, et il a été décoré et promu ! Les règles générales et les coutumes en vigueur dans l'armée allemande du troisième Reich pour les soldats "pas tout à fait aryens" de la Wehrmacht.
Bien des années après la guerre, vers 1965, Heinz Bialonski me rendit visite (après une correspondance préalable) à Itzehoe, au retour d'un séjour de vacances à Sylt avec sa femme. Il était tout à fait comme avant, et notre contact personnel et agréable fut immédiatement rétabli, malgré les 20 ans qui nous séparaient.
Heinz a raconté ce qu'il a vécu à la fin de la guerre : mars à septembre 1945 en captivité en Russie, d'où il n'a été libéré si tôt que parce qu'il y avait "acquis" une tuberculose. Reprise de ses études de médecine - mariage - quatre fils, une fille - examens d'État - doctorat - spécialiste des maladies internes - spécialité actuelle : rééducation - - - - nomination au ministère de la Santé de Bonn en tant que directeur médical du gouvernement, le Dr Heinz Bialonski était désormais un homme important dans un poste d'État significatif !
Mais je me réjouissais que Heinz, le bon camarade et ami des mauvais jours de la guerre, ait été lui aussi protégé et sauvé de l'enfer ; qu'il ait pu vivre et agir comme médecin et comme "hominibus amicus" (ami des hommes) après les années d'inhumanité vécues ensemble ; car le véritable travail de sa vie, l'action civile auprès de ses semblables, n'a commencé pour Heinz Bialonski qu'après la guerre.
Quelqu'un pourrait venir et dire : "Qu'est-ce que tu fais de ce saut du sous-officier sanitaire Bialonski dans le champ de mines ? C'était pourtant obligatoire pour le médecin ! N'est-ce pas ? Il était là pour ça ! Ma contre-question : t'es-tu déjà trouvé au milieu d'un champ de mines, où chaque mouvement, chaque pas peut signifier la mort ou une grave mutilation pour toi ? Non ? Tu ne l'as pas fait ? Alors, à ta place, je ferais très attention aux jugements sur "faire simplement son devoir" et tout ça !
B Monsieur le médecin-chef (Der Herr Oberstabsarzt )
C'était le jour avant notre capture par les Américains, le 8 mars 1945, dans l'après-midi. La 2e section de la compagnie sanitaire 2/353 avait installé son dernier poste de secours avancé provisoire dans l'Eifel, au Nürburgring près d'Adenau, dans deux baraquements de la Wehrmacht situés dans la forêt près de "Hohe Acht".
Il n'arrivait presque plus de blessés, tous tentaient encore de traverser le Rhin près d'Andernach. Dans notre salle des blessés, il restait encore cinq blessés graves que nous ne pouvions pas évacuer vers l'hôpital de campagne, car aucune ambulance sanitaire (Sankras) n'arrivait plus à notre poste de secours avancé.
Vers 16 heures, un estafette de la compagnie arriva, dont la 1re section et la logistique se trouvaient à Hohenleimbach, sur la route menant à Kempenich, à environ 10 km à l'est de notre position, en direction du Rhin. L'estafette apporta un ordre du "chef" : partir coûte que coûte avant la tombée de la nuit et rejoindre la compagnie. La capture était imminente, des unités blindées américaines avaient percé à Daun et à Gerolstein.
Suite à cela, l'équipe chirurgicale rassembla le matériel et le chargea sur nos trois chariots en acier tirés par des chevaux. Sur les caisses, nous disposâmes de grosses couches de couvertures de laine et y installâmes les blessés graves – aussi confortablement que possible – bien approvisionnés en narcotiques analgésiques. Si le trajet se faisait sur une chaussée lisse, cela pourrait à la rigueur être supportable.
Pendant ce temps, tandis que nous faisions les bagages, l’estafette de la compagnie raconta : depuis deux jours, le « chef » (le médecin-chef Gebhardt), le sergent-major, les scribes des bureaux, la logistique, le groupe de ravitaillement et des parties de la 1ère section préparaient activement des « bagages pour prisonniers » qu’ils espéraient pouvoir emporter lors de leur capture. Entre-temps, les hommes, comme leurs supérieurs, buvaient abondamment – le sous-officier chargé du ravitaillement disposait encore d’une grande quantité d’eau-de-vie.
Les quelques blessés encore restés à Hohenleimbach, une petite douzaine, n’étaient délibérément pas transportés vers Andernach, sur ordre explicite du « chef », afin que la compagnie sanitaire ait une raison de rester à Hohenleimbach. – –
L’estafette continua son récit : le sergent-major « faisait la fête » avec ses proches camarades toutes les nuits à la cantine, chantant à tue-tête l’Internationale sous l’effet de l’alcool. Les civils du village – il ne restait plus que des personnes très âgées et des enfants, à l’exception de quelques invalides de guerre (les responsables utilisaient prudemment le terme « mutilés de guerre », qui sonnait un peu moins brutal, même si un bras ou une jambe manquait !) – avaient déjà menacé de battre cette « bande ».
Hier, lorsqu’un estafette de la division était arrivé avec l’ordre strict de partir vers l’est, en traversant le Rhin, le chef, fortement alcoolisé, avait tout simplement refusé de recevoir cet ordre.
Voilà donc à quoi ressemblait la situation dans la compagnie : quel beau gâchis ! Ainsi se terminait l’histoire de ces soldats sanitaires : la dissolution ! Une beuverie générale et un coup de pied à tout ce qui avait existé auparavant – – – six longues années !
L’estafette poursuivit : l’ordre de départ de la division n’avait rien d’une surprise. Dès hier matin, le médecin-chef de la division avait reçu une instruction concernant du carburant pour mettre les blessés et le matériel sanitaire en sécurité de l’autre côté du Rhin. Mais, dans son délire alcoolique, le « chef » avait déchiré l’ordre de livraison de carburant. – – – – –
Depuis hier après-midi, devant le bureau administratif, tous les documents étaient détruits – brûlés : ordres, dossiers, affaires Gekados, livrets militaires, etc. Voilà pour le rapport de l’estafette.
Et c’est vers ce chaos que nous étions censés marcher ! (D’ailleurs, nous n’avons jamais rejoint la compagnie : les Américains ont été plus rapides – ils étaient déjà capturés.)
On se préparait systématiquement à la capture et à la captivité, bien qu’il fût encore tout à fait possible de traverser le Rhin. Mais non ! Les gens en avaient assez, ils ne voulaient plus continuer. Ils espéraient davantage de la captivité chez les Américains que de la « liberté » sous la Wehrmacht.
Et qui était au centre de cette résignation ? Le « chef », le commandant de la compagnie sanitaire, le « médecin en charge », l’honorable Oberstabsarzt Josef Gebhardt, un officier au rang de major. Cet « exemple de supérieur à la prussienne », pour qui l’on avait autrefois inventé tant de phrases ronflantes et flatteuses, semblait, à son avis, en avoir suffisamment vu au cours des longues années de guerre. Vraiment ?
Le service exténuant de ce médecin militaire consistait surtout à :
- Recevoir des ordres du médecin divisionnaire, les signer et les transmettre.
- Réprimander tous les subordonnés ayant moins de galons, ou pire encore, aucun !
- Se tenir à bonne distance de toute activité médicale pratique ou soin direct aux blessés. Pourquoi aurait-il dû s’en occuper ? Après tout, il avait à sa disposition de dociles « bêtes de somme », ses médecins subalternes – les réservistes « non actifs ».
En outre, son occupation principale consistait à se procurer de bons, voire d’excellents repas, par tous les moyens possibles, pour satisfaire son cher ego. Pour cela, il comptait sur son « équipe de compagnie » dédiée. Quant à la nourriture « inférieure » des soldats de base, préparée dans les marmites de campagne, il pouvait largement s’en passer.
Et surtout, sa grande activité était… la boisson ! (Ce mot devrait être écrit trois fois plus grand ici, pour en refléter la véritable signification). Il buvait en permanence, même si cela signifiait que les rations spéciales de cognac et de champagne destinées aux blessés graves étaient largement gaspillées.
Pourtant, l’alcool avait une utilité réelle et parfois miraculeuse : nous, membres de l’équipe chirurgicale, étions souvent étonnés et heureux de voir des blessés gravement atteints – pâles, apathiques, haletant péniblement – reprendre vie en quelques minutes après quelques gorgées de champagne mélangé à du cognac. Ils retrouvaient des couleurs, se sentaient visiblement mieux, avant d’être pris en charge chirurgicalement. Cet alcool avait bien cette fonction !
Cela dit, les rations de schnaps destinées aux simples soldats étaient souvent méprisées, car ces derniers n’en comprenaient pas vraiment la valeur.
Enfin, pour compléter ce tableau, je voudrais insérer ici une page du journal de notre meilleur chirurgien, le Stabsarzt Dr. Gustav Bügge, sous la direction duquel j’ai travaillé en tant qu’assistant opératoire pendant 4 ans et demi sur des postes de secours avancés, à l’Est comme à l’Ouest.
"Poste de Secours Avancé (HVP) à Arnoldsweiler, près de Düren, le 27 septembre 1944 Après des semaines d’interventions éprouvantes, un riche particulier d’Erkelenz, qui avait été témoin de notre travail sur le site du HVP auprès des blessés et des malades, a envoyé 300 bouteilles de schnaps (Korn) à l’équipe du HVP et à la compagnie sanitaire, en guise de remerciement et de cadeau. Sur ces 300 bouteilles, le « chef » en a réservé 100 (cent) uniquement pour lui-même."
Il, Gebhardt, était le seul membre de la compagnie sanitaire qui, pendant les opérations dans l'Eifel, restait paresseusement dans son quartier. Lors des soins à des centaines de blessés, il n'a pas fait un seul pansement. Il s'est récompensé de cette « mission » en s'attribuant un tiers du schnaps de grain (Korn) offert à toute la compagnie ; notre compagnie comptait alors environ 70 hommes. Il me semble que cette note du Stabsarzt Dr. Bügge renforce fortement mes informations sur cet OStA Gebhardt.
Cela me rappelle une scène du Nord de la France, pendant le retrait de Normandie en août 1944 (après le débarquement), face aux chars américains. – Un matin, je devais faire un rapport sur une question complètement insignifiante au quartier privé du « chef ». Je me tenais devant le large lit double français, sur lequel le Herr OStA se prélassait avec ses bottes d'équitation. Dans cette grande maison normande, il n'avait pas choisi cette chambre par hasard : elle correspondait parfaitement à ses goûts. Autour du lit, sur les murs, et même au plafond de la chambre au-dessus, il y avait des dessins faits à la main de femmes nues dans des positions absolument explicites.
Tout cela était – à peu près – la vie difficile en première ligne de l'Oberstabsarzt. Il évitait de visiter notre salle d'opération ou notre tente d'opération, et particulièrement nos postes avancés de HVP juste derrière la ligne de front, car il y avait parfois des conditions très inconfortables, soit à cause du travail intensif avec le flot de blessés gémissant de douleur, qui attendaient leurs soins médicaux – ce qui faisait inévitablement souffrir la discipline stricte de la Wehrmacht ; car qui faisait une déclaration conforme lors de son apparition en pleine opération ? - ou à cause de l'air chargé de fer des bombardiers ennemis de nuit ou de l'artillerie.
En Russie, un bunker privé pour le 'Chef' était régulièrement construit plus loin, dans un village où étaient logés le bureau de l'état-major et le train de l'unité : fait de planches épaisses et de gazon. Les ouvriers de la compagnie étaient très occupés ; avec des demandes constantes d'amélioration, ces bunkers étaient généralement terminés juste au moment où l'ordre de départ de la division arrivait. Le Herr Oberstabsarzt vivait selon la devise berlinoise : 'Personne ne peut m'atteindre !' Et en effet : personne ne pouvait l'atteindre ! Toute objection concernant son mode de vie militaire, qui consistait en une existence molle et paresseuse sur le dos d'une compagnie sanitaire travaillant jour et nuit, qui – 'en passant' ! – soignait des milliers de blessés et de malades - ces objections, ce monsieur ne les recevait probablement que de son supérieur direct, le médecin de division. Tout le reste, en dessous de lui, tenait sa langue conformément aux ordres – cela avait été assuré.
Et si des objections du médecin de division avaient jamais eu lieu, OStA Gebhardt les aurait probablement écartées en faisant remarquer que LUI, en tant que chef d'une unité sanitaire aussi importante, devait faire tout ce qui était nécessaire pour être toujours pleinement
Opérationnel ! Opérationnel, prêt à intervenir pour quoi ?
En réalité, la prise en charge des blessés dans nos postes de secours (HVP) à l'est et à l'ouest, en Russie, en France, et enfin en Allemagne, se déroulait généralement sans accroc, et ce, assez indépendamment du « chef », qui se contentait souvent de transmettre les nouveaux lieux d'affectation de la compagnie sanitaire à ses deux unités de postes de secours. Souvent, même l'« avant-garde » de son groupe de compagnie ne fonctionnait pas. Mais le meilleur logement dans le lieu d'affectation n'était pas attribué aux chirurgiens, qui opéraient jusqu'à l'épuisement physique, mais bien entendu au « chef » ! Il arrivait fréquemment que, pour l'équipe opératoire (à l'exception des médecins), aucun logement ne soit aménagé, car – « ils n'auraient de toute façon pas le temps de dormir !
Je me souviens encore très bien d'une mission en août 1943, dans le sud de la Russie, en Ukraine, à l'est de Dnipro, lors des combats de retraite très coûteux pour notre côté de l'armée du Don, vers et au-delà du Dnipro, puis plus loin jusqu'à Kriwyï Rih et le Bug. Le chef du 2e poste de secours (HVP), notre meilleur chirurgien, le médecin-major Dr. Gustav Bügge, gynécologue à l'hôpital Elisabeth de Stettin en temps de paix, était à nouveau en opération avec son équipe depuis plusieurs jours, sans interruption. Les véhicules sanitaires arrivaient sans cesse, remplis de blessés, un flot de misère et de douleurs. En raison des violentes attaques de l'artillerie motorisée russe, nos pertes étaient très lourdes.
Il était environ 2 heures du matin. Le médecin-major Dr. Bügge était en train de réaliser la troisième opération abdominale depuis l'après-midi. Le blessé grave était allongé sur la table d'opération, plongé dans une anesthésie profonde, sous la lumière vert-blanc de nos grandes lampes. À travers la salle d'admission, on entendait, derrière le blockhaus russe, le bourdonnement de notre générateur. Le champ opératoire était éclairé comme en plein jour, des taches de sang rouge vif se dessinaient sur les draps stériles.
Le blessé avait eu l'intestin perforé à plusieurs endroits par un projectile d'infanterie. Dès l'ouverture de la cavité abdominale, une vague de sang se précipita vers le chirurgien. Ensuite, après avoir trouvé le projectile, commença le travail épuisant du chirurgien : il fallait coudre tous ces trous dans les intestins, avec du catgut et de la soie, chaque trou deux fois ; et si le chirurgien omettait un seul de ces trous, alors tout le travail aurait été vain, et après deux jours, le blessé mourrait d'une péritonite, d'une inflammation du péritoine. Cette chance avait donc le soldat gravement blessé, qu'il soit soigné avec une conscience aiguë. Sa vie reposait – humainement parlant – dans les mains du chirurgien. Pendant ce travail extrêmement concentré, il régnait un silence de mort dans la salle d'opération. On n'entendait que les ordres brefs du médecin-major : 'Catgut – nouvelle aiguille – soie – pince – tampon'; ces ordres m'étaient adressés, à moi, l'instrumentiste; 'Insérer le crochet plus profondément – chiffons – nouveaux draps!' Cela concernait l'assistant médecin; 'Ajuster mieux la lumière – essuyer la sueur!' Cela s'adressait à notre aide non stérile.
Dans cette atmosphère de tension extrême, de lutte pour la vie d'un camarade, le 'Chef' entra en titubant dans la salle d'opération en pleine nuit. Il avait de nouveau beaucoup bu dans son quartier confortable, et dans son état d'ivresse, il lui était soudain venu à l'idée qu'il pourrait aller voir ce qui se passait à l'hôpital de campagne et ce que les 'hommes' faisaient là-bas. – L'air frais de la nuit l'avait un peu désivré. Mais à présent, ce qui l'inquiétait, c'était le 'U.v.D.' ou la 'machine à coudre'; c'était ainsi que l'on appelait dans le jargon des soldats le léger bombardier nocturne russe, qui tournait au-dessus du village depuis le début de la nuit et cherchait des traces de lumière pour larguer sa charge de bombes primitive mais efficace.
Maintenant, dans la salle d'opération, dans l'air saturé d'éther anesthésique, que nous ne sentions même plus, le 'Chef' commença à tituber et s'approcha dangereusement du table d'opération et du champ opératoire. Le soldat sanitaire Werner Fleischfresser, notre assistant en salle d'opération, se plaça discrètement entre la table d'opération et le 'CHEF' de manière à ce que celui-ci ne puisse pas passer.
Le Dr. Bügge se tourna calmement, tenant l'adhésif et la pince dans ses mains levées, fixa son supérieur, le "chef" Gebhardt, d'un regard glacial et dit : "Monsieur l'Oberstabsarzt, je vous prie instamment de ne pas me déranger dans mon travail ici. Dans votre état actuel, une salle d'opération n'est sûrement pas l'endroit adéquat pour vous."
Puis, d'une voix tranchante et haute, il ajouta : "Il s'agit d'une vie humaine, comprenez-vous, de la vie de cet homme !" – Là, le "chef" perdit vite de sa prestance et devint tout petit et détestable ; il se retira sans un mot, sans gloire et rapidement vers l'extérieur, dans l'obscurité de la nuit. Je le regardai partir et je pensai à un chat qui, après avoir craché et grogné, s'enfuyait la queue entre les jambes. Peut-être que ce médecin militaire actif (qui, selon mon expérience, n'était ni entièrement médecin ni entièrement soldat) n'avait jamais particulièrement apprécié le 2e HVP et son responsable, Dr. Bügge, car le dévouement et le travail infatigable de ce véritable médecin et sauveteur des blessés (et de son équipe) étaient pour lui un reproche silencieux – parfois, très rarement – lorsqu'il faisait face à lui, en voyant comment IL passait sa vie, comment IL profitait de la guerre.
Nous étions prisonniers de guerre des Américains depuis 7 jours. Nous étions debout sous la pluie, dans la cour de la prison du district de Stenay, une petite ville française au sud de Sedan. La nuit, on nous enfermait – soldats actifs et membres du service de santé – dans les petites cellules de la prison, qui étaient fermées à clé avec des portes en fer. On nous avait interdit, sous peine de privation de nourriture, de porter nos brassards rouges Croix-Rouge sur le bras gauche, car selon la Convention de La Haye, il était interdit de traiter les secouristes comme des prisonniers de guerre réguliers de la troupe combattante. – Dans la cour de cette prison, j'ai rencontré pour la dernière fois notre ancien chef de la compagnie sanitaire.
L'ancien Oberstabsarzt, autrefois impeccablement soigné, propre comme un sou neuf, couvert de lamelles, de décorations et de médailles scintillantes, semblait maintenant bien abîmé : sale, mal rasé, déchiré, affamé ; et il ne lui restait de toute sa parure militaire que sa casquette d'officier, elle aussi un peu usée par la poussière et la pluie. Il arrivait dans un groupe spécial d'environ 15 prisonniers de guerre, officiers et soldats, en rangs (fi donc !) d'un des nombreux interrogatoires. Il m'appela et s'approcha de moi. "Eh bien, Kern, vous aussi ici ?" me demanda-t-il de manière "affable" et "intelligente". "Vous n'avez plus rien de vos affaires ?" (Je savais bien qu'il avait préparé, lui, les autres officiers et le reste de la compagnie, leurs "bagages de prisonniers" pendant trois jours. Pour lui, cela avait dû être un joli paquet bien trié ; et maintenant, après si peu de jours, Gebhardt s'était déjà débarrassé de tout. Il avait probablement été pillé par la MP [Police militaire], qui n'était pas plus tendre avec nous. – Mais avec cet homme, que j'avais observé pendant de nombreuses années dans sa "période de gloire", je ne pouvais, de toute ma bonne volonté, avoir la moindre compassion !)
Je montrai à Gebhardt ma fine mallette et dis : "Omnia mea mecum porto, Herr Gebhardt !" Simplement : "Herr" Gebhardt, j'avais volontairement omis son titre militaire, car il n'était plus mon supérieur, mais un prisonnier de guerre, un POW, un prisonnier sans aucune autorité ; maintenant – enfin – je n'avais plus à tenir compte de son autorité de décorations. Bouche ouverte, un peu déconcerté, Gebhardt me fixait, stupéfait par cette adresse incroyable, non militaire, simplement "civile" : "Herr". Mais qu'y pouvait-il ? Les ordres, ce qu'il faisait habituellement, cela n'avait plus d'effet ici, cela n'aurait provoqué que de l'amusement parmi les camarades prisonniers de guerre qui nous entouraient.
C'était fini avec son image de grand guerrier. Maintenant, il était dépouillé de l'éclat de sa position militaire, de son haut rang, de son uniforme étincelant et de ses diverses décorations – déshabillé dans le sens le plus propre du terme. L'apparence extérieure, l'aura, tout cela avait disparu ; et puisque cet éclat extérieur avait été pendant des années l'essentiel de ce qu'il était, une belle enveloppe, il ne restait plus grand-chose : juste un petit homme misérable, dont le vide, la bassesse, la paresse et la lenteur d'esprit allaient maintenant apparaître de manière flagrante, car l'ennemi cruel l'avait privé de son éclat extérieur. Mais il pourrait encore exercer comme médecin dans la vie civile ! Vraiment ?
Lors de son service, Gebhardt avait montré que sa position élevée de chef de compagnie comptait dix fois plus pour lui que n'importe quelle activité médicale (peu décorative), n'importe quel travail auprès des blessés. Dans l'avenir de l'après-guerre, il devrait se contenter de ses connaissances médicales et de ses qualités humaines, qu'il avait (prouvé !) depuis des années négligées.
Un égoïste démesuré et un petit intrigant misérable : voilà tout ce qui restait de lui !
On peut facilement imaginer que pour ce véritable "profiteur de guerre", l'idée d'une paix — quelle qu'elle soit — devait apparaître comme un cauchemar, un spectre terrifiant. Ce type n'aurait jamais voulu que la guerre prenne fin. Il savait bien qu'il ne vivrait plus jamais aussi bien — avec un salaire élevé, peu de travail et la meilleure nourriture ! Mais maintenant, la guerre était vraiment finie : pour lui — malheureusement — beaucoup trop tôt !
Il se tenait devant moi sous la fine pluie : misérable, dépouillé de toute gloire, plus rien de valable ne restait en lui, Quae mutatio rerum! (latin: Quel bouleversement des choses !) Je me suis retourné et l'ai laissé là. Il était à court d'options. Pour lui, le soldat de carrière, c'était la fin absolue, le point zéro. Mais nous autres, les civils empêchés durant la guerre, nous voyions maintenant la vraie vie devant nous : lumineuse et pleine de promesses !
Si autem pro … sermonis rusticitate placet nulli, memet ipsam tamen iuvat, quod feci
"Mais si, à cause de la rusticité du langage, cela ne plaît à personne, cela me plaît cependant à moi-même, parce que je l'ai fait."

